
À lire : un extrait de « Course aux diplômes : qui sont les perdants ? » de S. Chauvel
Séverine Chauvel, Course aux diplômes : qui sont les perdants ?, Paris, Textuel, 2016.
Cet extrait est reproduit ici avec l’aimable autorisation de l’éditeur.
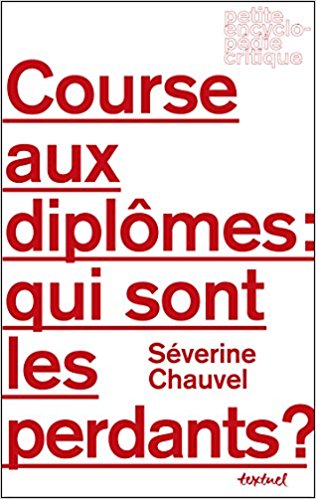
Au-delà du nombre de diplômés : que fait-on à l’école ?
Si l’investissement scolaire se présente parfois comme un miroir aux alouettes, qu’en est-il du rôle de l’école dans la transmission des savoirs ? La norme du diplôme ne renvoie pas uniquement à un usage marchand, elle atteste aussi la qualité de l’éducation reçue. Les liens entre les modes d’organisations pédagogiques et les types de systèmes éducatifs sont précisément l’objet de l’ouvrage L’Évolution pédagogique en France d’Emile Durkheim. Le sociologue y analyse les relations entre institution scolaire et évolution culturelle, ce qu’il nomme « le processus scolaire d’intégration morale ».
Cet ouvrage, issu d’une série de cours publiés en 1938, participe à l’élaboration d’un nouvel ordre social qui passe par l’école. Emile Durkheim est en effet chargé d’un cours de pédagogie en 1887 à Bordeaux, à l’intention des instituteurs, puis en 1902, il est nommé à la Sorbonne, chargé des cours de sciences de l’éducation. En 1904 et 1905, il donne des cours d’histoire de l’enseignement secondaire aux étudiants agrégatifs destinés à devenir professeurs du secondaire. Définissant l’école comme un « milieu moral organisé », il propose de transmettre une nouvelle morale, adéquate au nouvel ordre social – dans un contexte où la loi Jules Ferry sur l’école gratuite, obligatoire et laïque a été récemment votée. Emile Durkheim file la métaphore de la conversion : l’école doit à son tour convertir les élèves à une morale laïque et républicaine. Auparavant, il s’agissait de fabriquer un bon chrétien ; désormais l’école doit fabriquer un bon citoyen et transmettre une morale nouvelle.
À partir d’un travail sur archives, Emile Durkheim retrace ainsi les enjeux sociaux présents dès l’origine de l’école : quelle est la fonction sociale de l’école, en rapport avec l’état historique de la société ? Quels sont les modes d’organisation de l’enseignement et qu’y enseigne-t-on ? Il rappelle les origines de l’école française : les écoles monacales au Ve siècle, où se concentrent plusieurs enseignements, qui partagent une même direction morale, l’ambition d’enseigner la « totalité » des sciences (grammaire, rhétorique, dialectique). La fonction sociale est alors la christianisation des élites. À la Renaissance, l’école jésuite, qui repose sur la culture lettrée, cherche à moraliser les élèves. La mise en concurrence entre individus est organisée par un système de prix et de concours. Cette méthode d’analyse est toujours pertinente pour expliquer aujourd’hui la fonction sociale d’un système qui prétend avant tout viser, dans un contexte de chômage massif, à fabriquer des diplômés pour qu’ils trouvent un travail. Ces finalités de l’école sont étroitement liées à l’apparition du chômage de masse et à la dégradation de la condition salariale : l’école doit préparer à la vie professionnelle.
Les politiques éducatives mettent par conséquent l’accent sur les taux de diplômés plutôt que sur les apprentissages. Les premières fonctions de l’école sont devenues l’évaluation et l’orientation des élèves pour obtenir un diplôme.
Pour comprendre la relégation des apprentissages à une fonction secondaire de l’école, il faut dans un premier temps examiner les usages des statistiques et des indicateurs, et leurs conséquences sur l’accès aux diplômes des élèves. Dans un deuxième temps, nous verrons, à partir d’enquêtes de terrain qui portent sur les pratiques pédagogiques, comment s’organise concrètement cette relégation des savoirs.
1-Une école du chiffre ?
Quels sont les usages des statistiques et des indicateurs au moment des décisions d’orientation des élèves ? Les évaluations nationales et internationales du système éducatif, mises en place au cours des années 1980, visent à mesurer les compétences plutôt que les savoirs des élèves. Les indicateurs créés à partir de statistiques de flux d’élèves guident les professionnels du secteur éducatif dans les décisions d’orientation.
La mesure des « compétences »
Les évaluations de masse des acquis des élèves sont systématisées à partir de la loi de 1989, date qui marque le début d’une « culture de l’évaluation » en France (Pons, 2011). L’évaluation du système est également prise en charge, à partir des années 2000, par de grandes enquêtes internationales pilotées par l’Organisation de coopération et de développement économique comme Pisa (Programme international pour les acquis des élèves) qui évalue le niveau d’acquisition par des élèves de quinze ans des connaissances et des compétences. Ces comparaisons internationales, qui concernent aujourd’hui plus de soixante pays, révèlent que les inégalités scolaires s’accentuent en France, pays très mal placé dans les classements. Un rapport de l’Unicef indique que « la France se situe presque à la dernière place du classement en termes d’écarts de performance scolaire » (2016). Les responsables de l’Éducation nationale ont reçu au départ avec méfiance ces enquêtes comparatives internationales. Dans un ouvrage intitulé L’élitisme républicain (2009), Christian Baudelot et Roger Establet s’interrogent : « Qui a peur de Pisa ? ».
Les résultats de ces enquêtes sont relativement disqualifiés car elles sont considérées comme mal adaptées aux méthodes d’enseignement en France : Pisa mesure l’efficacité du système scolaire, un système étant jugé efficace quand il accroît le niveau d’éducation en réduisant les écarts de performance entre les élèves les meilleurs et les plus faibles. Au-delà des débats sur la méthodologie employée, les résultats de l’enquête Pisa confirment les grandes difficultés des élèves en France, notamment en lecture.
Malgré les résultats intéressants que livrent ces grandes enquêtes, on peut émettre quelques réserves sur la conception de l’éducation qui les sous-tendent. Ces évaluations internationales visent à évaluer les compétences des élèves, notion qui apparaît en France dans la charte des programmes dès 1992. Elle est ensuite développée dans le « socle commun de connaissances et de compétences » (décret du 11 juillet 2006). Celui-ci considère l’éducation comme un instrument de compétitivité[1], que chacun doit acquérir et faire fructifier sur le marché du travail. En 2009, la Commission européenne a en effet établi une liste de « compétences de base » qui doit favoriser la « flexibilité » des individus[2]. Cette notion aux contours flous, étroitement liée aux situations de travail, menace l’existence des diplômes et des qualifications, considérées comme plus rigides et éloignées du monde du travail (Ropé et Tanguy, 1994). Les programmes d’enseignement sont alors redéfinis à l’aune des compétences, qui tendent à supplanter l’activité de transmission des savoirs. On se rapproche ainsi du « rêve patronal d’une école confondue avec l’entreprise» dénoncé par les sociologues Luc Boltanski et Pierre Bourdieu en 1975 : « Les maîtres de l’économie ont intérêt à supprimer le titre, et son fondement, l’autonomie du système éducatif ; ils ont intérêt à la confusion complète entre le titre et le poste. Ils souhaitent avoir les capacités techniques que produit l’instrument de production des producteurs sans en payer la contrepartie, c’est-à-dire les garanties que confère l’existence d’un système éducatif relativement autonome » (i.e. le titre, 1975, p. 102).
Quels sont les effets de l’introduction de cette notion de compétence ? Comment sont répartis les élèves dans les différentes filières si ce n’est pas en rapport avec leurs résultats scolaires ? De manière surprenante, l’élévation du niveau d’éducation correspond à une moindre sélectivité des élèves dans les voies générales et technologiques. Nous verrons que ce paradoxe est le reflet d’une sous-estimation de l’importance des apprentissages dans les décisions d’orientation.
Sur le terrain : rôle des statistiques
On a vu que les diplômes ne correspondent pas nécessairement aux besoins du marché. On constate également que, de façon paradoxale, les critères de sélection des élèves dans les différentes voies d’étude sont relativement indépendants des acquis scolaires des élèves. Pour le comprendre, on peut par exemple s’intéresser à une circulaire adressée aux chefs d’établissement de l’académie de Créteil (recueillie dans le cadre de l’étude précédemment citée), qui constitue un cas exemplaire du rôle des statistiques dans la gestion des flux de population scolaire. Cette circulaire porte sur les « politiques et procédures d’orientation pré-baccalauréat » (29 décembre 2006). Les politiques éducatives d’allongement des scolarités se diffusent en effet à travers des circulaires qui mettent l’accent sur un usage démographique des statistiques à l’échelle de l’académie. La circulaire annonce trois objectifs, formulés en termes de priorités nationales : la diminution des sorties sans diplôme et sans qualification, l’accompagnement d’au moins 50 % d’une classe d’âge à un niveau II de qualification (licencemaster) et l’égalité des chances vers toutes les filières de l’enseignement supérieur.
Cette circulaire interpelle les chefs d’établissements sur des objectifs quantifiés. Ceux-ci portent sur l’augmentation des taux de passage des élèves en seconde générale et technologique, selon deux modalités. La première relève du domaine psychologique : le recteur conseille aux chefs d’établissement d’« encourager toujours les élèves à oser la voie générale et technologique». La deuxième modalité est d’ordre moral. Cet encouragement est justifié par les notions de dignité : le taux des élèves de 6e de l’académie qui accèdent à une première générale est qualifié d’« indigne pour notre académie ». La mobilisation de ces deux dimensions, psychologique et morale, a pour effet de ne prendre en compte ni les caractéristiques sociales des élèves, ni les conditions d’apprentissage. En outre, le moyen pour mener à bien cet objectif repose sur un « entretien individualisé et personnalisé proposé à tous les élèves de 3e et réalisé dans les établissements par les membres de l’équipe éducative ». Or le contenu de cet entretien consiste essentiellement à informer : « La réussite d’une orientation passe avant tout par une bonne information des élèves et de leurs parents concernant les métiers (…) et les formations qui leur sont offertes. »
Cette conception de l’information est critiquable à plus d’un titre. La notion de « bonne information » repose sur une conception de l’offre scolaire considérée comme un marché dans lequel l’information permettrait de réduire les différences des parcours des élèves. Le moyen que constitue l’information pour réduire les inégalités scolaires est surestimé et constitue une simplification de la situation. Par exemple, la non mixité de certaines filières de formation ne peut se réduire à un manque d’information sur les voies d’études. Les objectifs de gestion des flux des élèves, étudiés dès les années 1990 par le sociologue Philippe Masson, sont définis à l’échelle académique (1999). Ils renvoient à une conception morale et abstraite des pratiques d’orientation, reposant une responsabilité individuelle, sans que la question de l’offre d’éducation et de formation ne soit mentionnée dans les textes et discours officiels. La question des inégalités sociales et territoriales est exclue du champ de justification. Les injonctions relèvent d’un sens commun moral, auquel il semble difficile de s’opposer. La normalisation des pratiques suppose leur quantification, élaborée à l’échelle départementale.
Le succès de cette rationalité gestionnaire repose sur l’existence d’instruments de mesure et d’un service ministériel spécialisé. Des indicateurs statistiques sont introduits sous le terme Ipes (Indicateurs pour le pilotage des établissements du second degré) au milieu des années 1990 avec la création de la Direction des études et prospectives. Ces indicateurs mettent la focale sur des taux de passage plus que sur les contenus des apprentissages. Les principaux se présentent alors parfois comme investis de la mission d’augmenter les taux, en invoquant l’intérêt des élèves en général (Chauvel, 2012). Ce discours met à distance les situations des élèves, alors même que les décisions à prendre portent sur des devenirs individuels. Une des ressources dont les principaux disposent est la maîtrise du cadre statistique des décisions[3]. La décision d’orientation intervient à l’issue d’un processus collectif d’échange visant à la construction d’une connaissance et d’une appréciation partagées sur les élèves. On aurait pu s’attendre à ce que la bonne connaissance des élèves par les enseignants pèse fortement sur les décisions finales. C’est le cas la plupart du temps, lorsqu’émerge un accord rapide avec la hiérarchie. Mais les principaux obtiennent souvent gain de cause lorsque les objectifs quantitatifs qu’ils se donnent les conduisent à contester les propositions des enseignants. Dans ces cas plus conflictuels, la connaissance que les enseignants ont des élèves apparaît comme une ressource peu efficace. Plusieurs explications sont possibles. La longueur du processus en est une. Invoquée par les principaux pour dédramatiser les décisions et amoindrir la résistance des enseignants, elle conduit certains d’entre eux à lâcher prise. Mais elle ne serait probablement pas suffisante si les principaux n’avaient pas à leur disposition des arguments chiffrés, qu’il s’agisse de comparaisons entre les notes obtenues par différents élèves ou de données statistiques permettant d’invalider l’idée que les passages en seconde générale et technologique sont trop laxistes.
Appuyées sur des chiffres, ces argumentations peuvent se parer des atours de l’objectivité contre des avis professoraux plus étayés mais aussi plus suspects de subjectivité. Cette importance historiquement croissante prise par les statistiques comme appui central du jugement peut s’expliquer par l’emprise d’une forme de rationalisation instrumentale des activités, telle que le sociologue Max Weber a pu la définir (Weber, 1964). Cette rationalisation impose de nouvelles normes d’action et de jugement, selon une logique soulignée par le sociologue Jean-Pierre Terrail : « Les enseignants n’ont plus seulement désormais la responsabilité d’une conduite efficace des apprentissages, ils doivent conjuguer cette compétence traditionnelle avec une solide capacité de discernement et d’évaluation des possibilités intellectuelles de leurs élèves, et savoir prendre les bonnes décisions en matière de notation, passage dans la classe supérieure, orientation. » (2016, p. 126). Cette nouvelle exigence a un impact sur la conduite des apprentissages, comme si elle était devenue seconde par rapport à l’évaluation des élèves qui s’autonomise ainsi des épreuves scolaires.
2-Ce qui compte à l’école
Alors que l’objectif de l’école, réaffirmé régulièrement par le ministère de l’Éducation nationale, est la « réussite de tous », de plus en plus d’élèves ont des résultats scolaires très faibles (Broccolichi et al., 2010). Les inégalités sociales face aux apprentissages sont généralement sous-estimées car elles se dissimulent derrière les inégalités d’orientation, de parcours et de diplômes (Broccolichi et Sinthon, 2011). Expliquer les inégalités de parcours par des inégalités d’orientation a pour effet de renvoyer la responsabilité des échecs à des choix individuels. En outre, les inégalités sociales face aux apprentissages ne sont pas uniquement liées au capital culturel familial. D’autres facteurs influencent les performances scolaires des élèves. Les modalités pédagogiques expliquent une bonne part des différences de réussite, et ce dès l’école dite maternelle.
Des savoirs relégués
Comment comprendre que certains élèves réussissent mieux que d’autres ? Selon l’idéologie des dons, les individus naissent inégalement doués pour l’école. La théorie du handicap socioculturel, encore plus répandue aujourd’hui, impute quant à elle l’échec des élèves d’origine populaire à leurs origines familiales et expliquent les difficultés des élèves par le déficit que représenterait une origine sociale populaire – sans s’interroger sur la responsabilité de l’école dans ces difficultés. Or nous verrons que la relégation de la transmission des savoirs au second plan contribue à la production des inégalités d’apprentissage. Les apprentissages des élèves peuvent être perturbés par des malentendus qui se construisent dans la relation entre enseignants et élèves. En outre, nous verrons que la multiplication des dispositifs pour remédier à ces difficultés, qu’elles soient cognitives ou comportementales (ces deux ordres sont souvent liés), a pour effet paradoxal d’exclure les élèves concernés des situations d’apprentissage.
Un rapport utilitaire au savoir, par exemple le fait d’effectuer une tâche pour avoir une note et non pour le plaisir d’apprendre, est peu propice à la réussite scolaire (Charlot et al., 1992). Ces malentendus, qualifiés de sociocognitifs, produisent des inégalités d’apprentissage dont les chercheurs de l’équipe Escol – éducation et scolarisation – ont exploré les mécanismes (Bautier et Rochex, 1997). Certains élèves travaillent mais n’apprennent rien, comme l’expliquent Elisabeth Bautier et Patrick Rayou (Bautier et Rayou, 2013). Un exemple éclairant donné par les auteurs est celui d’une activité en classe de grande section de maternelle qui concerne l’apprentissage de la lecture. L’enseignante demande aux élèves de découper et de coller des papiers sur lesquels sont écrits des mots afin de fabriquer une phrase. Cet exercice produit des différences entre les élèves qui ont compris l’enjeu de lecture et les autres qui arrivent à peine à découper les papiers et s’arrêtent à cette phase-là. Se concentrer sur l’accomplissement de l’activité proposée par l’enseignant plus que sur l’activité cognitive mise en jeu est source de malentendu (Bonnéry, 2007). Ces incompréhensions sont socialement situées. Les élèves des milieux populaires se conforment aux consignes des enseignants sans s’engager dans une véritable appropriation des savoirs : le lien entre ces deux opérations cognitives n’est pas évident et doit être explicité.
Un autre exemple est donné par les observations en classe menées par Stéphane Bonnéry. Ce dernier montre que les enseignants ont tendance à valoriser les attitudes de conformité aux règles des élèves, ce qui génère des incompréhensions et ne permet pas à tous les élèves d’accéder à des savoirs abstraits. Un exemple frappant est donné d’un élève de CM2 qui passe des heures à mémoriser une carte de France pour une évaluation en classe. Au moment de l’évaluation, il ne comprend pas que l’enseignant lui demande de produire une autre carte : l’élève pense avoir travaillé en apprenant par coeur la carte de la leçon, alors que ce qui est attendu est une capacité réflexive, une remobilisation de ses savoirs sur la notion de relief en géographie dans un autre contexte, avec une autre carte. L’élève observé ici considère qu’il vit une injustice car il a appris sa carte, mais il avait compris la leçon sur la notion de relief avant tout comme du coloriage. Ce cas illustre la distance de certains élèves de milieux populaires envers les exigences scolaires, distance qui ne peut se réduire si les exigences restent implicites.
Or les jeunes enseignants sont plus préoccupés par la gestion de la classe et la question de l’autorité que par les apprentissages. C’est ce que montre l’enquête du sociologue Jérôme Deauvieau, menée à partir d’observations de pratiques enseignantes en classe (Deauvieau, 2009). Selon ses observations, le chahut des élèves dépend précisément du succès de l’interaction cognitive. Or dans les prescriptions pédagogiques officielles comme le « cours dialogué » (qui consiste à « libérer » les paroles des élèves), il est demandé aux enseignants de faire participer les élèves avant tout. Ce n’est donc pas une qualité naturelle de l’enseignant, ni son charisme, qui explique le peu d’implication des élèves en classe dans l’effort cognitif, mais la bonne maîtrise de la discipline par l’enseignant, qui permet aux élèves de mémoriser des connaissances qu’ils peuvent remobiliser par la suite. Les enseignants qui ont choisi leur discipline d’enseignement tôt dans leurs propres études – autrement dit qui ont construit un rapport solidifié à la discipline enseignée – possèdent une ressource professionnelle importante pour l’exercice du métier. Les jeunes enseignants observés qui ont un rapport lâche à leur discipline ont davantage tendance à sous-estimer les apprentissages des élèves. Des malentendus naissent ainsi de la confusion entre faire apprendre et faire participer les élèves, ce qui ne permet pas aux élèves de progresser à égalité.
De nouveaux dispositifs dits de remédiation offrent un nouvel exemple de cette relégation des apprentissages au second plan. Certains collégiens sont accueillis temporairement dans des dispositifs externes à l’école, des structures de type associatif ou issues des collectivités locales, dans lesquelles travaillent des animateurs et des éducateurs. Depuis que les établissements scolaires ont été dotés d’autonomie sous l’effet de la décentralisation au début des années 1980 (Ben Ayed, 2009), ces dispositifs se multiplient et viennent remettre en cause un modèle unifié de l’institution scolaire (Barrère, 2013).
Si les diplômes n’ont pas d’homogénéité à l’échelle nationale (Agulhon, 2011), il en va de même pour l’organisation scolaire. Ces dispositifs sont destinés à traiter en dehors des établissements scolaires les difficultés que les professionnels du secteur éducatif rencontrent face à des élèves considérés comme perturbateurs. Prenons l’exemple d’un dispositif, géré par une association, de prise en charge de collégiens temporairement exclus de leurs établissements suite à une décision disciplinaire (Garnier et Moignard, 2015). Dans le département étudié, il en existe une trentaine, qui accueille environ 3000 collégiens par an. Quelles sont les activités mises en place ? Les « ateliers de remédiation scolaire » proposés engagent une réflexion sur la loi, les sanctions, le respect, autrement dit un travail sur les manières de se comporter. Aucun apprentissage scolaire n’y est envisagé, alors que les élèves eux-mêmes dénoncent « le risque de dégradation de leurs difficultés sur le plan des apprentissages que leur fait courir cette absence d’école » (Garnier et Moignard, 2015, p. 5). La question des apprentissages semble secondaire par rapport au fait de préparer les élèves à bien se comporter afin de s’adapter à l’école ou au travail. Mais au contraire, dissocier les finalités d’apprentissage et d’insertion permettrait d’élever de façon efficace le niveau d’éducation.
Les difficultés posées par les élèves considérés comme perturbateurs ne sont pas les seules à être traitées en dehors de l’école. Les difficultés scolaires des élèves sont de plus en plus imputées à des troubles d’ordre médicaux et psychologiques tels que la dyslexie ou l’hyperactivité. Cela correspond à une individualisation des traitements et une absence de prise en compte des questions d’apprentissage par l’école : par exemple pour la dyslexie les difficultés sont traitées dans le cabinet des orthophonistes, dont le nombre explose (Garcia, 2013). L’importance croissante de la « médicalisation » de l’échec scolaire, étudiée par le sociologue Stanislas Morel, vient confirmer « l’accentuation de la perte du contrôle des enseignants sur la production des savoirs pédagogiques » (2014, p. 206). Les professionnels de la santé interviennent de plus en plus sur les questions d’apprentissage dans la mesure où ils en prennent en charge une partie. La logique de compétition pour la mobilité sociale par l’école se caractérise alors par une moindre valorisation du contenu de l’éducation (van Zanten, 2016). Cependant on peut imaginer possible de tenir ensemble l’exigence démocratique d’une généralisation des scolarités et d’une valorisation des contenus enseignés.
Une école de l’émancipation
Quel projet peut porter l’école en dehors des objectifs quantifiés ? Comment le mettre en oeuvre ? Plusieurs critiques s’élèvent depuis les années 1990 contre les logiques de « marchandisation » à l’oeuvre à l’école (Laval, 2003). Le système éducatif trouve plus difficilement le moyen de définir ses enjeux et ses pratiques propres et semble davantage dépendant des logiques du monde économique. Les relations entre système éducatif et monde économique restent complexes. Les diplômes, devenus une norme partagée, sont censés correspondre aux besoins du marché du travail et favoriser l’insertion professionnelle alors que, comme nous l’avons vu, les diplômés exercent, pour la moitié d’entre eux, leur premier emploi dans une spécialité qui ne correspond pas à leur titre. Ces objectifs semblent entrer en opposition avec le développement d’une pensée critique, qui vise une émancipation des individus et interroge le système social en général. Il convient de réaffirmer ce qui compte à l’école : une école commune à tous les élèves au sein de laquelle se transmettent des savoirs critiques. Or les débats sur l’école se sont focalisés sur la « valeur » des diplômes et sur le renforcement de l’articulation entre certifications professionnelles et marché du travail. Les diplômes n’ont pas toujours été indispensables. En période de chômage de masse, l’école a pour mission de conduire à l’emploi : l’accent ne porte donc pas sur les pédagogies émancipatrices mais sur la fabrique des diplômés, tout en affirmant son rôle de sélection avec le maintien d’une école pour élites. Les nouvelles générations sont certes certifiées mais connaissent toujours un fort taux de chômage. Comment expliquer la persistance de ces politiques malgré les échecs qu’elle produit ?
La sociologue Lucie Tanguy y voit « une volonté explicite de transmettre des attitudes et des dispositions conformes aux attentes des employeurs au détriment de la formation du travailleur qualifié, du citoyen éclairé et de l’individu cultivé » (2016, p. 16). Cette tendance est justifiée en raison d’une forme de réalisme économique : « Dans ce contexte, la formation est apparue comme, si ce n’est la solution, du moins un instrument de modernisation des entreprises, de compétitivité de l’économie, de l’adaptation au marché du travail et aussi de conversion des esprits. » (Tanguy, 2016, p. 197). La sociologue dénonce l’esprit d’entreprise qui pénètre l’école ainsi que les partenariats avec des associations qui financent des projets de type entrepreneurial[4].
Si les réformes managériales permettent le contrôle des pratiques enseignantes, on peut envisager un autre usage des chiffres par les acteurs. En effet, les actions et les jugements ne sont pas réductibles à des formes d’évaluation chiffrées. Les chiffres sont aussi des outils d’objectivation des inégalités qui peuvent être l’objet d’un usage alternatif à celui qui avait été envisagé au départ. Ce sont aussi des outils potentiellement générateurs de réflexivité : la critique des chiffres peut porter sur le poids du chiffre sur les activités ou sur les catégories qui sont mises en place dans la mesure où elles ne respectent pas l’activité. Les critiques des enseignants à l’encontre des logiques économiques en éducation permettent d’en relativiser les effets concrets. Les choix scolaires peuvent difficilement s’appréhender comme un marché au sens économique : on ne discute pas d’un prix stricto sensu mais d’une qualité (Félouzis et al., 2013). Le renforcement des espaces de concurrence scolaire constitue davantage le signe d’une perte d’autonomie du système scolaire que celui d’une pénétration de logiques générales de marché à l’école.
Quelles alternatives pourrait-on proposer pour une école qui ne soit pas un lieu de hiérarchisation ? Quels seraient les contenus d’une école commune à tous, sans voie de relégation, qui permettrait l’émancipation des élèves ? « Former des capacités instruites de réflexion et d’analyse » : telle est la mission fondamentale de l’école, réaffirmée par Jean-Pierre Terrail dans son ouvrage intitulé Pour une école de l’exigence intellectuelle (2016). Membre du Groupe de recherche sur la démocratisation scolaire (GRDS), il rappelle que la fonction première de l’école est de transmettre des savoirs écrits. Il défend le principe d’éducabilité de tous. Le GRDS propose ainsi « l’abolition » des filières dans l’enseignement secondaire et la prolongation de l’obligation scolaire jusqu’à dix-huit ans.
Finalement, qu’est-ce qui compte à l’école ? Une école commune à tous pourrait proposer un contenu sans hiérarchie entre savoirs théoriques et savoirs pratiques. En ce sens, l’éducation pourrait être à la fois critique dans son fonctionnement et dans ses effets, ce qui nécessite un rapport réflexif aux savoirs et ouvre ainsi la possibilité d’un projet d’émancipation. Il ne s’agit pas de remettre en cause de façon systématique les savoirs transmis, mais de les placer dans une perspective historique par exemple. Transmettre un savoir de façon critique nécessite de poser les questions non seulement des modalités de transmission mais aussi des conditions d’appropriation de ces savoirs.
Bibliographie
AGULHON C. (2011), « Licences et masters professionnels, des diplômes nationaux ? » in F. Maillard, La prise en compte de l’emploi et de l’insertion professionnelle dans la définition des diplômes : effets et paradoxes, Rennes, PUR.
BAUTIER E. et RAYOU P. (2013), Les inégalités d’apprentissage, Paris, PUF.
BAUTIER E. et ROCHEX J.-Y. (2007), « Apprendre : des malentendus qui font la différence », in J.-P. Terrail (dir.), La scolarisation de la France, Paris, La Dispute
BEN AYED C. (2009), Le nouvel ordre éducatif local : mixité, disparités, luttes locales, Paris, PUF.
BEN AYED, BROCCOLICHI S., et TRANCART D. (2010), École : les pièges de la concurrence. Comprendre le déclin de l’école française, Paris, La Découverte.
BOLTANSKI L. et CHIAPELLO E. (1999), Le Nouvel Esprit du capitalisme, Paris, Gallimard.
BONNERY S. (2007), Comprendre l’échec scolaire. Elèves en difficultés et dispositifs pédagogiques, La Dispute.
BROCCOLICHI S. et SINTHON R. (2011), « Comment s’articulent les inégalités d’acquisition et d’orientation. Relations ignorées et rectifications tardives », Revue française de pédagogie, n° 175, p. 65-101.
CHAUVEL S. (2012), « Des politiques aux pratiques d’orientation. Enquête dans deux collèges de banlieue parisienne », Thèse de doctorat, Centre Maurice Halbwachs, ENS-EHESS.
DEAUVIEAU J. (2009), Enseigner dans le secondaire. Les nouveaux professeurs face aux difficultés du métier, Paris, La Dispute
DURKHEIM E. ([1938], 2014), L’Evolution pédagogique en France, Paris, PUF.
GARCIA S. (2013), À l’école des dyslexiques. Naturaliser ou combattre l’échec scolaire ? Paris, La Découverte.
GARNIER J. et MOIGNARD B. (2015), “Un dispositif local recomposé. Moins d’école ou mieux d’école ?”, Revue Diversité, 181, p. 145-151.
LAVAL C. (2003), L’école n’est pas une entreprise, Le néo-libéralisme à l’assaut de l’enseignement public, Paris, la Découverte.
MASSON P. (1999), Les coulisses d’un lycée ordinaire. Enquête sur les établissements secondaires des années 1990, Paris, PUF.
MOREL S. (2014), La médicalisation de l’échec scolaire, Paris, La dispute.
PONS X. (2011), L’évaluation des politiques éducatives, Paris, PUF, « Que sais-je ? ».
RICHEBE N. (2002), « Les réactions des salariés à la « logique compétence » : vers un renouveau de l’échange salarial ? », Revue française de sociologie, 43-1. p. 99-126.
ROPE F. et TANGUY L. (1994), Savoirs et compétences. De l’usage de ces notions dans l’école et l’entreprise, Paris, L’Harmattan.
TERRAIL J.-P. (2016), Pour une école de l’exigence intellectuelle, La Dispute.
WEBER M. ([1905], 1964), L’Ethique protestante et l’esprit du capitalisme, Paris, Plon 1964.
ZANTEN (van), A. (2001), L’école de la périphérie. Scolarité et ségrégation en banlieue, Paris, PUF.
Notes
[1] La notion de compétences en éducation est en cohérence avec de l’organisation patronale du Medef (Mouvement des entreprises de France) : elles renvoient à « une combinaison de connaissances, savoir-faire, expériences et comportements s’exerçant dans un contexte précis », cf. « Les pratiques internationales en matière de compétences », Synthèse des travaux des journées internationales de la formation, Objectif compétences, Tome 2, Deauville. Cité par Nathalie Richebé (2002).
[2] La liste comprend : « communication dans la langue maternelle ; communication en langues étrangères ; compétences mathématiques et compétences de base en sciences et technologies ; compétence numérique ; apprendre à apprendre ; compétences sociales et civiques.
[3] La sociologue Anne Barrère démontre que les chefs d’établissement adhèrent davantage que les enseignants à la « culture » de l’évaluation. Les chefs d’établissement se saisissent d’autant plus des chiffres produits que ceux-ci valorisent l’image de leur établissement (Barrère, 2009).
[4] Luc Boltanski et Eve Chiapello ont décrit comment la logique de projet participe du « nouvel esprit du capitalisme » (1999).






