
Effondrement ou autre futur ? Entretien avec Pablo Servigne
Tout va bientôt s’effondrer… mais nul besoin de paniquer : tel est, en substance, le message porté par Pablo Servigne et Raphaël Stevens dans leur Petit manuel de collapsologie à l’usage des générations présentes paru il y a bientôt trois ans dans la collection « Anthropocène » des éditions du Seuil. Chercheur indépendant (ou « in-terre-dépendant »), Pablo Servigne a, depuis, poursuivi son travail. Sarah Kilani revient avec lui sur un livre qui, malgré tout, fait quand même un peu froid dans le dos, tout en prolongeant la discussion vers d’autres voies.
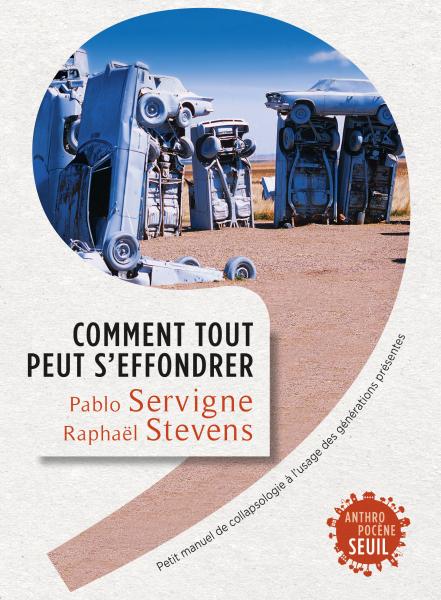
Contretemps : Malgré la critique de la croissance que vous émettez dans Comment tout peut s’effondrer[1], vous ne citez que très peu le système économico-politique qui la sous-tend : le capitalisme. Pourquoi ?
Pablo Servigne : On a voulu faire un livre qui se concentre le plus possible sur les faits. Pour moi on peut distinguer trois étapes : les causes, la situation et ce que l’on propose de faire. Concernant les causes, chacun a sa théorie et ça se chamaille tout de suite. C’est pareil pour les solutions à envisager. Nous on voulait s’accorder au moins sur le constat des faits, ce qui est au cœur du livre et que nous avons tenté d’amener de la façon la plus neutre possible, même si on n’est jamais neutre. On m’a souvent fait cette remarque concernant le capitalisme, et je comprends que c’est irritant pour ceux qui se battent pour un monde meilleur. Mais en faisant ce livre, on avait déjà l’idée de plusieurs tomes ou de plusieurs ouvrages. Ce premier opus se voulait être un dénominateur commun entre plusieurs milieux qui ne se fréquentent pas. L’objectif était de passer d’une discipline à une autre mais aussi d’un milieu à un autre. Moi je connais plutôt les milieux associatifs, militants, de l’éducation populaire ou encore le milieu académique, et instinctivement je me suis toujours méfié du milieu politique et de celui des entreprises mais je voulais quand même rencontrer d’autres personnes. On a été très surpris car on a été cité par des prêtres catholiques, par des militaires, on a été invité à l’Elysée et aussi par le MEDEF belge et suisse, par la ferme du Goutailloux de Tarnac, etc. Personnellement, je trouve ça chouette d’aller rencontrer tous ces gens pour aller capter l’air du temps.
Selon vous, le capitalisme favorise-t-il vraiment les comportements individualistes ?
Individualiste, compétitif, égoïste… On pourrait passer du temps à définir tous ces termes mais ils font tous partie d’une nébuleuse qui, pour moi, s’oppose à celle du mutualisme, de la solidarité et de l’altruisme. Deux grandes forces sont à l’œuvre : celle qui sépare les êtres vivants et celle qui les associe. C’est l’équilibre entre les deux qui m’intéresse. Une des dynamiques du capitalisme c’est la compétition, mais celle-ci n’empêche pas une association pour être plus compétitif : c’est la base de l’entreprise. Nous sommes dans un bain qui nous incite à mettre les individus et les groupes en compétition. Pour justifier son existence, en découle un besoin de montrer que le monde n’est que compétition et c’est pour ça que les théoriciens du capitalisme sont allés chercher Darwin lors de la révolution industrielle. Ils sont allés chercher dans ses idées – tout en les déformant – une justification naturelle à cette ultra-compétition. Je ne sais pas quel est l’œuf de la poule, mais on en est venu à créer une société dans laquelle le lien social est de plus en plus ténu, une société atomisée où chacun est de plus en plus individualisé et seul. On se retrouve avec un immense besoin de consolation, pour reprendre les termes de Stig Dagerman. D’ailleurs je conseille le magnifique texte de cet anarcho-syndicaliste suédois Notre besoin de consolation est impossible à rassasier. Quand le vide est créé, les grandes boites peuvent alors nous vendre de la poudre de perlimpinpin pour le combler. Ce qui marche assez bien et crée alors une boucle de rétroaction qui favorise encore l’atomisation et aggrave notre besoin de pansements. Il devient urgent de changer le sens de ces boucles de rétroaction. Dans l’idée de changer de mythologie, il y a celle de recréer du lien qui lui-même va créer d’autres histoires qu’on pourra se raconter. Nous devons recréer du sens et du lien ! C’est ce que j’essaie de faire dans mes écrits et lors de mes conférences.
Ce capitalisme s’ancre dans une vision de l’humain dans laquelle l’homme est un loup pour l’homme. Finalement, la transition ne doit-elle pas se faire davantage dans nos représentations et nos mythes avant toute autre chose ?
Tout à fait ! Je découvre cette question depuis peu, elle me passionne et nous en avons fait notre cheval de bataille. Mais mon langage c’est la science, c’est ma manière de voir le monde, de l’analyser et de le représenter. Raphael Stevens, Gauthier Chapelle et moi sommes partis d’une intuition qu’on avait, et on a utilisé tout le bagage scientifique qu’on a reçu pendant nos études. En plus, j’ai ajouté la dimension militante – j’ai milité pendant 10 ans dans le mouvement anarchiste – et l’éducation populaire. Donc moi je pars de cela, mais je n’y connais absolument rien en mythologie, en cinéma, en storytelling et c’est en lisant un peu et en rencontrant des gens que je m’initie à ce sujet passionnant. Cette intuition qu’il fallait raconter d’autres histoires sur notre futur, on l’a mis dans le livre et on a reçu plein de chouettes retours, notamment d’artistes. Puis de fil en aiguille et de rencontres en rencontres, je me documente sur ce sujet et je me rends compte qu’effectivement notre intuition n’était pas mauvaise et que le terrain de la lutte se trouve sur le terrain de l’imaginaire. De Gramsci à Sarkozy, la petite mythologie des temps modernes et son hégémonie culturelle… c’est un vrai combat ! Mais je pense qu’il faut aller au-delà de la question de l’hégémonie politique et du pouvoir. Peut-être aller creuser plus loin, dans nos mythes et dans nos inconscients. C’est ce qu’on a cherché à faire dans notre livre L’entraide, l’autre loi de la jungle[2] qui était déjà en préparation avant celui sur l’effondrement. Je le préparais depuis 10 ou 12 ans quand j’ai écrit celui sur l’effondrement — un peu à la va-vite d’ailleurs, parce qu’on m’a demandé de le faire et j’ai accepté parce que je ne comprenais pas que les gens ne sachent pas ce qui était en train d’arriver. Mais quand je me suis remis à L’entraide, j’ai ressenti une sorte de soulagement, car mon véritable objectif c’était ça, aller questionner quelque chose de très profond. Quelque part, mon activité principale c’est de prendre les gens à contre-pied dans leurs représentations et de créer des brèches. J’aime provoquer des « déclics » car moi-même j’en ai vécu des passionnants qui m’ont donné des frissons. J’ai envie de les partager.
Vous dites « pour certains sociologues, l’échange marchand n’est même pas une relation de réciprocité, car il ne contient pas les autres dimensions de l’humain : les sentiments, la confiance, la générosité, les rites ou même la dimension sacrée ». L’anthropologue David Graeber réfute cette hypothèse dans son livre sur la dette et affirme que c’est la monétisation de tous les échanges – spécificité du capitalisme – qui détruit le lien social car elle ne permet pas la création d’une dette sociale, ce ciment des sociétés…
Je suis entièrement d’accord avec lui. Il y a un gradient entre les relations profondes de don, contre-don et de réciprocité et le bête échange marchand. Dans la notion de don et de contre-don développée par Mauss et reprise ici par Graeber, il y a plusieurs dimensions : sociale, spirituelle, sacrée, fraternelle. L’échange marchand n’est qu’une seule de ces dimensions dépouillée des autres : on désacralise. C’est le minimum absolu du lien social. Cependant, pour moi, ça reste quand même un lien social. Et c’est sur ce socle minimal que s’est créé le libéralisme. Ici je reprends un peu la thèse de Michéa selon laquelle, traumatisés par les guerres de religion, les philosophes du libéralisme ont créé le système politique soutenu par le dénominateur commun le plus petit : l’échange marchand. C’est évidemment toxique quand une société ne se base que sur ça et c’est tout le propos du Mouvement anti-utilitariste en sciences sociales (MAUSS) animé par le sociologue Alain Caillé. Mais je prends tout de même David Graeber à contre-pied en disant qu’un échange marchand reste un échange, qu’il contient de la réciprocité même si elle est minimale, froide et parfois inconsciente. La relation de réciprocité ne nécessite pas toujours de l’empathie, de l’altruisme, de la spiritualité, de l’amitié ou de l’amour et alors qu’il y a de la réciprocité chez beaucoup d’espèces animales (poissons, bactéries, singes, crevettes, arbres…) on ne sait pas s’ils sont sous-tendus par tout ce que je viens de citer, mais ils font partie de cette force dont je parlais au début qui relie et associe les êtres humains. Il y a de la réciprocité chez les poissons et même de la réputation ! C’est fou ! Alors oui, on peut percevoir cette réciprocité comme minimale, tout comme l’échange marchand chez les humains. Mais l’étude globale de l’entraide comprend tout cela, depuis la réciprocité « froide » entre les bactéries jusqu’à la réciprocité très riche du don selon Marcel Mauss ou de la fraternité sacrée chère à Régis Debray.
Démonétiser les échanges pourrait être une voie politique à creuser mais je me méfie toujours des solutions uniques, des silver bullets comme disent les anglais, mais ça fait partie des chemins à explorer. Il y a beaucoup d’expériences qui ont été faites là-dessus et c’est connu en psychologie. Par exemple, chez les enfants qui ont une motivation intrinsèque à faire quelque chose, si un adulte cherche à les motiver d’avantage en leur donnant une motivation extrinsèque, comme de l’argent, et bien cela casse leur motivation intrinsèque. C’est pareil pour l’échange et l’entraide, il y a de formidables travaux en neurosciences qui montrent que lorsque quelqu’un coopère avec nous, cela déclenche des circuits neuronaux du plaisir, de la récompense et du bien-être. Et puis face à une situation d’absence de coopération cela déclenche du dégoût. Et les expériences montrent que quand c’est un ordinateur qui coopère avec nous, les circuits du plaisir ne se déclenchent pas ! Quand on casse les relations de réciprocité, on brise vraiment quelque chose qui est de l’ordre de la joie et du plaisir. Aujourd’hui, les institutions sont prises dans un tel paradigme utilitariste qu’elles commencent à monétiser l’entraide en pensant — à tort — que cela motivera les gens. Non seulement ça les démotive, mais ça contribue à véhiculer une vision du monde selon laquelle les gens ne sont finalement intéressés que par l’argent. Et c’est totalement faux ! Ce qui pousse quelqu’un à travailler, ce n’est pas du tout l’argent, le sexe ou encore la gloire. C’est le degré d’autonomie que l’on acquiert, le degré de compétence et d’expertise et le fait de participer à une œuvre qui nous dépasse, qui est plus grande que nous. Ce sont les trois choses qui font que les gens se lèvent le matin avec la pêche. Ce n’est pas l’argent. Depuis quelques années, le paradigme utilitariste qui s’institutionnalise va complètement à contre-sens. Monétiser tout, c’est vraiment tuer la société.

Photo : Sarah Kilani
Vous émettez une critique des inégalités dans votre livre de collapsologie qui selon vous aggravent la situation écologique. Comment réconcilier la question sociale et écologiste ?
Pour moi elles ne sont pas fâchées, il est évident que l’une ne va pas sans l’autre. Si on les pense séparément, on voit forcément la moitié du tableau, et donc on propose des solutions qui ne seront pas à la hauteur des enjeux, voire qui seront contreproductives. Ce qu’il faut simplement voir, c’est que la question sociale résulte du temps court et moyen, et l’écologie du temps moyen et long. Mais c’est la même démarche ! Il s’agit de vivre au mieux, ensemble, sur la même planète, le plus longtemps possible. Point barre. Pour avancer dans cette direction, et puisque je sais que vous aimez sa pensée, je reprends les mots de Spinoza : « ne pas se moquer, ne pas se lamenter, ne pas détester, mais comprendre ». Ça me convient parfaitement, et c’est la couleur qu’on a voulu donner à la collapsologie. Comprendre. Après, pour ce qui est d’agir, je pense que ce n’est pas à la collapsologie de répondre, mais plutôt alors à ce qu’on pourrait appeler la « collapsosophie », et même la « collapsopraxis ». Qu’en penserait Spinoza s’il était encore vivant ? Je pense que je lui enverrai un courriel pour lui proposer de co-écrire un livre avec lui ! [rires]
Justement, vous réfutez le concept de nature humaine que vous associez au déterminisme. Or, Spinoza, l’un des grands penseurs déterministes, ne reconnaissait pas non plus l’existence d’une nature humaine. Il prétendait qu’il n’y a que des modes d’existence, des ensembles de potentialités, dont l’expression dépend de l’environnement (au sens le plus large) dans lequel chacun évolue. Ne confondez-vous pas essentialisme et déterminisme ?
Je suis d’accord avec la vision selon laquelle les humains sont le fruit de leur environnement. Mais pas uniquement. Je pense qu’il y a quand même une part d’héritage et que nous sommes un mille feuilles dans lequel on ne peut pas distinguer l’inné de l’acquis. On hérite du patrimoine génétique de nos ancêtres mais surtout de la manière dont leur patrimoine a été façonné par leur environnement. On hérite de l’environnement de nos ancêtres. On ne peut pas expliquer tout par l’environnement, ni par le gène, indépendamment de ce qui l’entoure. C’est ce que la biologie a essayé de faire à une époque et c’est ce que les sciences sociales craignent beaucoup. Il y a une sorte de fantasme autour de la biologie. Moi dès que j’arrivais en tant que biologiste dans un milieu d’historiens, de psychanalystes, de sociologues et de philosophes, on me regardait bizarrement. Et quand je parlais de biologie voire de sociobiologie, on me fusillait du regard ou ça devenait très agressif. J’étais vu comme un essentialiste ou je ne sais quoi mais je n’ai jamais compris cette vision manichéenne des choses. Le mythe du bon sauvage de Rousseau, c’est un archétype qui n’est évidemment pas la réalité, tout comme « l’homme qui est un loup pour l’homme » de Hobbes ou encore le modèle de l’Homo oeconomicus. Ce sont des manières de caricaturer un outil philosophique pour penser le monde mais ce ne sont que des modèles incomplets. Ce qui m’intéresse, c’est de penser la complexité et toutes les nuances de gris à la fois pour la question de l’effondrement et aussi celle de l’entraide.
Quoiqu’il en soit, à de nombreux égards, votre livre sur l’entraide se pose dans une perspective spinoziste. Vous y parlez notamment de créer un futur désirable. Comment proposez-vous d’affecter joyeusement les gens afin qu’ils vous suivent sur le chemin de la transition ?
C’est une grande question qui ouvre sur une succession de dédales. D’abord il y a une sorte de prophétie auto-réalisatrice dans le fait de croire que le futur se déroulera de telle manière, ce qui va finalement nous inciter à agir dans cette direction. C’est particulièrement vrai pour le mythe de la loi du plus fort – prétendue loi de la jungle – car en y croyant on crée de la tension sociale, de la culture de l’égoïsme et de la compétition. Ce mythe est profondément ancré en nous, de manière consciente et inconsciente, et c’est assez toxique pour notre gestion des futures périodes de crise et pour tenir dans la tempête. J’ai remarqué qu’en brisant cette croyance, en créant des brèches, des fissures, des déclics, on crée des comportements de joie chez les gens qui découvrent que la nature a mis en place des systèmes d’entraide très élaborés. Le but ce n’est pas d’imiter la nature, mais de se rendre compte qu’on nous a raconté des sornettes depuis que l’on est tout petit ! Ca fait prendre du recul et déjà ça, ça fait du bien. Ca redonne du courage et ça ouvre des horizons nouveaux. Je ne sais pas de quoi la transition sera faite mais je pense que ça rend le monde un peu moins toxique. Pour prendre le contrepied de votre question, je dirais que dans les milieux de la transition, il y a parfois cette injonction à rester positif, ce côté un peu « Bisounours », un peu anti-catastrophiste. J’ai déjà entendu des proches me dire « je ne veux plus jamais entendre le mot ‘catastrophe’ ». Sauf que c’est mon métier de parler de catastrophes ! Comment je fais, moi ? Je pense qu’il y a là une sorte de déni que l’on retrouve même chez les transitionneurs, les écologistes. Pour ma part, j’essaie toujours d’avoir un pied sur les deux terrains, sombre et lumineux, et de me situer à l’interface. De toute façon on ne peut pas avoir les deux pieds dans la catastrophe car ce n’est pas viable. Il n’y a plus de joie, plus d’enthousiasme, plus d’espérance – comme disent les chrétiens, plus d’espoir – comme disent les gens proches de Pierre Rabhi, plus d’élan ou de conatus comme dirait peut-être Spinoza ! (rires)
Je remarque surtout que mes conférences font du bien, ce qui me fait plaisir et donc du bien à moi aussi. Et j’ai remarqué que ça fait autant de bien aux gens quand je parle d’effondrement que quand je parle d’entraide, je ne sais pas pourquoi.
Faut-il renoncer à la tentative de Descartes de « devenir maître et possesseur de la nature » ?
Oui évidemment et le plus tôt sera le mieux. Dans les faits, on y renonce déjà. Mais si on prend vraiment les devants, ça fera un effondrement un peu plus « doux ». Je pense que c’est une des croyances les plus toxiques car elle nous empêche de changer de direction en dépit des faits. On n’aurait jamais dû croire à cela, c’est aberrant.
Vous vous posez explicitement en faveur des théories sur la croissance démographique de Malthus, qui pourtant par ailleurs ne défendait ni plus ni moins que le darwinisme social. Que faites-vous de ses propositions de cesser toute aide aux nécessiteux (qui ont le taux de fécondité le plus élevé) ou encore de lever l’impôt sur la taille et le poids des enfants et de favoriser financièrement les couples sans enfants ?
Ça peut être effectivement dangereux de se revendiquer de Malthus mais j’ai confiance dans le fait que les personnes qui s’empareront du sujet feront la part des choses. Moi je n’ai pas lu tout Malthus, j’ai surtout lu sur lui. C’est sûr, c’est un terrain glissant mais je pense que ce sont quand même des questions à débattre et à traiter en société. Il ne doit pas y avoir de tabou.
Dans la mesure où seuls 10% des humains produisent 50% des gaz à effet de serre, pourquoi ne pas abandonner les dangereuses théories malthusiennes à la faveur de la seule défense d’un mode de vie moins consommateur en ressources et énergie ?
Parce que je pense que ça ne suffira pas. Bien sûr on doit aussi défendre un mode de vie moins consommateur mais je ne pense pas qu’il faille choisir entre les deux. Il faut tout faire en même temps. Nous avons un effort à faire sur la question démographique et personne ne sait par quel bout le prendre. Il n’y a pas vraiment d’exemple concret sympathique et intéressant de politique dénataliste. Parmi les exemples de politique du genre, il y a celui que prend Jared Diamond, l’île de Tikopia, dans son livre Effondrement[3]. Il s’agit d’habitants d’une île qui ont survécu parce qu’ils ont su contraindre leur démographie par des politiques de dénatalité assez dures. Rien de tout cela n’est très engageant. Mais justement je pense qu’il ne faut pas mettre cela sous le tapis et qu’il faut se retrousser les manches pour réfléchir à comment on peut faire. Car sinon cela va nous tomber dessus et on ne va rien maîtriser. Je pense que même si on arrive à une société sobre dans sa consommation et la plus égalitaire possible à neuf milliards d’humains, ça posera quand même des problèmes. Alors on peut dire qu’une forme de régulation a déjà commencé dans certaines zones à cause des catastrophes climatiques et du manque de ressources, mais ici, dans les pays riches, on est encore protégés par un coussin matériel très confortable.
Mais par exemple le taux de natalité en France reste très bas par rapport à la plupart des pays d’Afrique. Pour autant les Français ne peuvent décemment pas demander aux Africains qui polluent bien moins que nous d’arrêter de faire des enfants…
Non, bien sûr qu’on ne peut pas. Surtout qu’on n’a toujours pas vraiment compris le pourquoi de la transition démographique et pourquoi les riches font moins d’enfants. La plupart des gens sont d’accord avec l’idée qu’il faut commencer par réduire les inégalités. Mais OK faisons-le alors ! Pour autant, que ça ne nous fasse pas ignorer la question de notre natalité. Et elle est importante car cela pose la question des femmes, de l’éducation à la sexualité et toutes ces thématiques passionnantes qu’il faut traiter de manière systémique. Evidemment que cela ne peut se décliner sous la forme d’un gouvernement qui dirait « maintenant chacun ne peut faire qu’un enfant », ce serait horrible et inefficace. Pour autant si nous ne nous saisissons pas de ces questions, l’effondrement et les crises écologiques répondront pour nous de manière dramatique. Il y a des scientifiques qui ont fait un calcul. Ils ont mesuré l’énergie par habitant qu’il fallait à un pays riche pour mener à bien sa transition démographique. Ils ont alors calculé la quantité d’énergie qu’il faudrait pour que tous les pays du monde fassent cette transition. Et en fait il n’y a pas assez d’énergie disponible sur la planète pour ça. On n’y arrivera pas. Et la démographie de l’effondrement, si on laisse faire, ce sera une explosion de la mortalité… mais aussi de la natalité incontrôlée ! Et on va retrouver des cycles de non-contrôle qui sont classiques chez les prédateurs/proies et dans le monde vivant en général. Disons-le net, c’est effrayant.
Concernant la transition et l’énergie justement, vous êtes en désaccord avec Jean-Marc Jancovici sur au moins une chose : le nucléaire. Vous prétendez que l’énergie nucléaire est très dépendante des énergies carbonées. Pouvez-vous développer ? Pouvons-nous rendre le nucléaire indépendant des énergies fossiles à court terme ?
Malgré toutes mes recherches, je n’ai jamais trouvé de travaux sur le lien entre pétrole et nucléaire. Mais si on se base sur la logique on peut en tirer quelques éléments. Pour faire du nucléaire, que faut-il ? Du béton qui demande du pétrole pour sa production et son transport. Des ingénieurs : comment les déplace-t-on, et comment vont-ils au travail ? Grâce au pétrole. Il faut aussi des centrales électriques qui nécessitent du charbon pour être produites. Et puis il faut aller chercher l’uranium, il faut donc une armée pour aller au Niger ou ailleurs. Or on ne sait plus faire d’armée sans pétrole. Il faut sécuriser le transport et l’acheminement des déchets nucléaires, ce qui demande du pétrole et c’est pareil pour les fûts. Comment on fait les fûts sans pétrole? Pour extraire les minerais pour les produire on utilise de l’énergie carbonée ! Tout le système industriel, nucléaire et les énergies renouvelables comprises, sont hautement dépendants du pétrole. Les panneaux photovoltaïques à base de silicium et tout le reste, c’est d’une manière ou d’une autre du pétrole et du charbon. Alors est-ce que le nucléaire peut survivre sans pétrole ? Aujourd’hui il est clair que non. Et le problème le plus important c’est que si demain on a une rupture d’approvisionnement en pétrole, on ne pourra pas éteindre et refroidir les centrales nucléaires. Attention, je ne parle même pas de les démanteler mais juste de les éteindre. Car je ne vous dis pas le budget, l’énergie et les humains qu’il faut et qu’on n’aura clairement pas pour démanteler les 430 réacteurs construits dans le monde. Mais déjà simplement pour refroidir une centrale il faut 6 mois. Et donc il faut de l’électricité pendant tout ce temps avec des ingénieurs qui viennent en voiture, sont payés, ont confiance en la société.- il faut une stabilité politique pour éteindre une centrale – tout ça juste pour arrêter le système nucléaire ! Et personne n’accepte de répondre à cette question parce que personne ne sait y répondre. Et à côté de cela, il est intolérable d’avoir des déchets dont l’échelle de vie dépasse celle des humains ou encore celle de la politique. On sait qu’il y a un risque terroriste et personne ne peut garantir sur un million d’années l’absence de risque terroriste ou la stabilité politique ni même celle des civilisations. Nous n’avons que des visions à court et moyen terme dans notre organisation politique et c’est incompatible avec le long terme. Le climat et le nucléaire sont les deux choses de long terme qu’on a touchées, déréglées, qu’on ne maîtrise pas et qui sont potentiellement des facteurs de disparition de l’humanité, voire de la majorité des espèces sur Terre. Cela nous dépasse totalement et c’est pour ça que je pense qu’il faut non seulement stopper tout, mais en faire quelque chose de sacré. Certains parlent de faire des temples comme Isaac Asimov dans le cycle de Fondation[4], et d’avoir des sortes de prêtres qui s’occuperaient de ces centrales. Peut-être qu’un jour on sera obligé de faire ça. Mais ce qui est sûr c’est qu’on ne peut pas laisser cette question uniquement aux ingénieurs.
Aujourd’hui la permaculture, que vous défendez comme voie de transition, souffre d’une image très dépolitisée, véhiculée notamment par des gens comme Pierre Rabhi qui élude totalement la dimension politique de la permaculture et prône la transformation individuelle et l’abandon des stratégies collectives et militantes. Il qualifie notamment les manifestations de « quelques heures à rendre la vie impossible à ceux qui m’entourent« . Pensez-vous que les permaculteurs doivent s’organiser en une force politique ?
Il y a une vision froide qui consiste à dire que c’est bien que la permaculture se répande dans tous les milieux, de la gauche aux fascistes en passant par les prêtres et jusqu’aux toits du ministère de l’Intérieur. Ca reprend la vision stratégique de Rob Hopkins, du mouvement de la transition. Il est né en Angleterre, c’est un OVNI politique pour nous les francophones, car c’est totalement dépolitisé. En réalité, il est très politique et il le sait, mais il refuse toute étiquette car il ne veut pas que ça paraisse politique. Pour lui c’est une stratégie parce qu’il refuse le cloisonnement et la lutte. On est dans le même bateau et plus on est nombreux, mieux c’est. C’est effectivement très gênant pour beaucoup de personnes. J’ai fait de l’éducation populaire à Liège, pendant quatre ans nous avons développé le thème de la Transition. Et la critique que l’on recevait constamment était justement ce côté apolitique, que ce n’était pas un mouvement qui s’emparait du social et des inégalités. Moi je le faisais ailleurs, mais dans le mouvement de la Transition, la stratégie était de ne pas le faire. J’ai trouvé ça assez malin au début et puis j’en suis revenu. Je pense qu’il faut affirmer une éthique – comme le fait la permaculture, qui n’est pas neutre — et y aller de manière offensive. Je pense qu’il faut une véritable contre-offensive et sans promettre qu’on sera totalement non-violent. On essaie mais on ne promet pas. Je pense qu’il y a vraiment un front de lutte, par exemple à Notre-Dame-des-Landes ou dans d’autres ZAD – qui sont à soutenir. Mais tout cela n’exclut pas le côté trop gentil qu’on peut trouver chez les agro-écologistes, ou dans le mouvement des Colibris. Parce qu’ils ont aussi un chemin qui est intéressant, celui de « méditants », et avec des amis on parle de réconcilier le méditant et le militant. Parce que les deux existent en chacun de nous et je pense que les deux se nourrissent l’un l’autre. Si tu n’as que le côté militant, tu risques de te briser et de créer du cynisme. C’est très dur de militer, on a besoin de force, on a besoin de s’ancrer pour avoir l’énergie d’aller défendre les ZAD. Et d’un autre côté, on ne peut pas se contenter de juste méditer. Parce que quand la vie est détruite ou qu’une forêt est rasée, il y a des luttes à amorcer. Mais c’est parfois mal compris. Par exemple, j’aime bien ce que dit Pierre Rabhi, mais ce n’est pas complet. Mon attitude serait plutôt de dire qu’il faut compléter plutôt que rejeter. Mais j’entends bien la critique.
Pour revenir à la permaculture, si on suit bien les trois principes éthiques, on ne peut qu’aller dans les ZAD et n’importe qui ne peut la pratiquer. Et les douze principes de design de la permaculture, ça vous politise automatiquement ! Il y a un grand mouvement de permaculture humaine, qui travaille à l’organisation des groupes, là aussi avec de sérieux écueils dans la sociocratie, l’holocratie, toutes ces techniques de gouvernance où on retrouve le côté technocratique du management qui vient s’immiscer dans la permaculture. Mais il y a quand même de belles découvertes, il ne faut pas jeter le bébé avec l’eau du bain. C’est en train de se politiser et je pense qu’il manque très peu pour que ce soit un mouvement qui prenne conscience de lui-même et qui s’affirme. Finalement, c’est toujours le problème du mot « politique », tout dépend de comment on l’entend. Si l’histoire c’est de faire un parti politique, je ne suis pas d’accord. D’ailleurs je regrette qu’on ait fait un parti écologiste il y a 40 ans, c’était une très mauvaise stratégie.
Parce que comprendre qu’il y a une limitation des ressources ne définit en rien une politique. On peut en tirer des conclusions diamétralement opposées. Or on voit émerger ici et là le concept de « dictature verte ». Pour ses promoteurs, mieux vaut une dictature qui prend les bonnes décisions qu’un suicide collectif.
J’ai souvent entendu ça oui. Même si je comprends le réflexe, je trouve cela terrible. Mais la question est comment fait-on pour éviter cet écueil – que certains pensent incontournable. Ils prétendent que si on ne fait rien c’est parce qu’on est en démocratie et qu’il faut en arrêter avec elle. Pour moi il n’y a qu’une seule option. Il faut aller vers plus de démocratie, un peu comme le propose Hervé Kempf pour qui nous sommes davantage en oligarchie qu’en démocratie. Et il faudrait plutôt se tourner vers la voie de Illich, Schumacher et Kohr[5] qui proposent avant tout de réduire les échelles. C’est ça la clé. Je pense sincèrement comme Ernst Schumacher et Léopold Kohr et tous les penseurs de la convivialité et des limites que tous les systèmes sont bons mais qu’à partir d’une certaine taille ils deviennent immanquablement mauvais. Pour moi si une dictature apparaît c’est qu’il y a un problème d’échelle. Après, cela ne nous dit pas quel mode d’organisation il faudrait pour notre culture, et la question reste ouverte.
Alors que vos propositions sont très proches des idées libertaires, vous ne parlez jamais de propositions d’organisations anarchistes et écologistes comme par exemple le municipalisme libertaire de Murray Bookchin. Vous citez plus volontiers les convivialistes. Pourquoi ?
Il y a deux aspects que j’ai bien aimés chez les convivialistes : le côté transdisciplinaire ouvrant des champs scientifiques et le côté convivial appliqué à la politique malgré des aspects souvent trop théoriques. Alors pourquoi pas plus d’anarchistes? Pendant dix ans j’ai milité avec les anarchistes, j’ai écrit plein d’articles qui ne sont jamais lus. Je voulais sortir un peu de ce petit milieu. Je pense que j’ai eu peur d’être trop marqué et étiqueté. Par exemple la maison d’édition, Le Seuil a une image « neutre », disons universitaire, et c’était volontaire. Les liens qui libèrent ont une image un peu plus engagée, mais ça reste grand public. J’ai déjà pensé publier dans des maisons anarchistes mais je voulais d’abord ouvrir le champ des personnes touchées et ne pas parler qu’aux gens attachés à l’étiquette anarchiste. Et j’ai toujours en tête de faire un bouquin spécifiquement sur entraide et anarchisme ou transition et anarchisme. Si un jour ça arrive, je le revendiquerai et je publierai dans une maison de copains. J’ai voulu être discret mais sans me renier, ce qui est un équilibre délicat. C’est aussi une question de stratégie.
Vous dites que la complexité des grands groupes humains ne favorise pas la résilience et qu’il faut fonctionner en « petits groupes bien proportionnés ». Renoncer à la centralité de la nation ne se fera-t-il pas au prix de guerres en renforçant les rivalités par la multiplication du nombre d’ennemis potentiels ?
Oui c’est un risque à prendre, mais je pense qu’on gagnerait quand même beaucoup à réduire les échelles et avoir plus de petits groupes structurés de manière horizontale et décentralisée. Ça réduit à la fois les risques d’industrialisation de la violence et dans le même temps, ça nous ferait revenir à des principes plus proches de l’organisation du vivant. Depuis 3,8 milliards d’années le vivant n’a pas sélectionné les organisations hiérarchiques pyramidales. Ça n’existe pas. Parce qu’elles sont peut-être très efficaces à un moment donné, comme dans une entreprise ou dans l’armée, mais elles sont très peu résilientes aux changements de milieu et d’environnement. Donc si on veut perdurer et s’inscrire dans le temps long, en tant que sociétés humaines, il faut revenir à de plus petites échelles, décentralisées. L’organisation pyramidale ne peut que se casser la figure, parce que notre milieu est en train de changer.
L’une des échelles que vous proposez est celle des bio régions…
Oui. Je n’ai pas encore totalement creusé la question mais c’est ce qui me semble le plus logique et c’est ce qui colle avec l’idée de permaculture. Alberto Magnaghi en parle bien, et c’est à tester. De toute façon, plusieurs systèmes politiques vont émerger avec les déstructurations qui arrivent. On ne peut pas dire « il faut tous faire ça voici le petit livre qui dit comment faire ». Ça va émerger, il y aura des bifurcations, de l’imprévisible et ça réussira ou pas. Ma vision des temps politiques qui arrivent c’est qu’il y aura des tas de « jeunes pousses ». Lorsqu’un grand arbre s’effondre, il faut cultiver la diversité des jeunes pousses qui viendront le remplacer. Ce qu’on a du mal à concevoir aujourd’hui, c’est qu’il faut de la diversité et du dissensus, c’est-à-dire des pousses qui partent dans des sens contraires. Il faut cultiver le fait que certains aient envie de prendre des chemins différents. C’est la diversité qui crée la résilience. Parce que même si vous trouvez LA solution géniale, la meilleure pour 2020, il se peut qu’en 2030 elle ne soit pas du tout adaptée, et on se sera coupé de toutes les potentialités des autres jeunes pousses… C’est compliqué aujourd’hui car notre système politique ne cultive pas du tout ça. Au contraire, avec l’austérité on coupe tout ce qui dépasse, on enlève les mauvaises herbes et tout le monde doit rentrer dans le rang. C’est très toxique à long terme. Là, je reste un peu flou mais pour avoir côtoyé pas mal d’années les théories politiques du XIXe et du XXe siècle, l’anarchisme, le communisme, de toutes ses branches et courants, je me dis qu’il y a quand même beaucoup de choses que l’on peut reprendre pour aller inventer de nouveaux trucs. Il y a donc un gros travail théorique, en lien avec ces mouvements, qui serait passionnant à faire, pour relier anarchisme et anthropocène. Ça revivifierait cette pulsion libertaire à la lumière de ce qui arrive aujourd’hui. Et ce n’est pas du tout le même contexte que Kropotkine ! S’il vivait encore, il ne ferait pas les mêmes bouquins. C’est en ça que le convivialisme est intéressant car ce qu’il propose c’est de prendre le meilleur de l’anarchisme, du communisme, du socialisme et du libéralisme, de prendre conscience de leurs défauts respectifs, et d’essayer de faire une synthèse. On ne sait pas si ça va marcher mais rien que la tentative est intéressante intellectuellement.
Le peu de réactivité de nos gouvernements face à l’effondrement doit-il nous faire prendre la voie de la désobéissance civile ?
Ça fait longtemps qu’on y est entré et il faut continuer. Personnellement j’adore le concept de ZAD. Je respecte, je soutiens, je participe et j’espère qu’ils vont tous réussir. Mon adhésion n’est pas qu’intellectuelle, elle est profonde. Pour moi ça fait partie de cette diversité des jeunes pousses et des mauvaises herbes dans les fissures du trottoir qu’il faut cultiver parce qu’à un moment, il n’y aura plus de trottoir et après le trottoir il faut voir venir la forêt. Si on ne cultive pas les mauvaises herbes, il y a un risque qu’il n’y ait pas de forêt. Ce que j’aime aussi dans les ZAD c’est le choc de l’imaginaire. Finalement, les ZADistes et ceux qui défendent la croissance et l’emploi, ils ont tous les deux raison, les deux camps ont leur logique, mais ils n’ont pas les mêmes imaginaires. Et la confrontation des deux est intéressante.
Dans ce genre d’expérience, comment maintenir le collectif et ses intérêts communs tout en maintenant l’autonomie individuelle ?
Il y a déjà la question de redevenir compétent en coopération. C’est-à-dire être capable d’expliciter les règles du groupe, comment apprendre à en créer un, etc. Et puis il y a celle de la taille du groupe. Si la taille du groupe nous dépasse, il y a des phénomènes qui nous dépassent qui se mettent en place et qui écrasent l’individu. Mais comment fait-on pour limiter la taille des groupes? Ce n’est pas un problème encore résolu. Pour moi c’est une question que l’on retrouve au croisement de tous les maux sociaux et politiques. C’est ce que j’aime bien avec l’anarchisme, c’est qu’on a constamment cette tension entre individu et collectif. On vit ce paradoxe. Dans les groupes communistes que j’ai fréquentés, ça allait toujours trop d’un côté et chez les libéraux ça va toujours trop de l’autre. L’anarchisme, lui, vit de ce paradoxe et il est riche et fertile parce qu’il y a différents courants qui maintiennent cette tension.
Une dernière question : votre livre sur l’entraide peut laisser penser que vous êtes antispéciste. Est-ce le cas ?
Je me suis aussi posé la question et je crois malheureusement que oui (rires). Depuis tout petit, je ne supporte pas qu’on fasse du mal à des animaux, pour autant, je ne suis pas végétarien. Je vis avec ce paradoxe. Je n’aime jamais être catégorisé et étiqueté mais je me sens proche des antispécistes. Je peux me sentir en profonde fraternité avec des oiseaux, un écureuil et même une bactérie ou un lichen. Mais j’aurais envie de chasser, par curiosité, pour comprendre la sociologie de la chasse, mais je ne sais pas si je pourrais tirer. Ce n’est pas une question confortable. Je suis flexitarien, paraît-il, je ne mange que de la viande bio et locale dont je connais la provenance et le moins possible, peut-être une fois par semaine. Mais je n’y ai pas renoncé totalement. Un Amérindien qui tue un animal pour se nourrir, je ne peux pas lui en vouloir. Nos ancêtres qui ont vécu pendant les glaciations pendant des centaines de milliers d’années, étaient des trappeurs. Mais je suis d’accord avec tous les arguments végétariens : la santé, l’éthique, l’écologie, les inégalités d’accès dans le monde. Et je ne sais pas dans quelle mesure je considère qu’il y a une hiérarchie dans les espèces. Déjà, je suis toujours gêné avec la notion de hiérarchie. Par exemple, c’est bête hein, mais j’ai toujours été gêné avec l’idée de mettre de l’eau de Javel dans les toilettes et de buter toutes ces populations bactériennes. Je sais depuis longtemps que dans ces populations, il y en a 99,9% qui sont neutres, et peut-être 0,1% qui sont toxiques… et 0,1% qui sont bénéfiques ! Et nous on bute tout. Ça paraît fou d’un point de vue écologique et au niveau des principes du vivant, c’est tout simplement nul. C’est même contre-productif d’ailleurs, on voit bien dans les hôpitaux les infections liées à des germes résistants aux antibiotiques qui émergent parce qu’on fait le vide. Moi j’aurais plutôt tendance à rendre sacré tout le vivant, quoique ça reste encore une solution trop simpliste… Il faudrait prendre en compte la notion de limite et de territoire. Par exemple quand un moustique me pique, il viole mon intégrité, mon territoire, et je le tue, ça ne me pose pas de problème. Si le moustique est là, sur le mur et qu’il ne m’approche pas, je vais le laisser tranquille. Entre les félins, le territoire, c’est pareil. Il peut y avoir de la compétition, de la colère et de l’agression, même chez les humains, ça sert à poser les limites du territoire. Si quelqu’un vient se frotter à moi ou m’insulte, il y a un moment où ça me met en colère, et c’est normal. Et je ne vais pas empêcher le lion de tuer un animal qui sera son repas. Mais globalement, je me sens en sécurité avec tous les êtres vivants, c’est comme ça.
Propos recueillis par Sarah Kilani.
Notes
[1] Pablo Servigne et Raphaël Stevens, Comment tout peut s’effondrer. Petit manuel de collapsologie à l’usage des générations présentes, Paris, Le Seuil, collection Anthropocène, 2015.
[2] Gauthier Chapelle et Pablo Servigne, L’Entraide. L’autre loi de la jungle, Paris, Les Liens qui Libèrent, 2017.
[3] Jared Diamond, Effondrement. Comment les sociétés décident de leur disparition ou de leur survie, Paris, Gallimard, 2009 [1ère édition française en 2006]. Pour une critqiue de ce livre, voir l’article de Daniel Tanuro et les débats qu’elle a suscités, « L’inquiétante pensée du mentor écologiste de M. Sarkozy ».
[4] Isaac Asimov, Le cycle de Fondation, Paris, Gallimard, 2000 (plusieurs volumes).
[5] Voir par exemple à ce sujet Ivan Illich, « La sagesse de Leopold Kohr », 1994.





![Écologie, nature et extrêmes droites : entre carbofascisme et écofascisme [Podcast]](https://www.contretemps.eu/wp-content/uploads/Exxon_Mobil_oil_refinery_-_Baton_Rouge_Louisiana-150x150.jpg)



