
À lire : un extrait de « Les balles du 14 juillet 1953 » de D. Kupferstein
Daniel Kupferstein, Les balles du 14 juillet 1953. Le massacre policier oublié de nationalistes algériens à Paris, Paris, La Découverte, 2017.
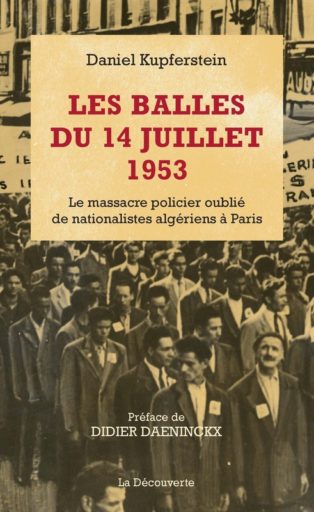
Le 14 juillet 1953, plusieurs milliers de militants du Mouvement pour le triomphe des libertés démocratiques (MTLD), le parti nationaliste algérien, participent en fin de cortège aux traditionnelles manifestations syndicales. Place de la Nation, la situation se tend et les policiers tirent et tuent six manifestants algériens et un militant de la CGT, tandis que des dizaines d’autres sont blessés par balles. Pendant un demi-siècle, ce massacre est effacé des mémoires et des représentations, en France comme en Algérie.
Pour comprendre les raisons de ce drame et de son occultation, Daniel Kupferstein a conduit une enquête de quatre ans dont il a tiré un film Dissimulation d’un massacre (2001) et le livre qu’il publie cette année à La Découverte : Les balles du 14 juillet 1953. Le massacre policier oublié de nationalistes algériens à Paris dont nous publions ici le cinquième chapitre.
L’organisation du mensonge d’État
Le soir du drame, la Préfecture de police de Paris, en accord avec le ministère de l’Intérieur, publie un communiqué qui argumente la « légitime défense » :
« Les Nord-Africains entendirent poursuivre leur manifestation sur le cours de Vincennes. […] 2 000 Nord-Africains se saisissant de toutes sortes de projectiles […] et certains armés de couteaux, attaquèrent avec sauvagerie le petit nombre d’agents présents. […] Brusquement cernés et en état de légitime défense, quelques agents durent faire usage de leurs armes. »
Cette justification du drame est aussitôt reprise dans certains journaux. Ainsi, dès le 16 juillet, on peut lire les témoignages de plusieurs policiers :
« On a vu les Arabes, brusquement saisis de fureur, se jeter sur nous. J’ai été entouré par des agresseurs et renversé et assommé. Comment se défendre contre eux ? Ce sont des brutes, mais des brutes surexcitées par des provocateurs… » Un autre : « Alors, il faudrait se laisser piétiner par ces gars-là et sans répondre ? » L’agent de police Maurice Marlet, blessé ce jour-là, affirme : « Je peux témoigner que mes camarades et moi-même n’avons usé d’aucune violence pour disperser les Nord-Africains. […] Visiblement, ces manifestants étaient organisés pour l’attaque. »
Et toutes les notes que j’ai pu retrouver dans les archives de la police vont dans le même sens.
Le faux argument de la « légitime défense »
Le mensonge d’État commence dès les premiers rapports officiels des commissaires présents sur les lieux du massacre. André Bondais, commissaire du quartier Chaillot, écrit ainsi le jour même : « Armés de bouteilles, de barres de fer, de morceaux de bois et de couteaux, les Nord-Africains frappèrent sans relâche mes gardiens, auxquels s’étaient joints les effectifs de mon collègue Giraud venus en renfort. J’entendis à ce moment-là plusieurs coups de feu, mais je n’ai vu personnellement aucun gardien se servir de son arme. » Ce que précise toutefois Robert Giraud, commissaire de police de Courbevoie : « Absolument submergés par le nombre, nous dûmes nous replier rapidement. J’entendis à ce moment-là des coups de feu en provenance des émeutiers. Il apparaît donc que les bagarres de ce jour ont pris le caractère d’une véritable émeute. Les participants se sont trouvés immédiatement armés soit de projectiles divers, soit d’armes par nature, pistolets ou couteaux. » Jean Robic, commissaire principal du XVIIe arrondissement, confirme les « coups de feu » :
« Je précise qu’au moment où je réussissais à rejoindre mes collègues au début de l’affaire, sous une pluie de projectiles, j’ai nettement perçu derrière moi, donc des rangs des manifestants, plusieurs coups de feu. J’ai d’ailleurs appris qu’un gardien avait été blessé par balle. J’ajoute qu’au cours de nos mouvements de repli, j’ai entendu de nouveau des coups de feu, dont plusieurs provenaient certainement des rangs des Nord-Africains. »
Dès le 14 juillet, les conclusions du commissaire divisionnaire Henri Fouillard, qui dirigeait les opérations assisté des commissaires Bondais, Giraud et Robic, sont encore plus limpides : « Le cortège des Nord-Africains a délibérément cherché à créer des actions d’une rare violence contre le service d’ordre, sans aucun motif. Cette opération apparaît comme ayant été concertée à l’avance et exécutée par la troupe de choc des manifestants nord-africains. » Et, le jour même, le directeur des services de la police municipale envoie au préfet un premier rapport, où il est écrit sans détours :
« Quatre-vingt-dix-huit policiers blessés, dont un par balle : le gardien Ladoue. […] Deux voitures de la police incendiées et une détériorée. […] Le caractère de cette agression soudaine et imprévue, en même temps que d’une rare violence, a révélé l’expression d’un fanatisme politique exaspéré. […] Cette opération apparaît comme ayant été concertée à l’avance, et exécutée par la troupe de choc des manifestants nord-africains. »
Les jours suivants, des rencontres ont lieu entre policiers et gradés pour préciser la version officielle de l’action de la police. Tous les comptes rendus des hommes présents sur les lieux du massacre renforceront l’idée de la préméditation et de la légitime défense, comme celui du commissaire Bondais :
« J’ai réuni le 17 juillet, au bureau du VIIIe arrondissement, quelques gradés et gardiens ayant fait partie des effectifs placés sous mes ordres, à l’occasion de la manifestation de la Bastille à la Nation, afin de leur faire préciser dans quelles conditions des coups de feu ont été tirés lors de notre intervention. »
Le 18 juillet, un rapport détaillé effectué par des gradés et envoyé au directeur des services précise donc :
« Deux cent quarante-sept fonctionnaires ont été entendus, il n’en reste qu’une vingtaine à entendre, sauf les absents par blessure ou en congé. Sous réserve de mise au point nécessaire, il ressort de ces auditions que les premiers coups de feu seraient partis d’un groupe de Nord-Africains réfugiés à la terrasse d’un café à l’angle de l’avenue du Trône et de la place de la Nation (fait affirmé par plusieurs gardiens). Un Nord-Africain a été signalé comme étant embusqué derrière la colonne du Trône, côté boulevard de Charonne, armé d’un pistolet à barillet ; des gardiens l’ont vu tirer sur le service d’ordre en avançant. Le gardien Lucien Lainé l’a vu s’affaisser, le gardien Jules Chatelard a vu cet Algérien allongé dans le caniveau tenant encore un revolver, le gardien Charles Jacques précise qu’il était vêtu d’un costume gris. […] Cinq gardiens ont reconnu avoir tiré avec leur arme. Ils fournissent des arguments établissant qu’eux ou leurs collègues blessés se trouvaient en danger. »
À la lecture de ces premières auditions, l’unanimisme des affirmations des représentants des forces de l’ordre est pour le moins troublant. Presque tous ont « tiré en l’air » : Alphonse André a tiré deux coups de feu en l’air. Marcel Sénéchal, un coup de feu en l’air. Robert Pinguet, trois coups de feu en l’air. Louis Cozilis, plusieurs coups de feu en l’air. André Sallès, une seule balle en l’air. Léonce Morot, sept balles en l’air. Seuls deux policiers avouent avoir tiré mais sans visée précise : Jean Bourcier, quatre balles depuis un car ; et Henri Brunelles, deux balles. Seize policiers ont vu leurs collègues tirer… en l’air ou par terre. On se demande comment les Algériens tués et blessés ont pu recevoir des balles dans le cœur, dans la tête, dans le ventre…
Le plus surprenant, c’est qu’un très grand nombre de policiers vont affirmer qu’ils ont vu des Algériens leur tirer dessus. Yves Toussaint « a remarqué un Nord-Africain tenant un pistolet et en faire usage boulevard de Charonne ». Jean Vidal « a vu un Nord-Africain caché derrière une vespasienne tirer sur le service d’ordre ». Charles Jacques « a vu un Nord-Africain faire usage d’un revolver de fort calibre à plusieurs reprises ». Noël Massoir, inspecteur principal, « a vu un Nord-Africain qui a déchargé à plusieurs reprises son pistolet sur des gardiens ». Marcel Laillier « a vu un Nord-Africain faire feu avec un pistolet boulevard de Charonne ». René Frezal « a vu un Nord-Africain, âgé d’une trentaine d’années, caché derrière une vespasienne faire usage de son arme à fort calibre ». Enfin, Michel Salley a fait la même déclaration que celle de René Frezal. Il a utilisé exactement les mêmes mots !
D’autres policiers vont affirmer avoir vu des Algériens avec une arme. Ainsi Henri Simon a vu « un Nord-Africain tenant un pistolet ». Victor Pontel remarque « deux Nord-Africains tenant chacun un pistolet de fort calibre ». Jean Gasparini fait une relation entre deux Nord-Africains tendant le poing et le claquement simultané de coups de feu ». Henri Maccagno a vu « un Nord-Africain qui tenait un objet qui devait être un pistolet ». Pierre Dupuis affirme sans sourciller : « Un Nord-Africain me visait et j’ai entendu des balles siffler à mes oreilles. » Henry Piney dit « qu’un témoin lui a signalé qu’un Nord-Africain était armé ». Même chose pour Rémy Cambronne : « Un passant est venu me dire qu’un homme, caché derrière la colonne du Trône, était armé d’un revolver à barillet. » Serge Marinier précise : « Un Nord-Africain tenait un pistolet genre 7,65. » René Aubrée parle d’un « Nord-Africain avec un pistolet vêtu d’un complet bleu et qui avait une forte corpulence ». Louis Besnier voit quant à lui « un Nord-Africain blessé porteur d’un revolver à barillet ». Roger Duret évoque lui aussi « un Nord-Africain porteur d’un revolver à barillet ». L’argument du « Nord-Africain porteur d’un revolver à barillet » semble d’ailleurs très commode, puisque les gardiens, Jean Coulardot, Francis Merlin, Gérard Auvé, Jean Delattre, Jules Chatelard, Lucien Lainé font exactement la même déclaration. Toutes ces auditions n’ont pas été recueillies par des juges ou par des enquêteurs, mais par d’autres policiers. D’où la forte suspicion de fabrication du mensonge d’État. Enfin, cinquante- cinq policiers affirment « avoir entendu des coups de feu qui venaient du côté des manifestants ou du côté de la place de la Nation », là où se trouvaient les Algériens. Cinquante-cinq…
Les (fausses) minutes de la manifestation selon la police
L’historienne Danielle Tartakowsky analyse ainsi cette « réécriture-autocensure » de la police municipale à partir de la « main courante spéciale » que ses responsables ont renseignée au fil des événements :
« Lorsqu’on lit dans les archives de la police les comptes rendus des commissaires, ils font état de l’arrivée des militants algériens d’une violence extrême, ils parlent d’armes, de couteaux. Mais, quand on lit bien ces minutes écrites par ces commissaires postés sur la manifestation, on ne trouve aucune mention du moment où les coups de feu sont tirés. Et ils parlent d’Algériens armés, alors qu’on ne retrouvera jamais ces armes. Or il est bien évident que ces commissaires sont sur le terrain, en liaison permanente avec la préfecture et le ministère de l’Intérieur. La main courante ne fait d’abord état, minute après minute, d’aucun mort sur le terrain, même si elle dit bien qu’il y a une violence extrême et des blessés. Puis, d’un seul coup, elle évoque des rapports à l’hôpital et on se retrouve avec sept morts… »
De fait, la lecture de cette main courante, consultable (sous dérogation) dans les archives de la Préfecture de police de Paris, ne peut que laisser perplexe. Citons-en les principaux éléments.
« 17 h 10. – Le commissaire Bondais demande des renforts, il est aux prises avec 2 000 manifestants. Il y a des blessés, quatre cars sont envoyés sur les lieux. […]17 h 15. – Un groupe de manifestants, parmi lesquels on a vu des Nord-Africains, paraît avoir attaqué le service d’ordre. Les services de M. Bondais sont aussitôt renforcés par M. Robic. Des contacts violents se sont produits. La dispersion est en cours. […]
17 h 20. – Envoyé d’urgence des renforts cours de Vincennes angle boulevard de Charonne. […]
17 h 35. – Le gardien Sallès a été transporté à la Maison de santé [des gardiens de la paix] pour blessure par coups de couteau. Les manifestants ont mis à feu une camionnette stationnée près de la colonne du Trône. […]
17 h 37. – Cent vingt gardiens ne sont pas suffisants. Envoyez le maximum de renforts cours de Vincennes-boulevard de Charonne dont des éléments de la Garde républicaine.
17 h 45. – Deux cars P45 sont endommagés et une voiture des services techniques (de la police) incendiée. La place est évacuée. […]
18 h 45. – Un des gardiens a été blessé par balle et a regagné son domicile.
18 h 47. – Le gardien M. Cormailles a été mis en observation à la Maison de santé.
18 h 50. – Le gardien Barras a été amené à l’Hôtel-Dieu. Il est en salle d’opération. […]
18 h 55. – Un Nord-Africain, blessé par balle et transporté par un particulier, serait décédé à l’Hôtel-Dieu : il s’agit de Bacha Abdallah.
19 h 28. – Tous les commissaires et chefs de secteur doivent rejoindre immédiatement la salle de conférences de la police municipale de la Cité pour rapport spécial.
19 h 50. – Quatre-vingt-un gardiens ont été conduits à la Maison de santé et dix-huit d’entre eux ont été admis. Les autres ont regagné leur domicile.
20 h 15. – Treize manifestants transportés par des particuliers ont été amenés à l’hôpital Saint-Louis. Deux d’entre eux sont décédés : Maurice Lurot et Draris Abdelkader.
20 h 30. – Deux personnes, Marie-Anne Bruneau, cinquante ans, et Mme Léaune née Chapuis, cinquante-six ans, ont été conduites au poste pour propos désobligeants envers les gardiens.
21 h 15. – Cinq manifestants ont été amenés à l’hôpital Tenon par des particuliers, deux sont décédés : Tahar Madjène et Larbi Daoui.
22 h 15. – Deux manifestants sont décédés à l’hôpital Saint- Louis : Tadjadit et Illoul. »
Danielle Tartakowsky poursuit ainsi son analyse critique de cette étonnante « main courante spéciale » :
« C’est quelque chose d’assez ahurissant, parce que quelquefois on fantasme sur les archives, sur le thème : “On nous cache tout, on nous dit rien.” Mais dans ce cas, les archives sont là, minute par minute. Elles disent d’abord qu’il n’y a pas de morts ; puis, d’un seul coup, à partir de 18 h 55, il y a des morts. Et, entre les deux, on ne sait pas ce qui s’est passé. Bien entendu, on n’aura jamais le texte d’un préfet de Paris qui dirait : “Tuez-les tous !” Mais il est impensable que ce préfet ignore qu’il y a eu un premier mort, puis un deuxième et, enfin, sept morts dans Paris ! Toutes ces archives, parfois complexes, ne donnent pourtant aucune trace de cette information. Or on sait que la police est, depuis le préfet de police de Paris Jean Chiappe (1878-1940), bien organisée : elle sait parfaitement empêcher des manifestants d’atteindre un lieu donné. Il peut y avoir un accident, une “bavure”, mais sept morts à Paris qui auraient été “ignorés”, cela n’est pas pensable. »
La hiérarchie policière justifie pourtant le massacre au nom de la légitime défense. Et le ministre de l’Intérieur, Léon Martinaud-Déplat, s’empare de cette justification pour répondre à une séance d’interpellation du gouvernement deux jours plus tard, à l’Assemblée nationale. Cependant, lors de ces débats, les Algériens ne furent pas accusés d’avoir utilisé des armes à feu, comme me l’a dit Emmanuel Blanchard :
« La mise en cause sur ce point resta métaphorique : “Ils avaient la haine dans les yeux, et si leurs yeux avaient été des mitraillettes, nous aurions tous été tués”, fut ainsi la formule reprise par le ministre de l’Intérieur citant un des gardiens engagés ce jour-là ! Cela dit, alors que depuis la Libération la police parisienne n’utilisait jamais les armes pour disperser les cortèges, les sept morts du 14 juillet 1953 n’occasionnèrent pas véritablement de remous internes. Même le principal syndicat des gardiens, le Syndicat général de la police parisienne (SGP), plutôt classé à gauche, passa sous silence ces victimes. »
À l’Assemblée nationale, le 16 juillet 1953
Deux jours après le massacre, a lieu une séance d’interpellation du gouvernement à l’Assemblée nationale (la dernière avant les congés). Les interventions de certains députés lors de ces débats sont révélatrices, comme me l’a expliqué Maurice Rajsfus :
« Ces débats à l’Assemblée nationale ont été immondes. Les députés de droite intervenaient sur la présence des Algériens en France sur le mode : “Foutez-les dehors !” C’était terrifiant, car c’était quand même en 1953, c’est-à-dire huit ans après la fin de la guerre. On peut citer par exemple Raymond Dronne, un des libérateurs de Paris – le capitaine Dronne avait été l’un des premiers arrivés à Paris le 25 août 1944 avec les chars de la division Leclerc. Il était devenu député et il a fait remarquer l’“ampleur du problème social constitué par la présence en France de trop nombreux Nord- Africains”. Quant au ministre de l’Intérieur, il osa dire que “les envois mensuels d’argent de leurs camarades qui sont déjà en France et que la famille reçoit paraissent montrer une source d’aisance”. C’est extraordinaire ! En d’autres mots : ces gens-là sont surpayés, ils nous ruinent. André Liautey affirma quant à lui : “Je souhaiterais que le maintien de la citoyenneté française accordée depuis la Libération fût subordonné à une demande souscrite par les intéressés”, alors qu’ils étaient Français de droit et qu’on ne leur avait pas demandé leur avis. Le 14 juillet 1953 est dans la droite ligne du massacre de Sétif du 8 mai 1945. »
Dans son livre 1953. Un 14 Juillet sanglant, Maurice Rajsfus a publié quelques extraits de ce débat parlementaire, parus dans le Journal officiel du 17 juillet 1953 et que je reprends ici.
Raymond Dronne, de l’Union républicaine d’action sociale (URAS, gaulliste) :
« Gouverner, c’est prévoir. Il semble qu’en la circonstance le ministre de l’Intérieur ait oublié cette règle élémentaire. Je voudrais savoir, Monsieur le ministre, si vous avez donné des instructions en prévision des manifestations et, dans l’affirmative, lesquelles. Je voudrais savoir pourquoi cette manifestation a été autorisée, alors que certains renseignements pouvaient légitimement susciter des craintes. Le 14 Juillet devait être la fête de la liberté et de l’unité française. Elle ne devrait pas être l’occasion de manifestations partisanes. »
Maurice Rabier, député d’Oran de la Section française de l’internationale ouvrière (SFIO, socialiste) :
« On est porté de croire que le PCF a été particulièrement séduit par l’avantage politique que pouvait lui offrir cet ordonnancement spectaculaire du défilé. […] Le bilan de cette tragique soirée laisse apparaître qu’on a stupidement placé le service d’ordre dans une situation difficile et que l’on a ainsi pu le contraindre à réagir comme il l’a fait. »
Abdelkader Cadi, député de Constantine de l’Union démocratique et socialiste de la résistance (UDSR, centre gauche) interroge le ministre :
« Qui a donné l’ordre de se montrer particulièrement rigoureux à l’égard des manifestants algériens. Pourquoi la police perd-elle son sang-froid en présence d’Algériens ? Est-ce un mot d’ordre ? Sinon, pourquoi cette différence de traitement ? Pourquoi une répression qui est allée jusqu’à la tuerie ? »
Jean Grousseaud (Rassemblement du peuple français/ARS, droite) :
« Je tiens à me faire l’interprète de la population de l’est de Paris en majorité anticommuniste, qui subit tous les ans ces manifestations assez désagréables pour ceux qui ne partagent pas les idées des communistes. Si elle est obligée de supporter ces défilés, encore faut-il qu’elle soit protégée contre certaines déprédations qui peuvent se produire à leur occasion. C’est ainsi que le 14 juillet, de paisibles commerçants furent pillés. […] Je me permettrai d’attirer l’attention de M. Le ministre de l’Intérieur sur les mesures profondes qu’il convient de prendre pour éviter de semblables désordres, et empêcher que les communistes ne se servent ainsi de la chair à manifestation que constituent pour eux les Nord-Africains qu’ils enrôlent. »
Pierre Guérard (Républicains indépendants, droite) :
« Le renouvellement d’incidents aussi graves prouve bien que c’est le fait même du défilé qui est en cause. Un tel défilé en un tel jour est inadmissible. […] Le maintien du défilé met en cause l’ordre public à une époque de l’année où les étrangers abondent dans notre capitale. Je demande donc au gouvernement qu’il reconsidère la question et qu’il envisage pour l’avenir l’interdiction pure et simple de tels défilés tolérés à tort jusqu’à présent et qui malheureusement ont déjà engendré à deux reprises des incidents sanglants qui ont endeuillé notre capitale. »
Emmanuel d’Astier de la Vigerie, de l’Union progressiste (proche du PCF) :
« Les balles qui ont tué n’étaient pas des balles égarées : elles ont été tirées dans la tête, au cœur et au ventre. Je veux dire comment est mort Maurice Lurot. […] Une vingtaine d’hommes du service d’ordre étaient autour de la tribune. Ils furent envoyés pour demander aux Algériens, malgré les morts, de rompre et de se replier. C’est au cours de cette mission que Maurice Lurot a été tué par les policiers. […] Il n’y a pas eu de sommation. […] On a relevé des centaines de douilles par terre. […] On ne peut pas renvoyer de telles affaires sine die ; elles méritent une enquête sérieuse… »
Georges Cogniot, du Parti communiste français (PCF) :
« Vous vous trompez, Messieurs les ministres, si vous croyez le moment venu de vous comporter à l’égard des travailleurs algériens de France comme vous le faites à l’égard des peuples coloniaux dans leurs pays. Vous vous trompez si vous croyez avoir découvert un point faible. Ils payeront leur erreur, ceux qui ont négligé de calculer les inévitables répercussions de la fusillade de la place de la Nation aussi bien à Paris et en France que dans les pauvres faubourgs des villes musulmanes et dans les campements les plus reculés. […] Le sang versé en commun montre que la solidarité se forge dans la souffrance et la lutte et c’est vous, les impérialistes, qui la forgez. »
André Liautey, du Rassemblement des groupes républicains et indépendants français (RGRIF, droite) :
« Les événements du 14 juillet sont un avertissement dont il faut bien tirer la conclusion, à savoir qu’il n’est pas possible de tolérer qu’autour de Paris et dans Paris même, soient rassemblés en permanence des éléments d’une armée antifrançaise et révolutionnaire comme ceux qui viennent de donner un échantillon de leur féroce combativité. La seule présence de ces éléments troubles crée déjà un climat d’inquiétude et de révolution. En cas de grève, elle suffirait à envenimer les conflits sociaux et à faire couler le sang, et si les maîtres du communisme international en donnaient brusquement l’ordre, cette avant-garde de tueurs entraînés au combat se lancerait aussitôt à l’assaut. […] Nous attendons du gouvernement un projet [de loi] qui permette de prononcer la déchéance [de la citoyenneté française] au moyen d’une procédure applicable à tous ceux qui ne possèdent pas la citoyenneté française depuis dix ans au moins. Cette déchéance pourrait d’ailleurs être étendue aux condamnés à certaines peines criminelles ou correctionnelles ainsi qu’aux individus convaincus de se livrer au vagabondage spécial tels que ceux qui foisonnent de la place Clichy à la place de la Nation. […] Je souhaiterais que le maintien de la citoyenneté française accordée depuis la Libération fût subordonné à une demande souscrite par les intéressés. […] Ceux qui refuseraient de faire cette demande seraient déchus d’office. […] En dehors de cette déchéance de la citoyenneté française, ne serait-il pas possible, sans transgresser des principes auxquels nous sommes attachés, de prendre d’habiles mesures pour renvoyer chez eux les Nord-Africains qui s’obstinent à rester des chômeurs professionnels ? […] C’est pourquoi je vous demande, Monsieur le ministre, quelles dispositions vous comptez prendre, dans les plus brefs délais, pour déjouer et réprimer le complot de ceux qui, serviteurs d’un nationalisme étranger, se préparent à lancer les Nord-Africains en avant comme une troupe de choc contre les institutions républicaines. »
Le ministre de l’Intérieur Léon Martinaud-Déplat, membre du Parti radical-socialiste (centre droit), répond aux questions :
« Il est faux de dire que le service d’ordre a fait usage immédiatement de ses armes. […] Le souci de laisser au cortège son caractère pacifique a été tel que les pancartes interdites ont pu être déployées dans le Faubourg-Saint-Antoine sans que la police cherche à faire respecter l’interdiction. […] Je veux aussi apporter à l’Assemblée ce que les agents blessés que j’ai visités à la Maison de santé des gardiens de la paix m’ont dit : “Ils avaient la haine dans les yeux, et si leurs yeux avaient été des mitraillettes, nous aurions tous été tués…” Quelques-uns avaient des couteaux – j’en ai la photographie que je pourrais vous montrer –, ce qui évidemment n’était pas de nature à rassurer le service d’ordre. […] Des scènes dramatiques se produisirent. Elles furent certes dramatiques pour ceux qui sont morts et ceux qui sont blessés, […] mais elles furent dramatiques plus encore pour les agents du service d’ordre qui se trouvaient isolés, frappés, désarmés – plusieurs témoignages l’établissent – et couraient le risque d’être lynchés par une foule déchaînée. […] C’est dans ces conditions que, vraisemblablement, quelques coups de feu ont été tirés, qui ont provoqué des blessures dont certaines ont été mortelles. […] Je précise que la situation dans laquelle se trouvait l’agent qui a pu tirer porte un nom dans le code pénal, cela s’appelle la légitime défense. […] Mais sans doute, Mesdames, Messieurs, dans la foule qui manifestait, la misère a-t-elle été aussi mauvaise conseillère que ceux qui l’exploitent à des fins politiques et c’est sur ce sujet que certains orateurs m’ont interpellé pour poser le problème de l’immigration de nos compatriotes algériens vers la métropole.
« Or, jusqu’en 1947, le nombre des Nord-Africains séjour- nant à Paris ne dépassait pas 50 000. Il est aujourd’hui de 132 000. Sur l’ensemble du territoire et pour les mêmes années 1947 et 1953, il est respectivement de 110 000 et de 308 000. C’est dire qu’un problème grave est posé. Il est incontestable que c’est l’octroi de la nationalité [aux Algériens] qui, en supprimant les restrictions imposées à l’entrée dans la métropole, a détruit la relative stabilité qui existait autrefois. […] Le travail du MTLD, qui a bureaux, téléphone, secrétaires et fichiers en plein Paris, se révèle fructueux. Le gouvernement ne pourra pas tolérer plus longtemps une véritable organisation de guerre civile. (Applaudissements sur certains bancs à gauche, à droite et sur divers bancs à l’extrême droite.) […] Nos compatriotes algériens viennent ici attirés par l’appât du gain. […] Les envois mensuels d’argent de leurs camarades qui sont déjà en France et que la famille reçoit paraissent montrer une source d’aisance.
« À ce fait s’ajoute sûrement le goût de l’aventure. […] Sur l’un des malheureux morts, on a trouvé cette note : “Je te prendrai en voiture demain matin à 4 heures pour rentrer à Saint-Dié.” C’était un malheureux Nord-Africain qu’on avait amené jusqu’ici pour manifester parce qu’il devait être considéré par les organisateurs comme digne de figurer dans les troupes de choc. […] M. Baurès, juge d’instruction, a été chargé de mener l’enquête judiciaire. […] Il entendra tous les témoins dont l’audition sera nécessaire. Vous voudrez bien admettre qu’il convient de laisser à ceux qui ont la charge de rechercher la responsabilité de ces événements le soin, dans l’impartialité totale que la justice apporte toujours dans ces sortes d’enquête, d’établir qui peut être coupable et qui ne l’a pas été. »
Emmanuel d’Astier de la Vigerie répond au ministre :
« Si la police française est armée, la loi a tout de même mis un frein à l’usage de ses armes. Ce frein consiste dans les sommations. […] Vous n’avez pas dit pourquoi la police a tiré sans sommation. Vous n’avez pas dit quels sont les responsables, vous n’avez pas dit s’ils seront couverts, s’il y aura une enquête sérieuse. Je le répète, nous ne pouvons pas croire que sur ce fait très grave d’avoir tiré sans sommation et tué sept hommes, l’enquête menée sur les seuls renseignements de M. Baylot [le préfet de police de Paris] vous paraisse suffisante. À l’occasion du scrutin qui va avoir lieu, certains voudront se laver les mains ; j’espère que d’autres demanderont l’enquête sans en préjuger les résultats, bien que l’on sache où sont les responsables. »
Le résultat du dépouillement confirme la solution prônée par le gouvernement de mener une enquête judiciaire diligentée par le ministère de l’Intérieur lui-même. Par 339 voix contre 252, l’Assemblée nationale décide donc de ne pas donner suite à ces événements : il n’y aura pas de commission d’enquête parlementaire.
L’annonce (fausse) par la Préfecture de police de Paris d’un nombre important de policiers blessés
L’historien Emmanuel Blanchard m’a expliqué les ressorts de cette entreprise de désinformation :
« Malgré toutes ces déclarations officielles, l’argument de la légitime défense va assez vite se “dégonfler”, car il apparaît clairement qu’aucun coup de feu n’est venu des rangs des manifestants. Quant aux policiers blessés à coups de couteau, on a certes relevé quelques couteaux sur le pavé parisien à une époque où les ouvriers se baladaient avec un couteau de poche, un canif, un Opinel. Mais ce n’étaient que des couteaux de ce type et aucun policier n’a d’ailleurs eu de blessure profonde. Une dizaine d’entre eux ont certes été blessés assez durement, dont un a été trépané. Mais pour faire tenir le scénario de l’émeute algérienne, il était évidemment nécessaire de gonfler le nombre de blessés. »
Dès le 14 juillet au soir, la Préfecture de police de Paris publie un communiqué affirmant que quatre-vingt-deux policiers ont été blessés, dont dix-neuf, plus grièvement atteints, hospitalisés. Les chiffres donnés dans les archives de la police ne sont toutefois pas les mêmes, puisque les inspecteurs présents sur les lieux indiquent le même jour que le nombre total de blessés est de cent un : groupe Bondais : treize ; groupe Robic : trente-trois ; groupe Giraud : trente-trois ; groupe Martha : vingt-deux. Puis la liste issue des archives du juge d’instruction indique que cent seize gradés ou gardiens sont blessés… De nouveaux noms apparaissent ensuite, augmentant le nombre des blessés : cent vingt-quatre puis cent-vingt-sept, jusqu’à cent trente-quatre. Par ailleurs, la préfecture affirme que plusieurs agents ont été blessés par des couteaux, et un par balle, le gardien Bernard Ladoue. Reprenant un communiqué de la préfecture, Le Monde parle même de cinq policiers blessés par balle.
Pourtant, tous ces chiffres n’ont aucun fondement crédible. D’abord, comme l’atteste le dossier d’instruction, ouvert plusieurs semaines après, cinquante-deux de ces « blessés » n’ont jamais cessé leurs activités. Ensuite, selon la même source, soixante-six d’entre eux, légèrement touchés (contusions, ecchymoses, douleurs, etc.), n’ont jamais été hospitalisés. Enfin, comme cela ressort dans les archives de la Préfecture de police de Paris (carton HE8), le décompte des policiers blessés est de seize hospitalisés le 15 juillet à la Maison de santé des gardiens de la paix ou à l’Hôtel-Dieu ; et, trois jours plus tard, ils ne sont plus que onze (voir encadré ci-après). En fait, seulement quatre policiers, blessés gravement, sont encore hospitalisés à la date du 30 juillet (Daniel Prudhomme, Maurice Meneau, Ambroise Baras et Henri Choquart). Soit bien peu en regard du nombre de manifestants blessés : plus d’une centaine, dont au moins cinquante par balle.
Onze policiers blessés d’après les archives de la police municipale et du dossier d’instruction
Le 18 juillet 1953, un document de la police municipale, repris en partie dans le dossier d’instruction, donne la liste nominative et le diagnostic des onze policiers blessés lors de la manifestation du 14 Juillet, encore présents à cette date à la Maison de santé des gardiens de la paix et à l’Hôtel-Dieu.
« Raoul Chène : fracture probable à la mâchoire, arrêt de deux mois.
René Darcel : contusion cérébrale ayant entraîné la perte de connaissance ; il est à craindre quelques conséquences, à revoir dans un mois.
Paul Lassalle : contusions au crâne et aux deux bras. Il ne conservera aucun reliquat ; durée de l’arrêt de deux mois.
François Leroy : contusions au crâne et à la main gauche. Aucune fracture, aucune incapacité permanente ; deux mois d’arrêt.
Maurice Marlet : plaies au cuir chevelu et contusions au coude. Aucun reliquat des lésions, considéré comme guéri ; arrêt d’un mois et demi.
Maurice Meneau : multiples plaies et fracture du crâne. Il ne doit conserver aucune incapacité, mais il est nécessaire de le revoir ; arrêt de trois mois.
Henri Choquart : contusion thoracique et à la main, à revoir dans deux mois.
Daniel Prud’homme : plaies du crâne et face, contusions au bras, deux mois d’arrêt. Pas d’infirmité permanente, mais une diminution de l’audition.
René Py : contusions : crâne, lombaire, cuisse, main. Aucune lésion, aucun reliquat. Les douleurs vont disparaître ; interruption de trente-trois jours.
Marius Schmitt : contusion crâne, plaie à la lèvre supérieure. Si les troubles postcommotionnels persistent, nécessité d’aller voir un neuropsychiatre. Trois mois d’arrêt.
Ambroise Baras : le plus atteint, hospitalisé à l’Hôtel-Dieu. Plaies au cuir chevelu, enfoncement de la boîte crânienne. Traumatisme violent, intervention envisagée. Voir un neuro- psychiatre. Quatre mois minimum. »
À l’évidence, l’objectif de l’annonce par la préfecture d’un nombre important de blessés du côté policier a été d’occulter les morts et les blessés du côté des manifestants. Telle l’histoire, plusieurs fois mentionnée, du gardien Sallès, blessé par des coups de couteau dans le dos, alors que selon les notes de la Maison de santé des gardiens de la paix, comme on l’a vu, il n’a pas été hospitalisé. Jacques Dehayes, autre gardien, aurait été blessé par un coup de couteau au bras gauche, bien que les archives ne signalent « aucune infirmité, arrêt de deux mois ». Enfin, le gardien Bernard Ladoue a déclaré :
« J’ai été blessé par balle en allant aider des collègues qui étaient en difficulté. » Mais lui non plus n’a pas été hospitalisé. Sa blessure est superficielle et, selon le commandant des véhicules, M. Cagnard, qui lui a rendu visite le soir même à son domicile, « son état ne paraît pas inquiétant »…
Ces informations ont été pourtant largement diffusées par la hiérarchie policière, alors qu’aucun Algérien n’a été retrouvé porteur d’une arme…
Un photographe de presse frappé par les policiers
Au cours de la manifestation, on l’a déjà évoqué, un photographe du Parisien libéré, Robert Trécourt, a été frappé et son matériel photo brisé alors qu’il photographiait des Algériens blessés au moment où ils sortaient d’un immeuble situé au 2, avenue du Trône. Le soir même, les journalistes du Parisien libéré rédigent une lettre ouverte au préfet de police, publiée le lendemain dans le quotidien :
« Au moment des bagarres, un de nos reporters photographes, Robert Trécourt, qui assurait son service place de la Nation a été brusquement pris à partie par un groupe d’agents alors qu’il s’était, selon l’usage, présenté aux gradés responsables du groupe. Robert Trécourt a été frappé à coups de matraque et son appareil lui fut brisé dans les mains par un agent dont nous connaissons le numéro.
Manifestement impuissants à contenir leurs hommes, les gradés de ce groupe pensèrent “arranger les choses” en exigeant de notre reporter qu’il leur remette la pellicule que contenait l’appareil. Il s’agit là, nous tenons à le dire, d’un acte absolument inadmissible contre la liberté de l’information : la protestation que nous élevons auprès du préfet de police, en lui demandant non seulement réparation du préjudice causé, mais aussi des sanctions contre les gradés et agents coupables, aura d’autant plus de poids, nous en sommes persuadés, que Le Parisien libéré ne manque jamais de rendre à la police parisienne les éloges qu’elle mérite dans son action quotidienne. »
Cette protestation est complétée par celle du Syndicat des reporters- photographes de la presse parisienne :
« Nous avons l’honneur de solliciter des mesures pour que les responsables de ces actes soient promptement identifiés et nous voulons bien espérer que vous prendrez des décisions qui s’imposent pour que de tels actes ne se produisent plus. »
L’affaire est rapportée par d’autres journaux : Le Figaro du 15 juillet, Le Monde du 16 juillet et L’Humanité du 17 juillet. Elle renvoie évidemment aux témoignages que j’ai cités d’Abdelhamid Mokrani et de l’étudiant iranien Kazem Vadiei, qui se sont fait matraquer dans l’escalier de cet immeuble de l’avenue du Trône.
La version policière de l’épisode, comme toujours dans le drame du 14 juillet, diffère évidemment en tout point de ces faits parfaitement attestés, comme en témoigne le « rapport complémentaire » du commissaire André Bondais adressé le même jour au directeur général de la police municipale, que j’ai pu consulter dans les archives de la Préfecture de police :
« J’ai été avisé par un passant que des Nord-Africains blessés se trouvaient sur le palier de l’étage supérieur de l’immeuble au 2, avenue du Trône. Je me suis rendu sur les lieux accompagné de l’inspecteur principal adjoint Adret et de quinze gardiens. Nous avons en effet trouvé, sur le palier du sixième étage, trois jeunes Nord-Africains blessés aux bras et à la tête. Nous les avons interpellés et invités à descendre l’escalier. Alors que des gardiens venaient de les diriger vers un car stationné à proximité, pour les conduire à l’hôpital, deux autres gardiens ont amené devant moi un reporter photographe qui ne portait aucun brassard, en me déclarant que ce reporter venait de prendre un cliché au moment de la sortie des Nord-Africains de l’immeuble. Ce reporter avait une attitude hostile à l’égard du service d’ordre et paraissait très surexcité. Je lui ai demandé s’il était exact qu’il avait pris un cliché au moment de la sortie des Nord-Africains de l’immeuble, entourés par des gardiens. Sur sa réponse affirmative, je l’ai prié de bien vouloir sortir le rouleau de pellicule de son appareil et de me le remettre. Il s’est exécuté sans la moindre réticence. Il m’a fait remarquer que son appareil avait été détérioré par des gardiens. J’ai constaté alors que l’appareil avait reçu un léger choc sur la partie métallique. Après avoir reçu le rouleau de pellicule, j’ai demandé au reporter de me communiquer son identité. À ce moment seulement, il m’a déclaré se nommer Trécourt Robert et appartenir au Parisien libéré. Je tiens à préciser les points suivants : 1) le reporter photographe n’a subi devant moi aucune violence de la part de mes gardiens ; 2) il ne portait aucune trace de coups et n’a jamais déclaré avoir été frappé ; 3) il ne s’est jamais présenté à moi avant l’incident, pour faire connaître sa qualité. »
La justification policière de la répression massive
Le rapport du commissaire divisionnaire Gérard, daté du 24 juillet, permet de mieux comprendre comment la hiérarchie policière autorise la violence. Le 21 juillet, une semaine après le massacre, les commissaires concernés par les événements se sont réunis pour parler du mécontentement exprimé par les gardiens de la paix depuis la manifestation.
« Je ne puis que confirmer l’actuel état d’esprit fâcheux des gardiens de la paix, écrit le divisionnaire. Le problème des Nord-Africains devient de plus en plus grave. […] [Les gardiens] affirment que si les parlementaires ont accordé la qualité de citoyens français aux Nord-Africains, ils ne se sont pas inquiétés des répercussions de cette décision. Aucune restriction, aucune réglementation n’est venue tempérer chez ces inadaptés le droit incontestable qu’ils ont dans la métropole de vivre et de circuler selon leur bon plaisir. Il résulte de cette liberté inconsidérée accordée à des hommes frustes, illettrés, primitifs, facilement accessibles à des promesses démagogiques, de multiples incidents, plusieurs fois quotidiens, souvent graves, que les gardiens de la paix, et eux seuls, sont appelés à résoudre. » Le rapport poursuit : « La population apolitique des arrondissements périphériques, sans être pour cela d’accord avec les gardiens de la paix, estime que la correction n’est pas assez sévère ! » Le rapport ajoute encore : « Si 110 000 Nord- Africains sont fixés dans le département, 20 % d’entre eux ne vivent que de ressources inavouables, de rapines et de violences, que des mesures d’adaptation (formation professionnelle, logement, centres d’accueil, etc.) ne parviendront jamais à redresser. Et [la population] estime que si elle veut pouvoir vaquer tranquillement à ses occupations de jour comme de nuit, ces 20 000 Nord-Africains doivent être mis hors d’état de nuire. » Là, on se demande bien comment la police compte s’y prendre pour les mettre « hors d’état de nuire ». Ce rapport, écrit sept jours après le massacre, précise : « Les gardiens de la paix qui vivent au sein de la population, qui connaissent ses opinions sur la question nord-africaine, ont vu dans les assaillants du 14 juillet non des hommes fanatisés par la politique, mais des malfaiteurs au sens strict du mot, vivant en marge de la société et à ses dépens, pour qui une occasion était bonne, une fois de plus, de “rosser le guet ». »
Djanina Messali-Benkelfat, en lisant ce rapport, est choquée :
« “Frustes, illettrés, primitifs…” On est en 1953 ! C’est incroyable ! Mais on voit bien ce qui a présidé au système colonial, parce que c’est sur ce racisme qu’il a fonctionné : il faut le savoir et cela a duré longtemps. On le voit, il est intégré, surtout dans les forces de l’ordre. Et les bastonnades, les passages à tabac. Ça a commencé comme ça et cela a fini dans la torture. »
Le rapport conclut par cette terrible justification : « Les gardiens de la paix, en se défendant, avaient conscience de défendre en même temps la famille et la propriété. En hommes simples, ils n’ont pas compris les conseils de modération qui échappent à leur entendement parce que le mobile juridique est trop subtil. »









