
Replacer le massacre du 17 octobre 1961 dans l’histoire du colonialisme français
À l’occasion de la commémoration du massacre du 17 octobre 1961, Contretemps publie un entretien avec l’historien Emmanuel Blanchard, autour de son livre La police parisienne et les Algériens (1944-1962), publié aux éditions Nouveau Monde en 2011.
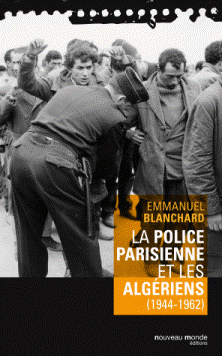
Tu as choisi de travailler sur le 17 octobre 1961 dans une optique de longue durée. Pourquoi ?
Quand j’ai commencé ma thèse, les travaux sur le 17 octobre 1961 étaient déjà nombreux avec entre autres ceux de Jean-Luc Einaudi, Sylvie Thénault, Jim House et Neil MacMaster[1]… J’avais l’impression que beaucoup de choses étaient connues du point de vue factuel. En même temps, il y avait des conflits d’interprétation, pas toujours clairement exprimés, entre une vision du 17 octobre comme une dérive d’un régime démocratique, ou comme un fait de guerre de policiers victimes depuis plusieurs mois d’attentats du FLN.
Pour sortir de ce cadre analytique, notamment lié à la controverse sur le nombre des victimes, j’ai voulu désenclaver l’événement 17 octobre, le sortir de la séquence de la fin de la guerre d’indépendance algérienne. En effet, la spécificité de la prise en charge des Algériens par la police ne commence pas avec la guerre. Ce qui le montre très clairement c’est qu’il y a une violence policière létale adressée aux Algériens avant le 1er novembre 1954. Le 14 juillet 1953, six manifestants algériens sont abattus au cours de la dispersion d’une manifestation, place de la Nation, alors qu’en région parisienne, les armes à feu n’avaient plus été utilisées contre des manifestants depuis 1937.
J’ai donc choisi de me placer dans la moyenne durée pour voir si le 17 octobre relevait de l’exception ou d’une radicalisation de répertoires policiers préexistants. Je me suis ainsi affronté à la question de la situation coloniale : une partie des commentateurs contemporains du 17 octobre parlent d’ailleurs de massacre colonial, notamment la Fédération de France du FLN, dans une plaquette publiée à la fin de l’année 1961. Analyser Paris comme une capitale impériale est en effet fécond, à condition de tenir compte de ce que la domination coloniale passait par des dispositifs qui n’étaient pas exactement les mêmes dans les différentes régions de l’empire français.
Pour mener à bien ce programme, il fallait donc remonter en amont de la guerre d’indépendance algérienne. Depuis la Libération, les Algériens ont un statut très particulier, les « Français musulmans d’Algérie » restent des colonisés aux droits politiques minorés dans les départements Algérie mais disposent de la pleine citoyenneté en métropole, avec en théorie une véritable égalité des droits avec les autres Français, ainsi que la liberté de circulation entre les deux rives de la Méditerranée. Dans la pratique, on peut parler de « citoyens diminués », selon un terme utilisé dès les années 1920 par les élus communistes pour désigner le sort réservé aux naturalisés de fraîche date, et repris dans l’après-guerre pour rendre compte de la situation des Algériens. Ces deniers sont pris en charge par les autorités et par la police selon des modalités proches de celles qui pèsent alors sur des populations considérées comme marginales et déviantes : prostituées, vagabonds, homosexuels, nomades…
Il y a donc une gradation implicite dans la citoyenneté et les représentations dépréciatives de certains groupes sociaux donnent à la police des pouvoirs augmentés sur ces populations stigmatisées. Le modèle de gestion de ces citoyens diminués est celui de la rafle, un terme employé fréquemment par les acteurs de l’époque[2]. Le principe de la rafle, c’est de faire disparaître de l’espace public des populations dont la présence est construite en problèmes sociaux et politiques. Ces populations ne commettent pas de délit mais entraînent les réactions de commerçants, d’habitants, ou des récupérations politiciennes. En même temps, qu’il s’agisse des prostituées, des clochards, ou des Algériens, rien n’est prévu pour leur accueil et leur logement.
La visibilité des Algériens est forte dans des quartiers comme la Goutte d’or, le bas Saint-Michel (autour de la rue de la Huchette) alors quasi-insalubre, le quai de la Gare, dans le 13e arrondissement, Javel dans le 15e, de nombreuses villes de banlieue proche ou lointaine (Saint-Denis, Ivry, Nanterre, Gennevilliers, Argenteuil…). La précarité (notamment résidentielle) et la pauvreté d’une grande partie d’entre eux ne suscitent pas de volonté de règlement politique ou social : les Algériens ont certes le droit d’être là, mais leur présence n’est pas désirée et les pouvoirs publics ne veulent pas dépenser d’argent pour leur permettre d’atteindre des conditions de vie plus acceptables. La liberté de circulation et la citoyenneté n’étaient en effet que des contreparties nécessaires mais redoutées au maintien d’une domination coloniale qui seule avait inspiré la politique française à la Libération.
Dans ce contexte d’injonctions paradoxales (les Algériens sont Français, ont le droit d’être en métropole mais il faut faire en sorte qu’ils ne soient pas visibles), le mandat donné à la police parisienne est alors de les faire circuler voire de les expulser. Comme pour les vagabonds, on ramasse, on contrôle et on essaye de les renvoyer en Algérie sous couvert d’indigence. Avant la guerre d’Algérie, la préfecture se retrouve face à une impasse : expulser de telles populations est à la limite de la légalité (il ne peut s’agir que de « rapatriements volontaires ») et coûte cher. La guerre d’Algérie permet de dépasser ces problèmes juridiques et matériels.
Quelles ont été les conséquences, pour la police, de l’obtention du statut de citoyen pour les Algériens vivant en métropole ?
À la Libération, la préfecture de police est peu réformée, mais le SAINA, Service d’assistance aux indigènes nord-africains, et la Brigade nord-africaine (dont le fichier est la véritable raison d’être de l’hybridation des services sociaux et policiers au sein du SAINA inauguré en 1925), sont dissous, pour des raisons constitutionnelles mais aussi politiques. C’est notamment une volonté forte des représentants des « Français musulmans d’Algérie » (« FMA ») à l’Assemblée nationale, toutes tendances confondues. Le ministre de l’Intérieur, Adrien Tixier, est sincèrement attaché au nouveau statut de l’Algérie et à l’absence de discriminations à l’encontre des « FMA ». Il veut aussi reprendre la main sur la préfecture de police et montrer, par sa vigilance contre toute velléité de reconstituer ce service dissous, que les tendances de la préfecture de police à s’autonomiser de l’autorité du ministère de l’Intérieur doivent cesser.
Avec le nouveau statut de l’Algérie et des Algériens et l’entrée théorique des « FMA » dans le cadre d’une police de droit commun, se créée donc un décalage entre les représentations – les Algériens restent perçus comme des étrangers – et le droit. C’est cet écart qui va nourrir des pratiques pour partie illégales, à l’instar de ce qui se pratique avec d’autres populations « indésirables » pour lesquelles il est admis que la police aille au-delà de son mandat habituel.
Il faut préciser que ce sont les Algériens paupérisés qui sont visés, surtout ceux qui sont présents dans la rue, alors que les élites ou tout simplement ceux qui peuvent se fondre dans la foule urbaine bénéficient en métropole d’une véritable liberté par rapport à l’Algérie, car ils sont beaucoup moins surveillés et réprimés pour leurs opinions politiques. Un Algérien lettré comme Omar Boudaoud, futur dirigeant du FLN, en fait la remarque, de façon étonnante, dans ses mémoires. Avant la guerre, la chasse aux Algériens est aussi une chasse aux pauvres, les Algériens étant d’ailleurs très souvent considérés et traités comme les vagabonds ou autres « clochards » pour reprendre la terminologie policière la plus couramment utilisée.
Au final, on peut dire que la police oscille vis-à-vis des Algériens en métropole entre pratiques coloniales, police des « indésirables » et police des étrangers : les façons de faire sur le terrain se jouent entre ces trois pôles. Les Algériens pauvres, ceux qui sont visibles dans la rue, restent soumis à des pratiques dérogatoires du droit commun mais sont quand même relativement protégés de par l’action de leurs représentants politiques, en particulier à l’Assemblée nationale, médiation politique sur laquelle ne peuvent pas compter les prostituées ou les vagabonds, ces autres « citoyens diminués ». Ainsi, comme pour ces derniers couramment enfermés à l’hôpital Saint-Lazare (malgré l’adoption de la loi dite Marthe Richard en 1946) ou à la Maison départementale de Nanterre, la préfecture de police voudrait pouvoir interner les Algériens, mais ce n’est pas possible avant la guerre d’indépendance.
Tu évoques dans ton livre deux épisodes méconnus, la sanglante répression du 14 juillet 1953 et l’émeute de la Goutte d’or en juillet 1955…
À travers ces épisodes j’ai voulu montrer qu’il ne s’agissait pas simplement d’une immigration soumise à l’emprise policière. Au contraire, les immigrés algériens rétorquaient et agissaient, que ce soit sur le mode syndical, politique, ou même individuellement. Ils ont mené à diverses échelles des stratégies pour investir et tenir la rue. Le 17 octobre 1961 a été un investissement de l’espace sous forme de marche pacifique, consigne explicite de la Fédération de France du FLN. Pour rendre hommage aux Algériens morts ce jour-là, on a eu tendance à rabattre leur action politique à un répertoire non violent. Or, dans les archives, on voit qu’au niveau interindividuel, ceux qui se font rafler n’admettent pas cette situation comme une fatalité. Dans les quartiers populaires où se déroulaient les rafles, la réponse à la police passait par un affrontement physique.
C’est ainsi que le 30 juillet 1955, l’interpellation de deux vendeurs à la sauvette dans le quartier de la Goutte d’or a entraîné une réaction collective selon le mode de l’émeute. La rue a été investie, la police visée, des véhicules renversés, un commerce connu pour renseigner la police incendié. Le commissariat de la rue Doudeauville a été attaqué. Dans l’immédiat, la police a été complètement dépassée, au point de quitter le quartier sans procéder à l’arrestation d’émeutiers. Ce quartier connu à l’époque pour être celui des vendeurs de kif, de cigarettes illégales, de surplus américains, avec le « marché aux voleurs » de la rue Charbonnière, s’est insurgé contre l’opération policière. Le lendemain, le quartier a été bouclé, des contrôles systématiques des habitants et des rafles ont été effectués. Dans les semaines suivantes, à Paris et dans les principaux lieux d’implantation des émigrés d’Algérie, les cadres et les militants connus du MTLD[3] ont été arrêtés et expulsés outre-Méditerranée hors de tout cadre légal.
Dans les années 1980 et 1990, les porte-parole des enfants de l’immigration ont eu tendance à dire qu’ils ne voulaient pas être soumis et dociles comme leurs pères : or, dès avant la guerre d’indépendance, l’immigration algérienne était particulièrement politisée, développait une indiscipline populaire et un refus de l’emprise policière.
Le deuxième épisode oublié que j’évoque dans mon livre, et qui va dans le même sens, est celui de la manifestation du 14 juillet 1953. Il faut rappeler qu’une partie des militants nationalistes algériens ont été socialisés au militantisme durant la période d’activisme communiste (1947-1952). Certains d’entre eux militaient d’ailleurs à la CGT ou au PCF. La période d’activisme communiste correspondait pour le PCF à la volonté de se confronter à l’appareil d’État, notamment en tenant la rue par des démonstrations de force. Il s’agissait d’élever le niveau de réponse physique à la police.
L’apogée de cette tactique a été la manifestation contre la venue du général Ridgway à Paris (commandant en chef des forces des Nations Unies en Corée), le 28 mai 1952. Après cette manifestation, très violente, le PCF abandonne cette stratégie. Mais le parti nationaliste algérien, le PPA-MTLD[4] (dont une scission sera à l’origine du FLN en 1954) continue de se reconnaître dans ce type de démonstration. Le 1er mai 1951, après de rudes affrontements, la police avait dû battre en retraite face aux militants algériens qui brandissaient le drapeau nationaliste. La vente du journal de l’organisation entraînait aussi des altercations récurrentes avec la police, dont des agents étaient régulièrement blessés.
Le 14 juillet 1953, la manifestation traditionnelle organisée par le Mouvement de la paix et qui regroupe l’ensemble des organisations de la mouvance communiste, se passe sans incident majeur même si l’imposant cortège algérien est attaqué par quelques parachutistes, de retour d’Indochine qui doivent battre en retraite sous la protection de la police. Comme souvent, c’est au moment de la dispersion que la situation devient véritablement tendue. Il semble que les Algériens aient voulu aller au-delà de la place de la Nation, terme de la manifestation fixé par la préfecture, pour avancer dans le cours de Vincennes. Il y a là un jeu avec les limites autorisées qui s’inscrit dans cette stratégie du rapport de force. Or la riposte policière est à ce moment là complètement disproportionnée, selon des modalités qui n’ont plus cours en métropole depuis les années 1930 : un feu nourri éclate, plusieurs dizaines de coups de feu sont tirées sur des manifestants non armés, au contraire de ce que les pouvoirs publics affirment pour se dédouaner.
Six Algériens sont tués ainsi qu’un militant de la CGT, et il y a de nombreux blessés. Une telle répression est habituelle à l’époque en Tunisie et au Maroc pour faire face à l’agitation nationaliste : des éléments du répertoire colonial de répression sont donc utilisés en pleine capitale quand la contestation de la domination coloniale s’affiche fièrement dans les hauts lieux du Paris protestataire. Il ne s’agit pourtant pas d’un ordre venu d’en haut : les gardiens de la paix ouvrent le feu sans sommation, à la manière de ce que pratiquent leurs homologues du Maroc et de Tunisie dont l’action violente contre les nationalistes est abondamment relayée par la presse.
Si ces agents peuvent agir sans avoir reçu d’ordre explicite de leur hiérarchie, c’est parce qu’ils sont face à des Algériens et qu’ils savent que la hiérarchie policière et les politiques les couvrent. Ce qui fut d’ailleurs le cas après le 14 juillet 1953, les victimes étant accusée, selon un renversement des responsabilités courant en matière de mensonge d’État, d’être à l’instigation d’une « émeute algérienne » à laquelle il fallait mettre fin dans une situation critique de légitime défense.
Cet événement pose des questions plus générales sur les politiques policières en régime dit démocratique. L’historiographie classique de la police a souvent décrit, au fur et à mesure des décennies, un maintien de l’ordre de plus en plus fondé sur la mise à distance, la mise en scène d’une force de plus en plus retenue, articulé autour de consignes de respecter a minima l’intégrité physique des manifestants et d’éviter les méthodes faisant courir des risques létaux. On parle ainsi couramment de pacification, du maintien de l’ordre, notamment par la professionnalisation des forces concernées, par la spécialisation d’effectifs, par un retrait de l’armée n’intervenant plus qu’en dernière instance en cas d’insurrection.
Le tournant se situe pendant l’entre-deux-guerres – avec notamment la création de la gendarmerie mobile, les CRS suivront en 1945 – et cette évolution est clairement visible par rapport à l’attitude face au mouvement ouvrier. Or, cette interprétation ne tient pas concernant les populations colonisées. Je pense, pour reprendre un terme de commentateurs de l’œuvre de Norbert Elias, qu’il y a une compartimentation, dans ce processus de civilisation de la police des foules manifestantes. Les populations colonisées demeurent traitées selon l’ancien mode de répression autrefois appliquée à un prolétariat assimilé aux « classes dangereuses ».
Le statut de colonisé, les représentations dépréciatives et les stéréotypes déshumanisants dont sont l’objet les Algériens, font écran à la possibilité de leur appliquer des modalités d’action plus proches du droit commun. On peut dire que les Algériens du 14 juillet 1953 ont été traités comme des ouvriers de Fourmies le 1er mai 1891 [grève ouvrière réprimée dans le sang par l’armée], dans une période où seule la situation coloniale autorisait encore ces pratiques répressives.
Quels changements apporte la guerre d’Algérie par rapport à l’action de la police ?
La guerre d’indépendance algérienne a permis que certaines revendications de la police, refusées jusque là, soient acceptées par le pouvoir politique, ce mouvement commençant même un peu avant la « Toussaint rouge ». Ainsi, après la manifestation du 14 juillet 1953, une brigade consacrée à la « clientèle nord-africaine » est de nouveau constituée, la Brigade des agressions et violences (BAV) constituée sous couvert de lutte contre les « agressions nocturnes » et de primat du « flagrant délit » mais qui de fait s’emploie à rafler et ficher le maximum d’Algériens.
Entre 1955 et 1958, l’ensemble des revendications policières vis-à-vis des émigrés d’Algérie sont satisfaites : ils sont peu à peu encartés et fichés, leur liberté de circulation vers la métropole est réduite, des milliers d’entre eux sont internés dans des centres d’assignation à résidence surveillée ouverts à partir de 1958. Dans la rue, après les premiers attentats qui les ont visés, les policiers se voient reconnaître des possibilités élargies d’utiliser leurs armes à feu contre les « suspects nord-africains». Maurice Papon, nommé préfet de police en mars 1958, obtient que soient créées des unités militaro-policières, directement inspirées de celles intervenant sur le théâtre d’opération algérien : il s’agit de pleinement prendre la mesure de ce que les temps de paix sont révolus et que ce sont les principes de la « guerre contre-révolutionnaire » qui doivent s’imposer.
Pour répondre aux actions des groupes armés et de l’organisation spéciale du FLN, en particulier celles dirigées contre des policiers, il n’hésite pas à deux reprises (septembre 1958 et octobre 1961) à proclamer un couvre-feu discriminatoire contre les « travailleurs musulmans algériens ». Dans le même temps, il affirme et démontre à plusieurs reprises que les auteurs de violences illégales contre des Algériens seront couverts par leur hiérarchie.
Le 17 octobre 1961 apparaît comme la radicalisation de ce qui se faisait auparavant, car le mot d’ordre est de rafler tous les manifestants. Mais il s’agit d’une manifestation d’environ 30 000 personnes ! D’une certaine façon, il y a une levée de tous les interdits : en période de guerre, alors qu’un couvre-feu discriminatoire a été décrété, les manifestants sont perçus comme des ennemis, appelés à descendre dans la rue par une organisation, le FLN, qui depuis plusieurs semaines a multiplié les attentats contre des policiers. La démonstration du FLN est réprimée sous la forme d’un quasi « pogrom », selon les mots qu’utilisa Pierre Vidal-Naquet dès novembre 1961. En fait, on pourrait dire plus précisément qu’un massacre colonial est organisé, comme celui du 7 décembre 1952 à Casablanca, ou comme celui perpétré contre un rassemblement pacifique par les Britanniques à Amritsar (Pendjab indien) en 1919.
Le 17 octobre, les victimes sont des Algériens dont la « fiction juridique » qu’était leur statut de citoyens français ne les protégeait plus depuis longtemps des excès de la force policière : considérés jusqu’à la guerre comme « indésirables », ils deviennent dans le contexte d’un conflit colonial des « ennemis de l’intérieur ».
Il faut ajouter que la police a acquis une place fondamentale dans le régime gaulliste parce qu’elle a pesé fortement dans la fin de la IVe République. Le 13 mars 1958, une manifestation est organisée dans la cour de la préfecture de police pour pousser à la satisfaction de revendications matérielles dans un contexte marqué notamment par la mort du premier gardien de la paix tué par le FLN. La manifestation déborde et environ 2 000 policiers défilent jusqu’au Palais Bourbon devant lequel ils font assaut d’antiparlementarisme et d’antisémitisme, ce coup de force symbolique d’une partie de la police parisienne étant attisé par des députés d’extrême droite, notamment Jean-Marie Le Pen, venus à la rencontre des manifestants.
Maurice Papon est alors rappelé de Constantine pour reprendre en main la préfecture de police, mais il ne fait rien pour contrarier les velléités antiparlementaires des policiers. En mai 1958, quand la situation devient critique pour la IVe République, le ministre de l’Intérieur Jules Moch constate qu’il ne peut pas compter sur la police parisienne, ni sur les CRS, ni sur l’armée. Le régime s’effondre aussi parce que les forces de l’ordre cessent de le soutenir.
De Gaulle au pouvoir sait qu’il va mécontenter l’armée en négociant l’indépendance de l’Algérie. Sa priorité est alors de se concilier le soutien de la police, afin d’avoir de son côté au moins un organe de répression. Il le fait notamment en couvrant les débordements et exactions qui visent les Algériens, dans le cadre d’une politique de répression tous azimuts qui doit permettre à la France de poser en vainqueur à la table des négociations. La Fédération de France du FLN a ainsi été désorganisée puis affaiblie par le couvre-feu du 5 octobre et la répression de l’automne 1961.
Ce ne fut d’ailleurs pas sans incidence sur la postérité du 17 octobre : cette démonstration avait été voulue par une Fédération de France voulant apparaître aussi combattante que les wilaya d’Algérie. Sur ce plan ce fut un échec : si cet événement a donné lieu à un véritable mensonge d’État en France, il a aussi pendant longtemps suscité le désintérêt du gouvernement algérien car les responsables de la Fédération de France font partie des vaincus des luttes de faction de l’indépendance. L’ouvrage de Marcel et Paulette Péju (Le 17 octobre des Algériens, éditions La Découverte, 2011) prévu pour sortir dès 1962 a ainsi été bloqué par l’éditeur François Maspero sur la demande expresse du gouvernement algérien. Plus généralement, jusqu’aux années 1980, les victimes du 17 octobre n’avaient pas leur place dans la mémoire officielle algérienne.
Quel parallèle peut-on faire avec l’attitude actuelle de la police dans les quartiers populaires, face aux jeunes issus de l’immigration ou avec les sans-papiers ?
La police des Algériens a toujours emprunté à plusieurs répertoires : la police des colonisés, celle des étrangers, des indésirables et marginaux. Dans certaines situations, aujourd’hui encore, les policiers continuent d’agir aussi loin que le leur permet le pouvoir politique. Ainsi, quand l’ordre doit régner dans les quartiers, on autorise des niveaux de violence plus élevés. Cette violence est à la fois symbolique, avec les contrôles d’identité répétés, mais aussi physique (que l’on pense notamment aux « bavures »), voire institutionnalisée avec les objectifs chiffrés de la police des étrangers.
La distinction Français-étrangers n’est d’ailleurs pas seulement juridique : elle passe par des formes de racialisation, de stigmatisation d’une altérité présupposée mais aussi par le rejet de la pauvreté. Ces pratiques communes (les contrôles « au faciès », les rafles…) sont liées à des représentations qui perdurent tout en évoluant au fil des décennies. Elles prennent aussi place dans la béance entre le droit, la réalité des moyens engagés pour résoudre les questions sociales et les attentes démesurées placées dans des forces de police censées pacifier les lieux de relégation, réduire la visibilité de la pauvreté et répondre à un « sentiment d’insécurité » multiforme.
Cependant, le contexte sociopolitique dans lequel la domination s’exerce aujourd’hui prend des formes très différentes de la période coloniale. Il faut le garder à l’esprit, comme le fait que les Algériens des années 1950 n’étaient pas seulement des colonisés : ils étaient certes des cibles pour la police, mais il ne faut oublier ni leur capacité de réaction, ni les différences sociopolitiques qui traversaient l’immigration.
Dans quelle mesure la police en métropole a t-elle été influencée, et jusqu’à quand, par le mode de gestion de l’ordre pendant la guerre d’Algérie ? Comment s’est déroulé le retour à une situation post-guerre coloniale ?
Dès 1962, Maurice Papon faisait savoir à ses troupes qu’en matière de tenue et de violences, il fallait rompre avec les pratiques des temps de guerre. La préfecture de police devait retrouver des pratiques policières conformes aux attentes du public en temps de paix. La guerre d’indépendance algérienne n’était pourtant pas une parenthèse que les accords d’Évian suffisaient à refermer, notamment parce que l’immigration algérienne – qui relevait dorénavant de la police des étrangers mais continua quelques années à bénéficier de la liberté de circulation – ne cessait de croître.
Après l’indépendance algérienne, certaines des unités qui mêlaient action sociale et contrôle policier (notamment les SAT), loin d’être dissoutes vont voir leurs prérogatives élargies à l’ensemble des immigrés originaires de pays africains récemment colonisées. Des dispositifs mis en place pour encadrer l’immigration algérienne (la SONACOTRA, le FAS…) vont de même être étendus à l’ensemble de l’immigration dont la gestion est prise en charge par des hauts fonctionnaires ayant fait leurs armes pendant la guerre d’Algérie[5].
On observe aussi que c’est à cette période que les polices françaises vont accueillir le plus de « rapatriés » ayant exercé en Afrique du Nord ou d’anciens conscrits ou engagés ayant participé aux guerres de décolonisation. Nombre de témoignages de policiers montrent aussi que jusque dans les années 1980, les souvenirs de la période de la guerre d’indépendance étaient vifs dans les rangs et que ceux des policiers qui avaient connu cette période jouaient souvent un rôle leader auprès de leurs collègues. Une partie d’entre eux contribuaient d’ailleurs à la diffusion de stéréotypes racistes largement répandus dans les services.
Ces liens directs – tant institutionnels qu’individuels – avec la fin de la période coloniale ont aujourd’hui quasi disparu. Une partie de l’immigration et des populations racialisées, dont l’importance est d’ailleurs croissante, ne relève d’ailleurs pas de la postcolonialité, en tout cas pas de l’ex-empire français. Est-ce à dire que le passé colonial ne permettrait pas de saisir certaines des particularités de l’emprise policière sur les populations des quartiers dits « sensibles » ? En la matière, la figure de « l’ennemi de l’intérieur » est ainsi loin d’avoir disparu, qu’elle emprunte au répertoire de la lutte anti-terroriste, à celui de l’islamophobie voire à celui de la reconquête des quartiers abandonnés au crime plus ou moins organisé.
Pour chacun de ces cas de figure, il est possible de tracer des généalogies coloniales ou de pointer une matrice algérienne, à la seule et nécessaire condition de ne pas rabattre le moment du « problème nord-africain », ni le présent de la politique policière sur la seule problématique (post)-coloniale. La situation coloniale est une des formes de racialisation des rapports sociaux et de domination politique qui peuvent emprunter à bien d’autres registres. Autrement dit, le présent du passé colonial est aujourd’hui inscrit dans des politiques policières qui ne sont pas celles des années 1950-1960 même si l’actualisation de certains répertoires d’action passés fournit des clés d’intelligibilité pour décrypter des dispositifs plus que jamais tournés vers la gestion des « citoyens diminués » et autres « étrangers indésirables ».
Propos recueillis par Sylvain Pattieu.
Notes
[1] À ce jour l’étude la plus aboutie est celle de Jim House, Neil MacMaster, Paris 1961. Les Algériens, la terreur d’État et la mémoire, Tallandier, 2008 [édition originale en anglais, 2006].
[2] Emmanuel Blanchard, « Ce que rafler veut dire », Plein Droit, n° 81, juillet 2009, http://www.gisti.org/spip.php?article1650.
[3] Mouvement pour le triomphe des libertés démocratiques [NdR].
[4] Parti du peuple algérien – Mouvement pour le triomphe des libertés démocratiques [NdR].
[5] Sylvain Laurens, Une politisation feutrée. Les hauts fonctionnaires et l’immigration en France, Belin, 2009.
Nos contenus sont sous licence Creative Commons, libres de diffusion, et Copyleft. Toute parution peut donc être librement reprise et partagée à des fins non commerciales, à la condition de ne pas la modifier et de mentionner auteur·e(s) et URL d’origine activée.









