
L’invention de la BAC et le quadrillage sécuritaire des quartiers populaires
Mathieu Rigouste, La Domination policière. Une violence industrielle, Paris, La Fabrique, 2012.
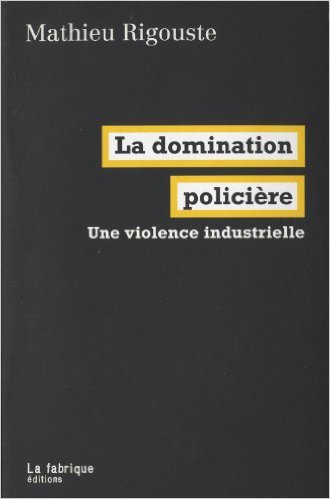
Les manifestations de policiers, parfois cagoulés et armés, se sont multipliés ces derniers jours – en plein Paris mais aussi dans plusieurs villes de France – pour réclamer toujours plus de moyens et de liberté pour réprimer ; comme si l’état d’urgence n’avait pas accru dramatiquement l’arbitraire policier, particulièrement dans les quartiers populaires sous la forme d’assignations à résidence, de contrôles au faciès et de violences policières multipliés.
Alors que les agents de la Brigade anti-criminalité (BAC) sont manifestement en première ligne dans cette mobilisation au croisement entre le renforcement autoritaire de l’État et la dynamique fasciste, il est utile de revenir sur l’origine de ce secteur des appareils répressifs d’État. C’est ce à quoi s’emploie ici Mathieu Rigouste, dans cet extrait du premier chapitre – intitulé « La ségrégation endocoloniale » – de La Domination policière (La Fabrique, 2012), montrant que le quadrillage sécuritaire des quartiers populaires imposé au cours des quarante dernières années prolonge – par d’autres moyens – la guerre coloniale.
L’anticriminalité : continuer la guerre coloniale
Le commissaire François Le Mouel, qui se présente comme le créateur du concept d’ « anticriminalité », est un ancien policier des brigades spéciales de nuit – les prototypes des BAC d’aujourd’hui. Son parcours résume assez bien le processus de reconversion des répertoires de la guerre coloniale dans le contrôle des pauvres et la restructuration de la violence policière. Affecté comme officier dans différents quartiers de Paris et de sa banlieue avant le déclenchement de la guerre d’Algérie, il a passé les trois premières années du conflit (1954-1957) au secrétariat du directeur de la police judiciaire qui s’occupait notamment de la « criminalité nord-africaine ». Il a dirigé le commissariat du quartier Bonne-Nouvelle de 1957 à 1960, avant d’être affecté en 1961 à la cinquième brigade territoriale. Il a ainsi dirigé des policiers parisiens durant toute la guerre d’Algérie. En 1964, il devient le premier chef de la section de recherche et d’intervention qui deviendra la brigade de recherche et d’intervention (BRI). C’est à ce poste, qu’il occupe jusqu’en 1971, qu’il développe le concept d’« anticriminalité »[1].
Confronté à des séries de braquages de banques, François Le Mouel rédige un rapport pour justifier la recherche du « flagrant délit » face à ces « types de criminalité ». Il engage à dépasser la logique « du crime au criminel » pour une logique « du criminel au crime »[2] : en se cachant, en surveillant, en traquant, en laissant faire puis en intervenant. C’est le début du développement d’unités mobiles « anticriminelles », en civil, dressées à surveiller et traquer les jeunes des classes populaires, à les provoquer pour mieux faire apparaître « le crime » caché dans leurs corps suspects. La police anticriminalité est organisée en petites unités mobiles et relativement autonomisées pour capturer plus de « criminels », plus vite et plus efficacement que la police judiciaire. Elle émerge avec les premières formes de conceptions managériales et néolibérales dans la gestion de la police : elle est conçue comme une technique plus productive et plus rentable en terme de captures.
Au début de l’automne 1971, dans plusieurs quartiers de Paris, on pouvait lire sur les affiches du Mouvement des travailleurs arabes : « À Ivry, un travailleur immigré arabe, Behar Rehala, qui avait volé un pot de yaourt a été poursuivi par des policiers qui l’ont tué à coups de pelle »[3]. C’est face à ces dénonciations et dans ce contexte d’expérimentation de la criminalisation répressive que l’État prend en charge de réguler et d’encadrer techniquement la police anticriminalité. La première brigade anti-criminalité est créée dans ce but, le 1er octobre 1971, à Saint-Denis, où subsistent les derniers bidonvilles. C’est l’officier de paix principal Claude Durant qui propose, sous l’impulsion du préfet Pierre Bolotte, la création d’une nouvelle unité spécialisée pour la « lutte anticriminalité ». Pierre Bolotte s’est formé à la pacification militaro-policière lorsqu’il était au cabinet civil du général de Lattre de Tassigny en Indochine. Il a encadré la contre-insurrection de 1955 à 1958, lorsqu’il était sous-préfet à Miliana puis directeur de cabinet du préfet d’Alger. De 1962 à 1965, il était au ministère de l’Intérieur, au cabinet du préfet J. Aubert, directeur de cabinet du ministre. Depuis cette position, il œuvrait déjà à reconvertir un savoir issu de la guerre coloniale dans la police des quartiers populaires. Avant de devenir le premier préfet du nouveau département de Seine-Saint-Denis, Bolotte avait été préfet de la Guadeloupe de 1965 à 1967, où, en mai 1967, il encadrait un massacre d’État contre les révoltes des colonisés.
La technique « anticriminalité » expérimentée en Seine-Saint-Denis consiste désormais à pénétrer la population (et non plus les populations, sous-entendu colonisées) pour y traquer un nouvel ennemi intérieur incarné par une figure socio-ethnique du criminel. Ce procédé, qui avait déjà servi à justifier la traque des révolutionnaires communistes ou anticolonialistes dans les périodes précédentes, va dès lors désigner l’ensemble des quartiers populaires comme des viviers de prolifération d’une menace mortelle non plus pour « l’empire » mais pour « la nation ». La BAC 93 est créée sur le principe d’une pacification désormais intérieure pour laquelle il faut des unités policières particulièrement rentables et productives, susceptibles de mener une guerre de basse intensité – autrement dit, des commandos policiers.
Sur le modèle des unités de voie publique réorganisées par Le Taillanter et composées d’anciens praticiens de la chasse aux Algériens, en moins de trois mois, la BAC 93 a procédé à l’interpellation de 350 individus, essentiellement pour port d’arme et vol de véhicule. Les années suivantes, de 1972 à 1974, elle a réalisé plus de 2 800 arrestations[4]. Une productivité que les petits et grands chefs policiers reconnaissent comme extraordinaire comparée à celle des anciennes polices de voie publique.
Après les premières expérimentations, les unités anticriminalité – encore généralement nommées brigades spéciales de nuit (BSN) – sont consacrées et généralisées en avril 1973. Une note de service du directeur central de la Sécurité publique valide leur existence dans une trentaine de circonscriptions, avalise et encourage leur développement pour lutter tout d’abord contre une « criminalité » désormais stigmatisée comme « menace sur la nouvelle société ». Les BSN et les brigades de surveillance de voie publique (BSVP) – leur équivalent en journée – se voient confier trois objectifs : « assurer une surveillance permanente et discrète de la rue et des lieux publics », « tenter de réaliser des interpellations en flagrant délit », « créer l’insécurité dans les milieux délinquants »[5].
Une pseudo-théorie mise en circulation au début des années 1970 a fourni une caution « scientifique » à la focalisation policière de ces unités « anticriminelles » sur les non-Blancs pauvres. La notion de « seuil de tolérance aux étrangers » explique que le racisme est lié à la présence d’étrangers trop nombreux et qui provoquent une réaction quasi biologique des « vrais Français », sous-entendu blancs et chrétiens. Les « étrangers » seraient donc responsables du racisme. Selon ce régime de justification, pour rassurer les racistes et éviter qu’ils règlent « le problème » eux-mêmes, les policiers peuvent légitimement intensifier le contrôle public des non-Blancs. Cette supercherie intellectuelle a été propulsée par l’Institut national d’études démographiques (INED), en particulier dans les rapports d’Alain Girard[6] diffusés très largement dès le début des années 1970. « Girard propage alors la notion de “seuil de tolérance” aux étrangers, qui se répandra dans l’ensemble des partis parlementaires, par un consensus qui ne se démentira plus » explique Alain Morice[7]. Selon Michel Marié, cette « notion » est employée pour la première fois en 1964 dans un rapport sur le relogement des « immigrés » du bidonville de Nanterre à la cité des Canibouts. Le sociologue responsable du rapport l’aurait utilisée en faisant référence aux recommandations du plan de Constantine de 1959 sur la cohabitation des indigènes et des colons[8].
Toujours répandue dans la police, cette fiction a fourni une légitimation morale pour les comportements racistes de policiers qui choisissaient d’intégrer ces nouvelles unités chargées des cités. On a tenté de faire reculer les actes racistes en envoyant dans les quartiers populaires des policiers convaincus qu’il fallait s’occuper en particulier et visiblement des « bronzés ». La police des damnés à l’intérieur s’est constituée en revendiquant « scientifiquement » l’appropriation de certains gestes et mentalités racistes issus des répertoires de la violence coloniale.
Le 30 novembre 1972, Mohamed Diab, chauffeur de poids lourds algérien de trente-deux ans est abattu dans un commissariat par le policier Robert Marquet d’une rafale de pistolet mitrailleur[9]. Entré dans la gendarmerie sous l’occupation, CRS pendant toute la guerre d’Algérie, Marquet était arrivé à la Sûreté urbaine en 1960. Selon le policier Georges Moréas présent sur les lieux, le sous-brigadier Marquet a crié « Oui, je te tue, sale race, je te tue ! » à Mohamed Diab avant de le mitrailler. L’affaire a été largement médiatisée et Mohamed Diab décrit comme un « forcené » « mangeur de viande crue » jusqu’à ce qu’une contre-enquête révèle les mensonges des policiers. Le 29 mai 1980, une ordonnance de non-lieu est prononcée par la Chambre d’accusation. Confirmée par la Cour de cassation, elle protège, autorise et suscite les pulsions morbides de tous les sous-brigadiers Marquet.
Le 24 juin 1973, des gendarmes de Fresnes cherchent un garçon algérien de 14 ans. Ils ne trouvent que sa sœur, Malika Yazid, 8 ans, qui joue dans la cité de transit des Groux où elle habite. Un gendarme s’enferme avec elle pour mener un « interrogatoire » afin d’obtenir des « renseignements » sur son frère. Elle en ressort dans le coma puis meurt. De nombreux commentateurs de l’époque dénoncent des méthodes comparables à celles de la guerre d’Algérie[10].
Fin août 1973, une « petite guerre d’Algérie » est rejouée à Marseille. Une campagne d’assassinats contre des travailleurs arabes est lancée par des commandos racistes nostalgiques de l’Algérie coloniale. Après plusieurs lynchages, des cocktails Molotov sont lancés contre des baraquements d’usine qui sont ensuite mitraillés. Sept « Maghrébins » sont tués à Marseille en une semaine[11]. Le Mouvement des travailleurs arabes organise la « première grève générale des travailleurs arabes contre le racisme » dans les Bouches-du-Rhône et à Paris début septembre. L’État doit réellement prendre en charge et maîtriser la violence déployée contre le sous-prolétariat. Le développement de l’anticriminalité va se poursuivre en concentrant toujours plus son activité sur les « quartiers immigrés », pour se substituer au système de violences « civiles et privées ». Dans ces unités se reclassent en particulier ceux qui veulent continuer légalement la guerre d’Algérie en France.
Le 10 octobre 1974, douze policiers sont poursuivis devant le tribunal correctionnel de Paris pour avoir dévasté le domicile d’un Algérien à Paris deux ans plus tôt. Leurs propos sont rapportés lors du procès : « La guerre d’Algérie n’est pas finie. On va aller au bois de Verrières et on vous tirera dessus. Il n’y a pas assez de boulot pour les Français. Vous bouffez notre pain. Vous n’avez rien à faire en France ! »[12]. La section parisienne de la CFDT police a alors commenté : « Des ratonnades de cette violence sont rendues possibles par le racisme latent qui gangrène le corps policier, bien souvent entretenu par ceux qui voudraient refaire leur guerre d’Algérie. »
En avril 1978, Ali Thouami, un Algérien, est arrêté à Gennevilliers par le brigadier Claude Fiancette qui le frappe et le blesse gravement. Ali Thouami perd un œil. Son mutilateur est un ancien parachutiste d’Algérie, reconverti dans la police comme motard puis affecté à la BAC des Hauts-de-Seine. Le para-baqueux Fiancette écope de trois ans avec sursis en 1984[13].
Une géographie de l’obsession policière et de la révolte
La police des cités se fonde aussi sur la fabrication du « quartier sensible » dans la « pensée d’État »[14], c’est-à-dire comme catégorie de l’action publique[15]. En 1974, après cinq ans de travail, Marcellin, ministre de l’Intérieur, a réussi à porter les effectifs de police de 85 000 à 105 000, et incite à poursuivre cet effort[16]. Il explique notamment comment la désignation de « zones criminelles » permet de développer des unités anticriminelles :
J’ai fait préparer par tous les services de police un plan. Nous avons recherché sur l’ensemble du territoire toutes les zones d’insécurité, c’est-à-dire là où il y a des villes nouvelles, où il y a des quartiers qui sont trop éloignés des centres de police. De telle sorte que l’on a pu se faire préciser là où il y avait des agressions et là où il y avait des cambriolages, en faisant des chiffres de façon à avoir une idée extrêmement précise. Le plan sera de créer partout des petits bureaux de police avec des patrouilles de policiers munis de motobécanes qui circuleront dans tous ces quartiers, de façon à établir l’insécurité sur les malfaiteurs[17]…
On voit se dessiner au milieu des années 1970 une nouvelle cartographie du pouvoir policier, reproduisant certains axiomes de la pacification coloniale dans le cadre d’un développement rationalisé du contrôle.
À partir de 1974, les BSN opérationnelles dans une soixantaine de circonscriptions de province prennent le nom de « brigades anticriminalité » (BAC), seize autres équipes quadrillent les Hauts-de-Seine, la Seine-Saint-Denis et le Val-de-Marne, et des brigades de direction en civil (BDC) sont chargées de la capitale.
Le volontarisme de Marcellin a fait exploser le nombre des « faits délinquants » recensés et constatés. De la fin des années 1960 au milieu des années 1970, ceux-ci sont passés de 1 à 2 millions. Ces nouveaux chiffres ont permis de confirmer l’idée d’une explosion des désordres. En 1976, le Comité d’études sur la violence, la criminalité et la délinquance, mis en place par le Premier ministre Jacques Chirac, débouche sur le « rapport Peyrefitte » qui identifie une « soudaine montée de la violence en France », avec notamment une augmentation spectaculaire des vols à main armée et des hold-up. Le « sentiment d’insécurité général » évoqué dans le rapport concerne les zones urbaines et surtout les plus pauvres d’entre elles, dans lesquelles auraient augmenté les délits et infractions de petite et moyenne importance. Le Comité d’études sur la violence, la criminalité et la délinquance (CEVCD) pose les bases stables de l’idéologie sécuritaire à la française et la focalisation policière sur l’encadrement des cités.
La police des cités est formée au croisement de la police coloniale et de la police des classes dangereuses, en monopolisant rationnellement l’usage de la violence raciste pour contenir les « désordres » engendrés par la fabrication du chômage de masse. La ségrégation des nouveaux « damnés de la ville » dans ces territoires a permis d’y expérimenter les premiers dispositifs néolibéraux consistant à couper les dépenses de protection sociale et à réduire l’État à ses appareils sécuritaires[18]. Ce schéma se confronte depuis son origine à des résistances et des contre-attaques.
Parallèlement à la Seine-Saint-Denis, c’est dans l’agglomération lyonnaise qu’ont été expérimentées, dès 1971, les nouvelles formes d’organisation des polices urbaines et « l’îlotage » comme « surveillance permanente préventive et territorialisée de certains quartiers »[19]. La première « émeute » de l’ère sécuritaire s’y produit dès 1971 à Vaulx-en-Velin, à la cité de la Grapinière, construite dans la périphérie lyonnaise pour accueillir, après 1962, des « Français musulmans d’Algérie ». À la fin de la décennie, c’est dans ce laboratoire de l’enclavement que resurgissent les révoltes populaires.
Dès 1976, le périmètre de la cité Simion est quadrillé par la police, le quartier régulièrement encerclé par les CRS et fouillé de fond en comble. Ces bouclages le transforment en « une véritable cité de regroupement, à l’image des pratiques de contrôle du territoire mises en place en Algérie entre 1955 et 1962 »[20]. Les affrontements avec la police se multiplient. La « réputation exécrable de l’îlot Olivier de Serres » permet à la municipalité de Villeurbanne de justifier la destruction de « ce vivier à délinquance », comme l’explique le maire Charles Hernu. Les différentes barres de la cité Simion sont démolies entre novembre 1978 et août 1984. Les habitants les plus précaires sont relogés à Vaulx-en-Velin et Vénissieux, accentuant la ségrégation sociale et raciale dans la banlieue de Lyon.
À Vaulx-en-Velin, en septembre 1979 dans la cité de la Grappinière, en 1981 et 1982 au quartier des Minguettes à Vénissieux, des jeunes habitants affrontent la police. Ils dénoncent sa violence, la misère et le racisme.
Généraliser l’enclavement policier et urbain
À Villeurbanne, la collaboration de la police et des médias a révélé un nouveau mécanisme : la possibilité d’engager la destruction et/ou la restructuration d’une cité lorsque celle-ci a été médiatisée comme « émeutière » et, dans ce mouvement, la possibilité d’éloigner les plus pauvres et de générer des marchés de la « rénovation urbaine » et l’embourgeoisement des territoires conquis.
Initiée dès 1973, avec la création du Groupe de réflexion interministériel « habitat et vie sociale » (HVS), la « politique de la ville » met en œuvre ses premières réalisations à la fin de la décennie. Une cinquantaine d’« opérations de réhabilitation » sont menées dans le cadre d’un premier « plan banlieue » de 1977 à 1981. C’est le début d’un long programme de refonte de la ségrégation et de l’enclavement des damnés de l’intérieur. Mis en œuvre au nom de la « lutte contre l’exclusion », le programme va généraliser un mode de ségrégation des quartiers populaires : l’enclave endocoloniale.
Dès 1981, le nouveau gouvernement de gauche classe une vingtaine de quartiers comme « îlots sensibles ». De la fondation en 1983 de la mission « Banlieues 89 » par Roland Castro[21] et Michel Cantal Dupart à la création de la Délégation interministérielle à la ville en 1988, la « politique de développement social des quartiers » n’a cessé d’élargir la liste des zones sur lesquelles inter-venir en priorité avec des forces de police.
Dans le but de « ramener le calme au sein de populations perçues comme potentiellement violentes », à la suite des « rodéos des Minguettes » en 1982 – de jeunes habitants avaient volé puis brûlé des voitures de luxe –, un programme d’aide sociale et de prévention de la délinquance est mis en œuvre par l’État dans les quartiers populaires urbains[22]. Les administrations chargées de la construction et de la rénovation des logements populaires[23] conçoivent de nouveaux schémas d’urbanisme censés prévenir, empêcher et contenir les révoltes. Deux expériences de politique urbaine sont menées de front : d’un côté la réhabilitation du bâti existant accompagnée de mesures de « dévelopement social des quartiers » (financement d’infrastructures socioculturelles et sportives gérées par les municipalités ou des « intervenants extérieurs » aux quartiers) – de l’autre, la destruction des logements réputés les plus difficiles[24]. Une troisième expérience est menée à l’été 1982 : occuper une partie des « jeunes » par diverses « animations de quartiers », sportives et culturelles, et en déplacer une autre partie (stages loisirs, colonies de vacances subventionnées…). Ces opérations sont parfois couplées à l’arrestation préventive des « adolescents jugés les plus turbulents »[25].
En 1983, des conseils communaux et départementaux de prévention de la délinquance sont créés pour associer les responsables de la police à des travailleurs sociaux et diverses institutions. Là où elles ont réellement fonctionné, ces structures ont permis d’identifier individuellement les « délinquants occasionnels ou réguliers » et de ficher leurs réseaux affinitaires et familiaux[26]. Cette surveillance sociopolicière a permis de placer des « jeunes » dans des centres de formation ou des stages pour les « retirer du jeu » ou de leur appliquer des mesures explicitement répressives.
Le programme de « prévention et de répression » mis en œuvre sous la gauche a modernisé la conjugaison du contrôle socio-administratif et du contrôle policier. Il a reconstitué une forme de tutelle paternaliste typique de la ségrégation endocoloniale.
Suite à l’expérimentation de ces dispositifs, en 1988, le ministère de l’Intérieur décide de développer « l’îlotage » sur le mode de la community police dans le monde anglophone. Cette façon de quadriller les quartiers africains-américains par une présence visible et permanente était employée aux États-Unis dès les années 1960. Dans la seconde moitié du xixe siècle, un « modèle londonien » avait été expérimenté dans le Paris populaire, à travers l’emploi de l’uniforme et de la déambulation ostensible pour soumettre et bannir « apaches » et « communards »[27]. Présentée comme moins brutale et « de proximité », cette police prétendument de gauche mais conduite aussi par les gouvernements de droite sous d’autres paravents, généralise les dispositifs d’occupation territoriale et formalise un peu plus l’enclavement.
Cette première phase de la « politique de la ville », axée sur la constitution des enclaves endocoloniales, s’achève au début des années 1990. L’année 1991 constitue en effet une date de rupture. Une loi d’orientation pour la ville, dite « loi anti-ghettos », permet de lancer un vaste programme de rénovation et de destruction de cités en banlieue parisienne, à Vénissieux, Marseille, Roubaix et Tourcoing. En septembre, dans le cadre de la création du Service national ville, il est décidé d’envoyer des appelés dans les quartiers étiquetés « sensibles ». Cette même année, la Commission de contrôle du Sénat, chargée d’examiner les services de police, propose l’instauration d’un dispositif permanent, du type « Vigibanlieues » – sur le mode du plan antiterroriste Vigipirate –, développé par Philippe Marchand, à l’occasion de la guerre du Golfe[28].
Gestion médiatique
Les grands médias et la classe politique ont dû apprendre à maîtriser publiquement les résistances et les contre-attaques collectives des damnés du néolibéralisme. Alors que la généalogie des « révoltes des cités » commence dès le début des années 1970 et de « la crise économique », elles ne sont saisies par les médias dominants qu’au début des années 1980. Ceux-ci s’emparent du phénomène des « rodéos de voiture » aux Minguettes et des grèves de travailleurs arabes pour fabriquer un univers imaginaire qui va se révéler très rentable : le « problème d’intégration des immigrés ». La criminalisation médiatique des révoltes populaires n’a plus cessé d’accompagner le développement d’un racisme culturaliste[29] – basé sur la désignation d’une culture inassimilable en lieu et place de la « race » des « non-Blancs ». La fabrication médiatique de la « banlieue » comme « problème d’intégration ethnique et culturel » devient un appareillage idéologique fondamental pour masquer les structures politiques, économiques et sociales de la ségrégation policière.
La médiatisation de la violence policière est devenue elle-même un champ de bataille. L’épisode qui a suivi le meurtre de Malik Oussekine en a été un cas exemplaire. La nuit du 6 décembre 1986, dans le cadre des manifestations étudiantes contre la loi Devaquet, des affrontements ont lieu avec la police dans le VIe arrondissement de Paris, près de la Sorbonne. Des voltigeurs sont envoyés pour traquer les « casseurs ». Ce sont des unités de police particulièrement agressives, montées sur moto et armées de bidules, grandes matraques permettant à un policier de frapper pendant que l’autre conduit. Remises en service par Robert Pandraud, ministre délégué à la sécurité, elles sont chargées de « nettoyer » les rues à la fin des manifestations. Les voltigeurs prennent en chasse un jeune Arabe qui sort d’un bar de jazz à ce moment-là : Malik Oussekine. Il se réfugie dans la cage d’escalier d’un immeuble. Les policiers réussissent à entrer et le tabassent. Il décède à l’hôpital. Sa mort est médiatisée comme « une bavure scandaleuse », attribuée à une « police de droite » par la gauche au pouvoir. Elle radicalise aussi les affrontements avec les forces de l’ordre dans les manifestations des jours suivants, puis devient une « affaire d’État ». La brigade des voltigeurs est dissoute et le ministre de l’Éducation, Devaquet, présente sa démission. On parle depuis lors d’un complexe Malik Oussekine dans la police et l’État[30]. On désigne ainsi le risque de devoir subir des restructurations de services et des mesures disciplinaires à la suite d’une mauvaise gestion médiatique ou de son instrumentalisation par des factions politiciennes. Tuer en maintien de l’ordre coûte de plus en plus cher médiatiquement et politiquement.
Le soir du meurtre de Malik Oussekine, un autre crime policier est commis aux portes de Paris, au carrefour des Quatre-Chemins à Aubervilliers. À la sortie d’un bar, Abdelwahab Benyahia, 19 ans, est tué par l’inspecteur Patrick Savrey. Il n’est pas en service mais tire avec son arme sur le jeune homme qui s’interposait dans une bagarre[31]. Le policier avait passé la journée à attendre d’être mobilisé pour intervenir contre les manifestations étudiantes au commissariat de La Madeleine. La mobilisation de la famille et la constitution d’un comité « Justice pour Abdel » ont fini par aboutir à la condamnation du policier Savrey, mais le meurtre n’a eu aucun retentissement politico-médiatique. La police avait retenu l’information sur la mort du jeune homme pendant 48 heures de peur que des affrontements s’engagent.
C’est une dimension décisive du nouveau rapport de forces qui s’établit à la fin des années 1980. Il faut absolument maîtriser la médiatisation de la violence policière car son coût politique peut être élevé : elle peut contraindre à opérer publiquement des restructurations dans les appareils policiers et elle risque d’engendrer des révoltes de plus en plus puissantes. Dès lors, la maîtrise des techniques de justification de la domination policière va devenir décisive.
Notes
[1] Annuaire du syndicat des commissaires et hauts fonctionnaires de la police nationale 1984, archives de la préfecture de police E/A 127 XVII, récit de vie de policier.
[2] Jean-Marc Berlière, Histoire de la Police française. Mythes et réalités de Louis XIV à nos jours, (Documentaire), LCJ éditions, 2007.
[3] Fausto Jiudice, Arabicides, Une chronique française, 1970-1991, Paris, La Découverte, 1992, p. 73.
[4] « La BAC 93, 40 ans d’action », Police Pro, n° 30, novembre-décembre 2011, p. 24.
[5] Jérémie Gauthier, D’un aspect des politiques publiques de sécurité intérieure en France : les brigades anticriminalité (1973-2004). Enquête ethnographique auprès d’une brigade anticriminalité du Val-de-Marne, DEA de sciences sociales (dir. Gérard Mauger), 2004, p. 39.
[6] Alain Girard, « Attitudes des Français à l’égard de l’immigration étrangère. Enquête d’opinion publique », Population, vol. 26, sept. -oct.1971, p. 827-875 ; Alain Girard et al., « Attitudes des Français à l’égard de l’immigration étrangère. Nouvelle enquête d’opinion », Population, vol. 29, novembre-décembre 1974, p. 1015-1069.
[7] Alain Morice, « Du seuil de tolérance au racisme banal, ou les avatars de l’opinion fabriquée », Journal des anthropologues, 2007, p. 110-111. http://jda.revues.org/2509
[8] Michel Marié, « Quelques réflexions sur le concept de seuil de tolérance », Sociologie du Sud-Est, juillet-octobre 1975, p. 39-50.
[9] Fausto Giudice, Arabicides, op. cit., p. 126.
[10] Ibid., p. 126.
[11] Ibid., p. 128.
[12] Le Monde, 14 octobre 1974.
[13] Reflex, L’État assassine. Meurtres racistes et sécuritaires, Hors-Série n° 1, Parloir Libre-Réflexes, 1992, p. 4.
[14] Pierre Bourdieu, « Esprit d’État », in Raisons pratiques, Seuil, 1994, p. 101-133.
[15] Sylvie Tissot, L’État et les quartiers. Genèse d’une catégorie de l’action publique, Seuil, 2007.
[16] Intervention sur RTL, le 2 février 1974.
[17] Le Monde, 5 février 1974.
[18] Jean-Pierre Garnier, Le nouvel ordre local. Gouverner la violence, L’Harmattan, 1999.
[19] Michelle Zancarini-Fournel, « Généalogie des rébellions urbaines en temps de crise (1971-1981) », Vingtième Siècle, n° 84, Presses de Sciences Po, 2004, p. 119-127.
[20] Ibid.
[21] Il s’occupera notamment de la restructuration architecturale sécuritaire du quartier du Luth à Gennevilliers.
[22] Philippe Juhem, « “Civiliser” la banlieue. Logiques et conditions d’efficacité des dispositifs étatiques de régulation de la violence dans les quartiers populaires », Revue française de science politique, n° 1, 2000, p. 54.
[23] Ministère du Logement, Direction de la construction, offices HLM, DATAR.
[24] Philippe Juhem, « “Civiliser” la banlieue. », op.cit., p. 62.
[25] Ibid., p. 65.
[26] Une partie importante de ces structures n’a pas fonctionné suite au refus de travailleurs sociaux de travailler avec la police ou à celui de municipalités méfiantes à l’égard de dispositifs qu’elles ne maîtrisaient pas complètement. Adil Jazouli, Les Années banlieues, Paris, Seuil, 1992, p. 126 et p. 162.
[27] Quentin Deluermoz, Policiers dans la ville. La construction d’un ordre public à Paris, 1854-1914, Publications de la Sorbonne, 2012.
[28] Le Monde, 12 juin 1991.
[29] Étienne Balibar et Immanuel Wallerstein, Race, nation, classe, Les identités ambiguës, La Découverte, 1988.
[30] David Dufresnes, Maintien de l’ordre. Enquête, Hachette, 2007.
[31] Fausto Giudice, Arabicides, op. cit., p. 215.









