Lettre aux membres du conseil scientifique d’Attac
Le conseil scientifique d’Attac s’est ému de la tonalité de mon compte rendu critique, mis en ligne sur le site contretemps.eu, consacré à l’ouvrage Mondialisation de la prostitution récemment paru dans la collection d’Attac aux éditions Mille-et-une-nuits. Cette émotion est légitime : il est peu courant d’attaquer avec virulence les livres que l’on estime mauvais ; on préfère les ignorer pour ne pas leur faire involontairement de la publicité. Si j’ai rédigé cette note critique, c’est que ce livre m’a mis en colère, car je le trouve scientifiquement pauvre, parfois malveillant, ce qui dessert la cause qu’il défend. Ce qui explique certains excès polémiques. Ce sont donc les motivations de cette colère, et de la virulence de mon texte, que je souhaite expliciter ici.
Le propos de Mondialisation de la prostitution n’est pas nouveau ; le livre reprend la plupart des arguments en faveur d’une abolition de la prostitution, et déjà exposés dans de nombreuses publications du courant abolitionniste. Je n’avais jusqu’à présent jamais discuté ces publications car ils se présentaient d’emblée pour ce qu’ils sont : une argumentation militante visant à convertir à une cause. Le registre militant a ses exigences, qu’on ne saurait lui reprocher, qui passent souvent par grossir le trait, caricaturer les positions de l’adversaire, attirer l’attention sur tel point plutôt que tel autre, souvent une certaine mauvaise foi, voire de la démagogie. Mais avec ce livre, et avec le label d’Attac, on se trouve devant un autre registre, car à la dimension militante s’ajoute une prétention à la scientificité. Attac est une association altermondialiste d’éducation populaire tournée vers l’action, ce qui veut dire que, en fonction de valeurs et de perspectives politiques altermondialistes, et d’un éclairage rigoureux sur une réalité donnée, elle en déduit des politiques concrètes (i.e., dans la perspective d’un autre monde possible et d’un diagnostic sur les impasses et méfaits des politiques néolibérales, sont déduites des politiques économiques et sociales alternatives, à la fois viables et plus égalitaires, proposées au débat démocratique). L’existence au sein d’Attac d’un conseil scientifique porte témoignage de cette volonté d’étayer les positions de l’association (sa face militante) par un diagnostic sérieux (sa dimension scientifique). Or Mondialisation de la prostitution, comme je l’ai dit dans ma note critique, se cale trop sur des apparences de scientificité sans pouvoir le plus souvent en fournir les preuves.
Des faiblesses scientifiques nuisant au projet politique
Les apparences de la scientificité, l’ouvrage les expose par son recours constant à des données statistiques, mais le plus souvent sans que le lecteur puisse juger de leur fiabilité. La validité d’une donnée chiffrée dépend de variables telles que le mode de constitution de l’échantillon, la taille de celui-ci (spécialement en regard de la population de référence), du contexte du recueil des informations, du codage, du mode de traitement statistique, etc. Que ces informations soient absentes, cela peut se comprendre dans un ouvrage grand public, qui plus est de petit format. Par contre est inconcevable que ces chiffres soient assénés sans que soit indiquée leur source, afin que le lecteur intéressé puisse s’y référer pour parfaire sa connaissance. Quelques exemples : p. 15 il est dit que 75% des prostituées « dans le monde » sont âgées entre 13 et 25 ans — aucune référence citée —, et qu’en Thaïlande il y aurait 2 millions de prostituées pour une population de 61 millions d’habitants — aucune référence. P. 17 : il y aurait aux Etats-Unis entre 244 000 et 325 000 enfants prostitués — aucune référence. P. 22 : le profit généré par la traite des femmes serait passé de 1,5 ou 2,5 millions de dollars en 1990 à 7 ou 12 milliards en 2002 — aucune référence. P. 24 : « entre 76 et 100 % des entreprises du sexe sont contrôlées, financées ou soutenues par le crime organisé » —aucune référence, et aucune définition de ce qu’il faut entendre par « entreprise du sexe » (des sociétés de proxénètes ? des producteurs de films pornos ? des sex shops ?). P. 29 : « aux Etats-Unis, 75 % des magasins de vidéo vendent des cassettes ou des DVD pornographiques » et « plus de 65 % des connexions sur le Net se font sur des sites pornographiques » — aucune référence. Je m’arrête là pour inviter à constater par soi-même cette carence, livre en main.
Lorsque (cela arrive) des sources sont indiquées, soit elles ne sont pas référencées avec suffisamment de précision pour que l’on puisse remonter à la source (p. 16 : « selon l’Organisation internationale pour les migrations » ; p. 16 : « selon l’UNICEF » ; p. 27 : « Une étude de Scotland Yard citée par Le nouvel observateur »…), soit il s’agit d’extraits de livres ou de rapports d’organisations abolitionnistes, donc parties prenantes du débat, et chez qui les statistiques sont déjà le plus souvent de seconde main — du coup, par une espèce de mise en abyme qu’autorise la circulation des citations, on est obligé de chercher de référence en référence la source originelle de chaque donnée chiffrée (cf. p. 63-64, un ouvrage abolitionniste discutant un autre ouvrage lui aussi abolitionniste nous apprend qu’« en Australie, les études [lesquelles ?] révèlent que… » Quel jeu de piste !). Personnellement, je n’ai pas réussi à retrouver la source indiquée en note 5.
Que je me fasse bien comprendre : je ne nie pas a priori que les chiffres publiés dans l’ouvrage puissent avoir de la valeur et éclairer la réalité du monde de la prostitution. Simplement, j’aimerais (et c’est ce que peut attendre tout-e lecteur ou lectrice doté d’un minimum d’esprit critique, ce que, je crois, valorise Attac au sein de son public) en avoir sinon des preuves, au moins des indices fiables, et les ressources pour en juger. Or le silence ou le flou des auteures sur leurs sources me laisse extrêmement dubitatif ; on ne peut asseoir une argumentation sur la seule assurance avec laquelle elle est assénée.
Les auteures font valoir dans leur droit de réponse qu’elles informent elles-mêmes à deux reprises dans l’ouvrage du manque de fiabilité de leurs sources[1]. On peut s’étonner d’une démarche qui consiste à prévenir que les sources ne sont pas fiables pour ensuite se baser exclusivement sur elles pour construire son argumentation. On peut aussi s’étonner du manque de curiosité des auteures : si les sources quantitatives ne sont pas suffisamment solides, pourquoi ne pas s’appuyer sur d’autres types de sources, en l’occurrence les études qualitatives ? On est d’autant plus surpris de constater leur complète absence de la bibliographie de l’ouvrage que celles-ci sont extrêmement nombreuses et faciles d’accès. Certes, une étude sociologique par entretiens ou observations sur un site donné ne permet pas de tirer des conclusions en toute généralité sur la prostitution, mais cela permet de disposer d’informations dont la fiabilité peut être plus aisément attestée et, par recoupements et comparaisons, de cerner ce qui est transversal aux divers contextes de prostitution et ce qui tient à des configurations locales (notamment en regard des rapports de genre ou de l’encadrement juridique de la prostitution).
Curieux quand même, pour un ouvrage qui prétend à une certaine scientificité de passer sous silence l’essentiel des acquis scientifiques récents sur la question. Les tentatives de théorisations — celles de P. Tabet, de G. Pheterson, de C. Aradau… — qui font référence dans ce domaine auraient pu être discutées, critiquées (elles le méritent) voire réfutées, elles sont proprement ignorées. Les enquêtes de terrain, même lorsqu’elles portent sur des formes prostitutionnelles traitées dans l’ouvrage, sont de même ignorées : pour s’en tenir à des références en français, l’article de S. Roux sur la prostitution à Bangkok, celui de C. Brochier sur celle de Rio ou celui de M. Darley sur les « clubs » en République tchèque, par exemple, ont été publiés dans Lien social et politique et dans la Revue française de sociologie, qui ne sont pas les plus confidentielles des revues de sciences sociales.
Mondialisation de la prostitution ignore toute référence qui ne s’affiche pas d’emblée comme abolitionniste ; toute étude qui n’exprime pas d’emblée une condamnation de la prostitution est a priori suspecte, et écartée. D’où la faiblesse de la bibliographie, qui se base soit sur des comptes rendus de presse (à la fiabilité scientifique, disons, incertaine), soit sur des ouvrages explicitement abolitionnistes et qui — comme tous ceux de la p. 111 — relèvent du même registre de la compilation sans guère de rigueur et à des fins militantes de données collectées de droite à gauche dès lors qu’elles servent le propos partisan. La solidité d’une bibliographie, contrairement à ce que laissent entendre les auteures dans leur droit de réponse, n’est pas une affaire de quantité mais de qualité, et elle est ici absente.
Les études qualitatives écartées obligeraient à nuancer la vision de la prostitution défendue par les auteures, qui ne veut voir dans les prostitué-e-s que d’innocentes victimes de méchants clients et proxénètes (cf. p. 49-50, notamment). Le travail de M. Darley sur les bordels tchèques, par exemple, montre clairement que les rapports entre les prostituées et leurs clients ou « employeurs » ne sont pas fondés sur le seul asservissement — ce qui ne veut pas dire qu’il ne soit pas une composante du problème. Un éclairage un peu plus concret de la réalité prostitutionnelle impliquerait de révoquer le simplisme du récit standard de « la naïve jeune fille en détresse trompée par des proxénètes machiavéliques et obligée par la violence, la drogue et les pressions psychologiques à se livrer aux appétits écœurants d’immondes clients »[2]. Le travail de C. Hoigard et L. Finstad aurait également pu renseigner sur les proxénètes, le plus souvent originaires des mêmes milieux sociaux que les prostituées et ayant suivi la même trajectoire chaotique, et qui sont pour eux fréquemment des compagnons de galère davantage que des exploiteurs. Cette absence est d’autant plus regrettable que, s’il n’a pas été traduit en français, ce livre a fait l’objet d’une présentation dans Actes de la recherche en sciences sociales[3], et, surtout, il a été écrit par deux sociologues abolitionnistes (comme quoi ça n’empêche pas la rigueur et la nuance). Certes Mondialisation de la prostitution n’est pas une thèse de sociologie, mais un petit livre de sensibilisation, et on ne peut en attendre qu’il offre une complète revue de littérature ; reste qu’ignorer l’essentiel de la littérature pertinente affaiblit un projet politique légitime.
La vision trop schématique de la prostitution que livre l’ouvrage n’est pas seulement sensible dans la sélection des références, mais dans son écriture même, et dans la manière dont les femmes se voient systématiquement dénier toute capacité d’action — sans le vouloir le livre tend à reprendre ce qu’il dénonce : pour les auteures les prostituées apparaissent comme des marchandises, des objets inanimés, à tout le moins passifs. Seuls les proxénètes et les clients sont des êtres dotés de vouloir et de capacité d’action. Je l’ai signalé dans ma note critique : le livre reproduit dans son écriture, sur le mode du lapsus, les représentations genrées qu’il dénonce. Une fréquentation des travaux de Claire Michard et Claudine Ribéry (leur livre Sexisme et sciences humaines vient d’être réédité), est toujours utile pour cerner les impensés de son écriture.
Des aspects malveillants
J’en viens maintenant à certaines dimensions malveillantes du livre. Je l’ai signalé dans ma note de lecture, les auteures s’attaquent aux associations qui, en France, assurent une prévention du sida auprès des femmes et hommes prostitués, en accusant leur personnel de reproduire des rapports de proxénétisme. Il ne m’appartient pas, mais à ces associations (qui existent pour certaines depuis une quinzaine d’années et sont financées sur fonds publics et associatifs, notamment via le Sidaction) de juger si ces propos sont diffamatoires. Par contre, je ne peux que m’indigner de l’assertion selon laquelle les animatrices reproduiraient une forme de « maquerellage ». J’ai observé l’activité de ces associations plusieurs années durant, et je n’ai jamais observé quoi que ce soit relevant du proxénétisme dans leur pratique.
Par contre, l’accusation est ancienne parmi les abolitionnistes (en 92 et 93, le Bus des femmes et Cabiria n’avaient pas encore distribué leur premier préservatif que le Mouvement du Nid distillait déjà des soupçons de cet ordre), et relève d’une concurrence inter-associative qui n’a pas grand chose à faire dans un livre de la collection d’Attac. Un bref rappel est cependant nécessaire pour qui ne connaîtrait pas l’histoire de ces rapports inter-associatifs. En 1960, la France a mis fin à un encadrement sanitaire de la sexualité vénale et adopté une vision de la prostitution — conforme à l’abolitionnisme — comme inadaptation sociale, et finance depuis des organismes de travail social destinés à aider les prostitué-e-s en détresse et à leur proposer une réinsertion. Cette approche sociale s’est trouvée en situation de monopole jusqu’à la fin des années 80, où l’apparition du sida a ramené au premier plan la dimension sanitaire de la prostitution. Le travail social spécialisé n’ayant pas souhaité ajouter la prévention du sida à son action, d’autres structures ont émergé pour prendre en charge la lutte contre le sida, qui ont axé leur intervention non plus sur l’horizon à moyen ou long terme de la réinsertion, mais dans celui d’une aide d’urgence aux personnes prostituées — d’autant plus nécessaire que la précarité de leurs conditions d’existence montrait que pour la majorité d’entre elles, la perspective de la réinsertion était dépourvue de sens. Inspirées des principes humanitaires de la santé communautaire, ces associations ont embauché des (ex) prostitué-e-s pour conduire auprès de leurs pairs une prévention adaptée à leurs besoins. Depuis, si l’abolitionnisme n’a toujours pas digéré de voir remis en cause son ancien monopole sur l’encadrement social de la prostitution, les deux types d’action — social et sanitaire — coexistent, et ne sont certainement pas de trop pour aider les prostitué-e-s. Qu’à une époque où les subventions publiques se raréfient, où l’idée fausse se répand que « le sida c’est fini », les auteures estiment bon de relancer la concurrence inter-associative ne peut que porter préjudice aux personnes prostituées elles-mêmes.
J’ajouterais que le droit de réponse des auteures m’a estomaqué lorsqu’elles accusent les associations de santé communautaire de « perpétuer une approche purement hygiéniste de la population prostituée dans la grande tradition héritée du 19ème siècle du Dr Parent-Duchâtelet, ghettoïsant ». La méconnaissance est ici encore au rendez-vous. L’hygiénisme auquel elles font référence consistait à enregistrer les prostituées (la « mise en carte ») et éventuellement à les enfermer dans des maisons closes pour les contraindre à des contrôles sanitaires obligatoires[4]. La santé communautaire consiste quant à elle à aller à la rencontre des prostitué-e-s pour leur proposer gratuitement du matériel de prévention (préservatifs, seringues…), leur apporter un peu de réconfort (autour d’un café servi dans un camping-car), les conseiller (sur tout problème sanitaire, juridique ou social) et pour leur proposer un accompagnement en cas de besoin (souvent les prostitué-e-s sont exclu-e-s de leurs droits car elles/ils « n’osent pas » solliciter administrations ou services sociaux). Les deux n’ont donc strictement rien à voir.
Un livre politiquement contestable
Dernier point : le livre est politiquement contestable, lorsqu’il fait la promotion de la législation suédoise qui réprime le client. L’enjeu n’est pas ici moral, mais pratique. A défaut d’avoir pu accumuler un minimum d’observations rigoureuses sur ce dispositif et ses effets, on peut déjà anticiper les risques de fragilisation des prostitué-e-s qu’il recèle, en rendant leur activité plus clandestine et précaire. Les bonnes intentions (faire en sorte que la prostitution disparaisse) pourraient se retourner contre celles et ceux qu’on voulait protéger. Je m’en suis déjà expliqué dans plusieurs publications et ne vais pas répéter mes arguments ici[5]. Un parallèle sera cependant éclairant.
La politique suédoise part du postulat que l’amélioration du sort des prostitué-e-s passe par rendre leur activité plus difficile : faire du client un délinquant c’est l’exposer à un coût (la honte publique, une amende, la prison) à même de le dissuader de fréquenter les prostitué-e-s ; celles-ci, voyant leur activité péricliter seront amenées à l’abandonner et à se réinsérer. C’est peu ou prou le raisonnement adopté par la France en 1970 en matière de toxicomanie : l’amélioration du sort des drogués passe par rendre plus difficile leur accès à la drogue ; faire du dealer un délinquant c’est l’exposer à un coût (la prison) à même de le dissuader de vendre de la drogue ; les drogués rencontrant des difficultés à s’approvisionner en drogue seront amenées à cesser leur consommation et à se sevrer. On sait aujourd’hui quelles ont été les conséquences de cette politique : certes il est devenu plus difficile de trouver les drogues, mais les drogués n’ont pas cessé de s’intoxiquer, car pas plus que la prostitution (ou arrêter l’alcool, ou se séparer d’un conjoint violent) cela ne se décide du jour au lendemain. Les drogués ont continué à le faire en payant plus cher (d’où une augmentation de leur délinquance) pour des produits de moins bonne « qualité » (d’où une augmentation des overdoses). Leur toxicomanie est devenue plus précaire et par contrecoup plus dangereuse, et les centaines de toxicos morts du sida car obligés de se partager leur seringue témoignent que cette politique affichant de bonnes intentions (qui serait contre le fait que les toxicomanes cessent de se droguer ?) a eu des effets pervers dramatiques. Le parallèle vaudrait pour la prohibition (qui n’avait pas mis un terme à la consommation d’alcool) ou pour l’interdiction de l’avortement (qui ne l’avait certes pas fait disparaître, mais qui obligeait les femmes à payer cher une pratique exercée dans des conditions de clandestinité dangereuse pour leur santé).
Un mécanisme analogue est prévisible en matière de prostitution : si l’on cherche à rendre plus difficile la rencontre entre prostitué-e et client, celle-ci ne disparaîtra pas (ne serait-ce que parce que les prostitué-e-s n’ont d’autre choix immédiat que de trouver des clients), mais elle se fera dans des conditions qui leur seront défavorables (c’est déjà le cas depuis la loi sur la sécurité intérieure : les clients contraignent à la baisse des prix et demandent encore plus de pratiques à risques). En criminalisant les clients, c’est l’ensemble de l’activité prostitutionnelle que l’on criminalise, avec pour effet de précariser et de contraindre davantage encore les prostitué-e-s à la clandestinité. La politique suédoise — comme toute politique répressive, qu’elle vise les clients ou les prostitué-e-s — est une impasse, qui sert principalement à « nettoyer » les rues.
On remarquera que le parallèle avec la toxicomanie éclaire aussi les rapports entre travail social et prévention du sida auprès des prostitué-e-s : lorsqu’on a commencé à penser à distribuer des seringues (puis des produits de substitution) aux drogués pour leur éviter de se contaminer entre eux, tout le secteur médico-social promoteur du sevrage, dominant à l’époque, s’est indigné car ce faisant on aidait les toxicomanes « à mieux se droguer », alors qu’il convenait de les en empêcher. Au même moment les abolitionnistes qui ne juraient que par la réinsertion s’indignaient qu’en distribuant des préservatifs on aidait les prostitué-e-s à « mieux se prostituer ». Or dans les deux cas, le sida a révélé qu’il était avant tout besoin d’une action préventive d’urgence et prenant pour cible les conditions immédiates de la pratique (toxicomanie ou prostitution), avant d’envisager à plus long terme d’éventuels sevrage ou réinsertion — et en outre qu’il revenait aux personnes elles-mêmes de décider si et quand elles entreprendraient un sevrage ou une réinsertion.
Les auteures de Mondialisation de la prostitution ont tout à fait le droit de ne pas partager cette lecture. Mais on ne peut présenter comme elles le font la « solution » suédoise comme une panacée en écartant d’un revers de main la moindre des critiques dont elle a déjà fait l’objet (« la législation suédoise ne semble pas rejeter les prostituées dans la clandestinité », p. 44 [je souligne], en s’appuyant sur un ouvrage partisan). J’ajouterai qu’il me semble toujours curieux de vouloir résoudre ou réduire un problème social par des voies répressives — pour ma part je ne confonds pas travailleur social et policier.
Manque également dans cette présentation enchantée de l’expérience suédoise un élément pas si anodin que ça : ce qu’en pensent les premières intéressées elles-mêmes. Si l’on nous dit (p. 103) que depuis l’instauration de la criminalisation des clients la prostitution de rue a diminué de 50 %, on ne sait rien en revanche sur ce que sont devenues les prostitué-e-s qui ont déserté l’espace public : ont-elles été contraintes à se racoler ailleurs (et où ? dans quelles conditions ?) ou ont-elles bénéficié des mesures d’aide évoquées p. 45 ? En quoi consistent ces mesures ? En sont-elles satisfaites, ou regrettent-elles leurs anciennes conditions d’exercice ? Tant qu’une évaluation sérieuse prenant en compte l’opinion des prostitué-e-s ne sera pas produite, le bilan de la loi restera incomplet.
C’est d’ailleurs une carence de tout l’ouvrage, qui rejoint les problèmes d’écriture évoqués plus haut : les prostitué-e-s ne sont jamais considéré-e-s comme des individus pouvant avoir des souhaits, des intérêts, des désirs autonomes. La définition de ce en quoi consiste le bien des prostitué-e-s n’appartient visiblement qu’aux seul-e-s abolitionnistes. A cette occultation de la parole des personnes prostituées, qui conduit à les traiter comme des mineures, les abolitionnistes ont généralement une réponse toute prête : celles-ci seraient par trop aliénées pour disposer d’une parole autonome, et doivent s’en remettre à d’autres pour la défense de leur destin collectif. Cette posture à la tonalité d’un « super léninisme » (l’avant-garde éclairée au service des dominés trop aliénés pour avoir conscience de leurs intérêts, les dépossédant complètement de leur parole). En revanche, je suis pleinement d’accord avec les auteures quand elles écrivent dans leur droit de réponse que les prostitué-e-s montrent tous les jours leur capacité d’action, « ne serait-ce que pour résister aux violences, au mépris, à l’humiliation, dont sont si friands les “clients” et si coutumiers les proxénètes ». Le problème est que le livre suggère constamment le contraire, via l’abus de formes passives et le recours à un pathos par trop misérabiliste[6].
En guise de conclusion
Dernier mot : les auteures me reprochent dans leur droit de réponse de ne pas remettre en cause, entre autres choses, « les méthodes des proxénètes, ou le “droit” séculaire des hommes à disposer du corps d’autrui, notamment féminin ». Ce reproche est assurément bien vu : il n’en est effectivement pas question dans ma note critique. La réponse est que cela n’était pas, dans mon texte, le propos : celui-ci était de pointer que l’autorité avec laquelle les auteures assénaient péremptoirement leurs chiffres et leurs assertions était fondée sur des assises particulièrement fragiles, au point d’affaiblir leur propos et de la légitimité de leur projet politique[7].
Ce courrier est long, et pourtant je n’ai fait que pointer les principaux problèmes que pose ce livre. Une lecture page à page (je suis prêt à me livrer à l’exercice) permettrait de relever toutes les approximations (par exemple : prostitution, pornographie et pédophilie sont allègrement mélangées[8]), contradictions (p. 45 c’est la demande qui semble déterminante, p. 62 c’est l’offre) ou erreurs[9] qu’il contient. J’estime beaucoup le projet d’Attac et, sans en être membre, j’en suis sympathisant. Je regrette vraiment que ses appuis scientifiques aient ainsi pu être affaiblis.
Bien cordialement
Lilian Mathieu
Vous pouvez lire ici le compte-rendu dont il est question dans ce texte
Et consulter ici le droit de réponse des auteurs du livre
[1] Mais elles ne vont pas jusqu’à tenir compte de leur faible cohérence : p. 15 on nous assène qu’il y aurait 1 à 2 millions de prostitué-e-s en Europe occidentale, dont 15 à 20 000 en France (c’est-à-dire l’un des pays les plus peuplés de la dite Europe occidentale) — où peuvent bien être regroupé-e-s les 980 000 ou 1 980 000 prostitué-e-s restantes ?
[2] Au passage, ce récit horrifique a une histoire : c’est (commerçants juifs en moins) celui dans lequel se coulait la « rumeur d’Orléans » étudiée en son temps par Edgar Morin et dont le travail historique d’Alain Corbin (Les filles de noces, 1978) avait montré la prégnance dans la panique morale (similaire à celle qu’entretient Mondialisation de la prostitution) du début du XXe siècle autour de la « traite des blanches ».
[3] Là aussi pas la plus confidentielle des revues de sciences sociales, et dans un n° de 1994 consacré à « la vente du corps », dont visiblement les auteures ne semblent pas avoir entendu parler.
[4] Qu’on se réfère pour en juger aux écrits de Parent-Duchâtelet, réédités par Corbin aux éditions du Seuil, et surtout, une nouvelle fois, aux Filles de noce.
[5] Cf. Lilian Mathieu, « La prostitution entre morale et pragmatisme », Mouvements, n° 11, 2000, et La condition prostituée, Paris, Textuel, 2007.
[6] Les 7 dernières lignes de la page 90 donnent une idée de la représentation que les auteures se font des personnes qui exercent la prostitution.
[7] Je ne méconnais pas pour autant la violence du monde de la prostitution, et spécialement celle des proxénètes et des clients (mais aussi celle des personnes prostituées elles-mêmes, pas toujours si « innocentes victimes ») ; j’y ai même consacré tout un chapitre (le 3e) de La condition prostituée — comme quoi je ne me contente pas, contrairement à ce qu’affirme le droit de réponse, « dans [m]es travaux sur ce sujet, d’analyser la précarité ».
[8] Page 65, on passe sans transition des bordels hollandais au démantèlement d’un réseau de diffusion de photos pédophiles ; la juxtaposition suggère un lien entre les deux, mais on attend toujours de savoir en quoi il consiste.
[9] Juste deux, colossales : la convention de l’ONU de 1949 ne vise pas l’abolition de la prostitution mais la répression de la traite des êtres humains et de ?l’exploitation de la prostitution d’autrui (p. 35), et les pays cités p. 46 n’ont pu légaliser la prostitution, du simple fait qu’elle n’y était pas préalablement illégale. Associer les établissements de prostitution hollandais à un « service public » (p. 41) témoigne pour sa part d’une méconnaissance des différences entre entreprise privée et service public — ce qui est inquiétant dans une publication estampillée Attac.

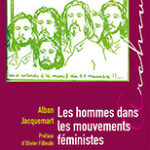

![Récits de militantes : Annick Coupé, de mai 68 au mouvement altermondialiste [Podcast]](https://www.contretemps.eu/wp-content/uploads/annick-coupe-150x150.jpg)





