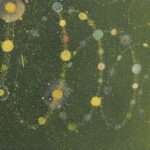Vera Furacão : le témoignage d’une brésilienne et pionnière du bois de Boulogne
La couverture du magazine Le Matin du 24 octobre 1981 annonçait le titre « Les travestis sont entrés dans Paris… »[1]. Au Brésil, l’apparition de la première génération de travesties[2] brésiliennes a changé les limites du masculin et du féminin qui existaient auparavant. C’est à partir de cette décennie qu’un nouveau mode de vie émerge grâce aux techniques de changements corporels telles que les injections d’hormones et de silicone. Les premières travesties ont été visibles publiquement à travers des spectacles travestis lancés dans les théâtres de Rio de Janeiro et de São Paulo. Dans les années 1970, le nombre des personnes ayant ce mode de vie augmente et, au-delà de la scène artistique, celles-ci gagnent les trottoirs des grandes métropoles brésiliennes. C’est ainsi qu’elles deviennent un groupe social reconnu nationalement, provoquant des réactions multiples telles que l’abjection, le mépris, la pitié, le rejet mais aussi des sentiments d’attirance, d’admiration et de curiosité.
Dix ans après l’apparition du spectacle travesti au Brésil, certaines rêvent d’ailleurs. Un imaginaire attirant de la France comme pays de plaisirs et de glamour, construit depuis le XIXe siècle, sert de motif d’appel à ce groupe social[3]. Inspirées par les échos du cabaret trans français internationalement célèbre depuis les années 1950 et remplies par l’espoir de meilleures conditions de vie, les travesties brésiliennes partent à l’aventure pour Paris. De la même façon qu’au Brésil, elles occupent dans la capitale française une place bien définie : la grande majorité survit en tant que travailleuses du sexe tandis qu’une minorité évolue comme artistes dans le monde du spectacle. En dehors de ces univers, la possibilité d’existence des travesties reste faible.
L’immigration des travesties à Paris est un événement qui marque à la fois l’histoire de ce groupe et l’histoire récente de la ville de Paris. D’une part, Paris et ses symboles sont devenus des éléments structurels de l’identité des travesties brésiliennes ; d’autre part, même si elles n’ont pas fondé la prostitution des travesties dans la ville, leur arrivée a créé une nouvelle dimension et une visibilité à cette modalité spécifique dans le commerce du sexe. En effet, les travesties brésiliennes ont inauguré un nouveau type de personnage dans les rues de Paris : « le travelo brésilien ». Leur présence était tellement remarquable qu’un glissement sémantique s’établit et l’expression « les brésiliennes » devint équivalente du terme « travesti ».
Ce texte a pour but de présenter le récit de vie de Vera Furacão, l’une des travesties pionnières qui a émigré du Brésil vers Paris en 1979, dont l’histoire permet d’en savoir un peu plus sur les méandres de ces personnes. Les souvenirs de Vera m’ont été confiés au cours de deux ans de fréquentation. Nous nous sommes rencontrées à l’association Prévention Action Santé Travail pour les transgenres (PASTT) en 2016. Je lui ai expliqué que je faisais une recherche doctorale sur les expériences des « brésiliennes » et c’est pourquoi Vera a accepté de raconter ses souvenirs, en comprenant comment son histoire de vie devenait importante à la mise en lumière de ces personnages oubliés par la société. Nous avons fini par nous voir régulièrement soit chez elle, soit au PASTT, et quelquefois nous nous sommes promenées dans Paris. Grâce à nos conversations, toujours dans notre langue maternelle, j’ai beaucoup appris sur les coulisses de l’histoire des travesties de Paris et également sur leur vie brésilienne dans les années 1970.
*
Vera Furacão est née le 14 novembre 1950 à Alto Paraguai dans l’état de Mato Grosso au centre-ouest du Brésil. Issue d’une famille pauvre, Vera passe son enfance dans cette petite ville de la campagne entourée de ses quatre sœurs, de ses neuf frères et de ses parents. Son père travaillait dans les mines et sa mère était mère au foyer pour élever les treize enfants. Depuis son très jeune âge, Vera était un garçon efféminé et déjà attiré par les hommes – caractéristique propre aux travesties brésiliennes que de se reconnaître dès l’enfance homosexuelles[4]. Elle a été confrontée très tôt à des propositions d’hommes plus âgés pour avoir des relations sexuelles en échange d’argent ou de petits cadeaux[5]. Parmi les hommes avec qui elle échangeait, le plus régulier était un prêtre de la paroisse qui lui payait des rencontres avec des tickets de cinéma. La relation avec sa famille étant tendue et son environnement hostile, Vera s’enfuit plusieurs fois de la maison et pratiqua l’école buissonnière. À l’âge de 15 ans, elle fuit sa famille et quitte Alto Paraguai en autostop, dans un périple de près de 2500 km pour atteindre la ville de Rio de Janeiro. Lors de sa première tentative de fugue, elle fut récupérée à Rio par son père, qui l’a aussitôt ramenée au domicile parental. Pourtant, l’envie de vivre librement sa sexualité triompha, Vera reprit la route et quitta définitivement sa petite ville de naissance.
Dès son arrivée à Rio de Janeiro, elle vit la vie typique d’une travestie dans les années 1960-70, comme travailleuse du sexe. Elle s’installe à Lapa, quartier bohème de la ville, où elle trouve dans la prostitution le moyen de subvenir à ses besoins. C’est dans cet univers que Vera rencontre pour la première fois la figure de la travestie tandis qu’elle fait la connaissance d’Angela, qui devient sa mère-travestie. À l’âge de 16 ans, Vera commence à prendre des hormones et, à 17 ans, fait sa première application de silicone industrielle. Elle passe douze ans comme travestie prostituée au Brésil, avant d’émigrer en Europe. Pendant cette période, si elle se déplace beaucoup entre São Paulo, Belo Horizonte, Salvador et d’autres métropoles brésiliennes, c’est à Rio de Janeiro, la ville la plus vivante, qu’elle travaille le plus souvent et fréquente les bals de carnavals, les traditionnels baile dos exutos[6] et les boîtes de travesties. Elle y côtoie Madame Satã[7], qui jouissait de son statut de légende vivante, ainsi qu’une grande partie du groupe des travesties qui y circulaient à l’époque des années 1960-1970. Cette période de grande effervescence festive des travesties de Rio a une place spéciale dans la mémoire de Vera.
Dans l’environnement prostitutionnel à Lapa, un quartier connu pour la présence des prostituées et ses divertissements bohèmes depuis la fin du XIXe siècle, les travesties commettaient diverses infractions mineures comme le vol des clients qui, ajoutées au délit de racolage, amenaient régulièrement à des arrestations par la police. Après l’une de ces rafles, Vera finit par passer quelques jours en prison où elle subit des violences de la part des policiers et des autres prisonniers. Malgré quelques difficultés évidentes comme les violences et les exclusions liées à son genre, Vera était satisfaite de sa vie au Brésil – en effet, les travesties vivaient leur apogée sur le territoire national. Pourtant, le rêve de Vera, comme celui d’une grande partie de ses amies, était de partir vivre à Paris. Si, depuis le début des années 1970, elle entendait parler de la capitale française, elle eut la preuve de la richesse et de la réussite de ses collègues à Paris lorsqu’elle vit de nombreuses travesties arborer des bijoux, des vêtements et des chaussures de marques françaises lors des défilés du carnaval de Rio.
Vera arrive à Paris en 1979. Elle raconte que dès son arrivée, elle commence à travailler à Pigalle et au bois de Boulogne : « Les travesties arrivaient avec leurs petites valises et allaient directement au bois de Boulogne. Elles ne savaient même pas parler français. Mais le langage du tapin est universel »[8]. Lors de ses premières années dans la capitale, Vera habite à plusieurs endroits dans le 17e arrondissement. D’abord, elle demeure à l’hôtel Bessé, boulevard de Batignolles, ensuite à l’hôtel Saint Jean de la rue de Clichy, proche de la porte de Clichy, puis dans un foyer dans la rue Lécluse, avant de déménager rue des Dames, et finalement, sa dernière adresse fut dans un hôtel rue de Rome. Les prix varient entre 3.000 et 4.000 Francs (équivalent à 457 et 610 euros) par mois. Vera affirme qu’il était plus simple à cette époque de trouver un hôtel ou un appartement : « on payait deux loyers et c’était bon, si on avait l’argent c’était bon, on n’avait pas besoin de papier ni de garant ». Vera décide de quitter le 17e pour aller habiter à Saint-Germain-des-Prés, rue de Villersexel, en colocation avec trois amies brésiliennes Michele Caolha, Flora et Marcia do Bundão. La photographie ci-dessous a été prise dans l’appartement de Saint-Germain.

Vera raconte qu’elle « faisait la madame » à Saint-Germain et « faisait la pute » entre Anvers et la place Blanche. Régulièrement, elle travaillait à Pigalle, au bois de Boulogne et, de temps en temps, dans le 17e arrondissement de Paris proche du métro Rome ; elle racolait dans les rues et recevait les clients dans les hôtels du quartier. Elle ne payait pas le maquereau à Pigalle car elle n’y habitait pas. Elle affirme ne jamais avoir eu de problème avec les proxénètes à Pigalle car les travesties géraient elles-mêmes leur réseau. Au bois, il y avait de nombreuses brésiliennes, et Vera se rappelle qu’à la fin de la semaine, il y avait des embouteillages de clients ou de gens curieux pour les voir. Malgré cette suprématie des brésiliennes, Vera a rencontré des problèmes de négociation pour son placement dans les allées du bois. Les hommes du Gros Dédé, le célèbre maquereau[9], lui demandèrent de l’argent pour payer sa place. Pour fuir cette extorsion, elle chercha avec plusieurs collègues d’autres endroits pour racoler et faire la passe et finit par s’installer dans la forêt de Saint-Germain-en-Laye – où les photographies ci-dessous ont été prises.

Vera à Saint-Germain-en-Laye, vers 1985 (source : Archive de Vera )

Vera et son amie, Saint-Germain-en-Laye (source : Archive Vera)
Certes, à Saint-Germain-en Laye, la fréquentation était moindre qu’au bois de Boulogne, du fait de la distance qui sépare la forêt de Paris et de sa moins grande réputation comme endroit où trouver du sexe tarifé. Mais le lieu offre des conditions de travail similaires à celles au bois de Boulogne, dans le sens où les travesties racolaient à la marge de la forêt et faisaient la passe derrière les arbres.
Le bois de Boulogne et Pigalle étaient les points de concentration privilégiés de la prostitution brésilienne. Mais cette activité avait une territorialité fluide ; il existait d’autres points de prostitution isolés des travesties brésiliennes dans plusieurs quartiers de la ville. Cette prostitution étalée s’explique par le fait que, par facilité, certaines travesties habitant en dehors du 9e arrondissement racolaient parfois à côté de chez elles. Selon Vera, à cette époque, « Paris était dominé par les brésiliennes ». Ce succès s’accompagnait d’un avantage financier : les prix de la passe des brésiliennes étaient plus élevés que ceux des travesties d’autres nationalités et parfois même plus chers encore que ceux des prostituées femmes. Les revenus de Vera pouvaient atteindre jusqu’à 2.000 Francs par nuit de travail au bois de Boulogne. Pourtant, son mode de vie l’empêchait d’épargner. Elle dit : « Si je ne dépensais pas tout dans les drogues, les fêtes et les vêtements, je serais riche ». Les conditions de travail dans la rue la conduisaient parfois à la consommation de drogues : pour supporter le froid, elle prenait du whisky avec des pilules d’amphétamines pour tenir toute la nuit.
En termes de sociabilité, la fin des années 1970 et le début des années 1980 étaient aussi flamboyantes pour le divertissement gay. Vera fréquentait souvent les fêtes au Palace et les soirées au Galaxy ou celles à l’Opera Night, endroits très célèbres de la nuit parisienne. Le jour, elle se promenait à Pigalle dans les magasins où les travesties achetaient leurs tenues ; quelques couturières s’étant spécialisées pour confectionner des vêtements adaptés comme Angela Pavon, styliste qui crée aujourd’hui encore des collections « couture pour travestis », rue des Dames. Vera se rappelle un certain nombre d’établissements où elle allait fréquemment avec ses amies travesties pour faire des courses. Elle se souvient d’un magasin de chaussures rue Lafayette qui vendait des hauts talons à grande pointure, d’un autre à Pigalle qui vendait des robes du soir, ainsi que des friperies et des marchés à Barbès où elle trouvait des ingrédients typiques de son pays, mais aussi du maquillage, des accessoires de beautés et des parfums à bas prix.
Vera conciliait le travail de prostituée avec un emploi officiel dans une usine de papier qui appartenait à un de ses clients, où elle faisait le ménage pendant la journée. Elle était une des seules travesties à vouloir s’engager dans un travail réglementé alors même que le marché sexuel payait mieux. Vera raconte avoir eu un travail et pu obtenir son titre de séjour et rester régularisée. Elle souligne sa chance dans le sens où, quelques années plus tard, « l’immigration a fermé pour les brésiliennes ».
Le marché prostitutionnel commence à se détériorer avec les décès des premières victimes du SIDA. Vera relate que la mort de Fabrice Emaer[10] a choqué toute la communauté gay de Paris : « Tout le monde avait peur, au bois les travesties disparaissaient du jour au lendemain et la police nous arrêtait de plus en plus souvent, le bois a été fermé à plusieurs reprises ». Ce sujet est toujours délicat lorsqu’il faut reprendre ces souvenirs douloureux, car une grande partie de ses amies sont décédées de la maladie. Vera affirme qu’avant d’avoir des informations plus précises concernant le SIDA, personne ne savait ce qui se passait, elle s’attendait chaque matin à mourir comme ses collègues. Avec les difficultés dans le bois de Boulogne, elle trouve une solution pour baisser son loyer et déménage dans une pension à la Porte de Saint-Ouen, la Villa Biron – habitée par des Portugaises à cette époque. Dans le bâtiment, il n’y a pas de commerce sexuel. Mais Vera inaugure la débauche par le biais d’annonces publiées dans le magazine La Vie Parisienne. Comme Vera ne savait pas écrire, elle demanda à son amie Marina de l’aider à rédiger et poster les annonces. Ses amies ne croyaient pas en la réussite de l’entreprise de Vera à cause de l’emplacement de la Villa Biron, éloignée du centre-ville et du bois de Boulogne. Pourtant, le commerce sexuel par les annonces s’est développé avec succès, et Vera revendique la création de cet espace qui, aujourd’hui encore, est un lieu de la prostitution travestie.
Malgré la répression policière et la baisse de la clientèle due à l’épidémie de SIDA, Vera fréquente de temps en temps le bois, par nostalgie et pour arrondir ses fins de mois. En 1993, une tragédie bouleverse la vie de Vera : en rentrant du bois avec un client, elle subit un accident de voiture et passe 13 mois à l’hôpital, dont trois dans le coma. Elle eut de sérieuses blessures, son rétablissement fut lent, et aujourd’hui encore, elle souffre de problèmes de mobilité. Après sa sortie de l’hôpital, Vera quitte la Villa Biron et trouve un studio à Marcadet-Poissonniers. Son impossibilité de travailler l’a conduite à demander l’aide de l’Association PASTT et de son amie Camille Cabral. Après les efforts de cette dernière, Vera a réussi à obtenir la nationalité française qui lui accorde des aides sociales et des allocations de l’État pour personnes en difficulté.
Aujourd’hui âgée de 68 ans, Vera vit dans un HLM dans le 15e arrondissement loué par l’intermédiaire de l’association PASTT. Le loyer subventionné a considérablement amélioré les conditions de vie de Vera qui réussit à subvenir seule à ses besoins, de manière correcte – ce qui serait très difficile au Brésil. Vera rentre très rarement dans son pays natal et elle se dit satisfaite de sa vie parisienne. Pleine d’espoir, elle pense encore au futur et c’est pourquoi elle compte faire une prochaine chirurgie plastique par un médecin connu dans le cercle des travesties à Paris, dans un cabinet médical du 2e arrondissement, pour relever le silicone de ses joues.
Ce parcours si particulier révèle les singularités de la vie d’une travestie brésilienne, que ce soit dans son pays ou à Paris. Le rejet de la famille, le passage par les rues du Brésil, l’insertion presque obligatoire dans le marché du sexe, l’utilisation des techniques de modification corporelle pour atteindre les contours féminins et, enfin, le rêve d’avoir une nouvelle vie à Paris, sont communs à une grande partie des travesties brésiliennes. En effet, le récit de vie de Vera Furacão jette une lumière sur l’expérience de l’accord implicite entre ces personnages et la commuté française qui les accueille et les garde dans une marginalité spécifique de genre, de profession, de nationalité et de sexualité.
*
Marina Duarte est post-doctorante à l’Université Paris 8 (LEGS), docteure en histoire de l’Université Paris Diderot – Paris 7 (CERILAC).
Notes
[1] Le numéro du magazine Le Matin daté du 24 octobre 1981 consacre un dossier spécial aux travesties. Deux reporters, Elisabeth Salvaresi et Manuel Joachim, qui ont vécu plus d’un mois et demi parmi les travesties à Paris, y présentent leur travail de terrain.
[2] Le sens du terme « travesti » dans cet article n’est pas corrélé à la définition du dictionnaire ni à son utilisation dans le quotidien. Dans le sens commun, le mot « travesti » est souvent évoqué et compris avec une connotation péjorative. Son rattachement au terme « travelo » dans les années 1970 – moment de l’entrée des travesties brésiliennes et de l’augmentation de la prostitution travestie à la capitale – 1980 ne fait qu’alourdir son côté négatif. Dans le contexte de cette étude, ce terme doit être compris comme un mot qui désigne un groupe formé dans la culture brésilienne qui a acquis des caractéristiques propres de son environnement. Cette approche est basée sur une perspective qui privilégie le catégorie emic ?. C’est-à-dire que, d’une part, les sujets seront appelés par la façon dont ils/elles se reconnaissent – parler des travesties au féminin, par exemple – et, d’autre part, les points de vue des acteurs et leur parole, leur mémoire, seront valorisés. Cette interprétation dite emic s’oppose à la méthodologie etic qui repose sur des observations externes non intéressées par des significations portées par les acteurs. C’est avec ce regard, sensible aux paroles des acteurs, que j’ai pu diagnostiquer la fluidité avec laquelle les mots travestie, transsexuelle, transgenre, sont utilisés dans leur quotidien sans la rigueur qu’une taxonomie figée attendrait. Contrairement à ce que les scientifiques souhaiteraient, une classification bien définie de ce que ces mots représentent – qui rendrait l’explication plus claire – n’est pas évidente Ces analyses sont issues d’une discussion théorique dans le champ de la linguistique. Voir Jean-Pierre Olivier De Sardan, « Émique », l’Homme, n°, 147, 1998, p. 153.
[3] Voir : Lola Gonzalez-Quijano, Paris Capitale de l’amour. Filles et lieux de plaisir à Paris au XIX siècle, Paris, Vendémiaire, 2015.
[4] Selon Don Kulick, les autobiographies des transgenres nord-américains et européens, n’ont aucune mention d’un désir homoérotique en tant que déclencheur d’autoperception comme personne transsexuelle. Au contraire, l’idée d’attirance sexuelle par des hommes, en tant que fait décisif pour le processus de transition de genre, est constamment niée. Ainsi, pour l’anthropologue, ce lien entre homosexualité et transsexualité est propre aux récits de vie des travesties brésiliennes. Don Kulick, Travesti – Prostituição, Sexo, Gênero e Cultura no Brasil, Rio de Janeiro, Fio Cruz, 2013 p. 67.
[5] Dans son récit, Vera ne nomme pas ces relations comme des viols ou des abus.
[6] « Baile dos enxutos » était un célèbre bal de carnaval à Rio de Janeiro qui a connu son apogée dans les années 1950 1960 et 1970.
[7]João Francisco dos Santos né à Gloria do Goitá, le 25 février 1900 et mort à Rio de Janeiro, le 12 avril 1976, connu populairement par le surnom de Madame Satã était un transformiste brésilien. Il était une figure emblématique et un des personnages le plus représentatif de la vie du quartier de Lapa dans la première moitié du XXe siècle.
[8] Citation originale : « elas não sabiam falar francês, mas pra « fuder » a lingua é universal ».
[9] Le Gros Dédé a été arrêté en mars 1993. Le proxénète marseillais possédait de nombreux studios dans la capitale qui étaient loués par les prostituées qui lui versaient entre 70.000 à 100.000 F par mois. A.G, « Le Gros Dédé tombe à Paris », Parisien Libéré, 29 août 1993.
[10] Fabrice Paul Emaer, célèbre producteur de la nuit parisienne et propriétaire du club Le Palace, est mort le 11 juin 1983.