
Marxisme, religion et socialisme en Amérique latine
À propos de Luis Martínez Andrade : Dialectique de la modernité et socialisme indo-américain, L’Harmattan, 2023, 190 p.
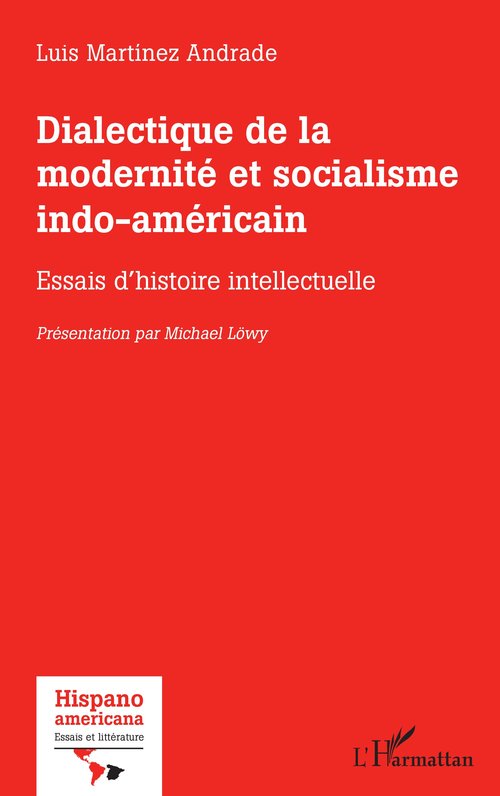
La première chose que l’on note lorsque l’on ouvre le livre de Luis Martínez Andrade, c’est la composition de son sommaire. Il s’agit en effet d’une compilation de six articles dont les thématiques se croisent, bien qu’ils soient indépendants les uns des autres. On note aussi que trois articles contiennent déjà dans leur titre des références directes à la religion. Celui choisi pour le recueil, de même que la distribution des articles, masque le fait que la moitié du livre s’engage dans une réflexion sur le rapport souvent tendu entre socialisme et religion, phénomène auquel l’on pouvait s’attendre puisque son auteur est l’un des plus importants sociologues de la religion de la jeune génération en Amérique Latine.
Dialectique de la modernité et socialisme indo-américain est une œuvre d’histoire intellectuelle qui présente l’ouvrage de certains auteurs marxistes latino-américains, qui tente de trouver des affinités possibles avec des auteurs non marxistes, et finalement, qui montre qu’il n’est pas possible de laisser la religion de côté pour penser la politique émancipatrice sur ce continent. Au fond, ainsi que le suggère Andrade, la dialectique de la modernité doit prendre au sérieux son contenu théologique très souvent refoulé. Bien plus que sur le « socialisme indo-américain », il s’agit d’un livre sur le socialisme en Amérique latine.
C’est au chapitre d’ouverture que ce livre emprunte son sous-titre « Socialisme indo-américain ». Ici, Andrade nous propose une très informée et rigoureuse introduction à la pensée et la vie du marxiste péruvien José Carlos Mariátegui. Selon lui, « Mariátegui produit une synthèse dialectique entre la tradition (éléments de socialisme pratique) et le présent (luttes des classes) tournée vers l’avenir (utopie socialiste) » (p 32). La façon dont le marxiste nous est présenté donne très envie d’approfondir la réflexion sur son œuvre et d’imaginer ce que serait effectivement un socialisme indo-américain de nos jours.
Cependant, nous ne sommes pas vraiment d’accord avec les conclusions qu’Andrade expose dans le quatrième chapitre sur un supposé « tournant conservateur » (p. 60) de l’École de Francfort qui aurait déjà eu lieu avec Adorno et Horkheimer. Si leur position dans l’après-guerre fut en effet défensive et en retrait par rapport à la lutte des classes de la période précédente, elle est toutefois loin d’être conservatrice. Alexandre Neumann, à l’inverse, montre clairement que c’est bel et bien dans le sillage d’Adorno que s’est constitué « le courant chaud de l’École de Francfort »[1]. En même temps, Andrade propose un parallèle plus enrichissant entre l’approche de la Dialectique de la Raison, de Horkheimer et d’Adorno, et celle d’Enrique Dussel. Tel est notamment le cas dans le passage suivant, qu’il a repris de l’auteur mexicain :
« les quatre phénomènes : la Modernité, l’eurocentrisme, le colonialisme et le capitalisme sont quatre aspects d’un même processus et des déterminations simultanées contemporaines : ils apparaissent et se développent en même temps » (p. 73).
Ainsi que le note Andrade, « si Horkheimer et Adorno se sont plongés dans l’examen de la tendance autodestructive de la rationalité instrumentale aussi bien que de l’aspect destructeur du progrès, Dussel, quant à lui, analyse la rationalité colonialiste propre au projet nécrophilique de la modernité/colonialité » (p. 74). Beaucoup plus que de refuser leur travail en raison d’un supposé conservatisme, il semble plus profitable de poursuivre Dussel dans sa tâche de détermination du contenu réel de la dialectique de la Raison.
C’est sur l’œuvre de Dussel et d’Aníbal Quijano, notamment sur son concept de « colonialité du pouvoir », que notre auteur s’appuie dans l’article qui clôt le volume pour élaborer une critique des limites de l’approche d’Achille Mbembe. Au fond, Andrade semble suggérer que ferait défaut au concept de nécropolitique d’origine foucaldienne, employé par Mbembe dans ses analyses critiques sur la souveraineté contemporaine, une prise en compte de la matérialité concrète des sujets impliqués dans le processus de gouvernement contemporain. Il serait trop abstrait. Cependant, Andrade après avoir construit tout l’édifice théorique, demeure à mi-chemin, sans trop approfondir sa critique, alors qu’elle le mériterait pourtant.
« Le capitalisme, nous dit Benjamin, n’est pas seulement une forme conditionnée par la religion, mais un phénomène essentiellement religieux » (p. 35). En s’appuyant sur Michael Löwy, Agamben, entre autres, Andrade propose une riche contribution à la récupération de l’une des thèses les plus fondamentales pour la compréhension de notre époque actuelle, à savoir, celle élaborée par Walter Benjamin dans un fragment écrit au début des années 1920 sur le capitalisme comme religion qui ne fut publié qu’en 1985.
«Benjamin identifie quatre caractéristiques qui constituent la structure du capitalisme en tant que religion, à savoir : a) le capitalisme en tant que pure religion de culte, b) la durée permanente de son culte, c) son caractère culpabilisant et d) le fait que son Dieu reste caché » (p. 38).
Andrade montre bien que le motif se prolonge dans l’œuvre du philosophe dans des ouvrages comme Sens Unique et dans le Livre des Passages, notamment par le biais des images que le désir revêt et des façons dont le capital se met en scène. Tout au long de cet essai, l’auteur développe des rapports entre l’approche de Benjamin et d’auteurs comme Jung Mo Sung, Allan Coelho, Gilles Lipovetsky, Franz Hinkelammert, Gustav Landauer, entre autres. On ne peut qu’attendre qu’Andrade puisse donner suite au développement de la rencontre entre Benjamin et ses auteurs suivant le fil prometteur de la critique du capitalisme comme religion.
Le quatrième chapitre, intitulé « Utopie, religion, marxisme », propose une belle reconstruction de la « sociologie critique de la religion » (p. 78) qui est l’un des domaines fondamentaux dans la vaste œuvre de Michael Löwy.
« D’après Löwy, la religion l’athéisme et le messianisme sont des phénomènes intimement liés. De sorte que le rôle de l’athéisme consiste à dé-théocratiser les textes religieux pour réhabiliter leur charge subversive contribuant ainsi à la lutte de libération » (p. 81).
Le rôle de cette approche critique de la religion n’est autre que politique. C’est en s’inspirant principalement de Bloch et de Benjamin que la révolution et l’utopie endossent chez Löwy un contenu théologique fondamental. Ce contenu est analysé dans la tradition chrétienne, notamment dans la théologie de la libération de l’Amérique latine avec ses répercussions sur la Révolution Cubaine et dans des mouvements comme celui des Sans-Terres. Il faut bien noter que, malgré sa richesse théorique, le développement de la théologie de la libération fut toutefois avant tout en rapport avec les événements politiques qui avaient lieu sur ce continent.
Au Brésil, par exemple, il est intimement lié aux courants radicaux catholiques, très souvent explicitement anticapitalistes, impliqués dans la lutte politique ayant précédé le coup d’État de 1964. De l’autre côté, il existe aussi une tradition théologique beaucoup plus théorique, à savoir le courant du judaïsme libertaire de l’Europe centrale. Cette tradition est messianique se développe en suivant deux tendances principales contradictoires. D’un côté, l’on trouve les restaurateurs et de l’autre, les utopiques qui aspirent à un avenir totalement nouveau. Chez les utopiques, qui sont ceux qui nous intéressent véritablement, on retrouve deux pôles distincts. L’un est composé des juifs religieux anarchisants et l’autre, les assimilés (athées-religieux) libertaires.
La façon dont Andrade présente ce corpus assez riche et méconnu peut être lue comme une invitation à reprendre et approfondir la réflexion et la lecture des travaux de Löwy. Pour conclure, dans la toute dernière partie de son essai, Andrade reconstruit très fidèlement l’interprétation élaborée par Löwy du philosophe Walter Benjamin, qui est certainement l’une des plus riches et influentes concernant ce philosophe.
« Le Capital et la Bible », cinquième chapitre de l’ouvrage, est le plus original et celui doté du plus grand intérêt pour le lecteur francophone, de même aussi que pour celui latino-américain. Ici Andrade propose une histoire très détaillée des différentes lectures du Capital – du livre et pas simplement de Marx — qui ont été réalisées par plusieurs théologiens en Amérique latine.
« À la différence de la théologie politique européenne, la théologie de la libération a su voir que le problème en Amérique latine n’était pas l’athéisme, mais l’idolâtrie moderne » (p. 126).
Autrement dit, elle a tout de suite identifié que le problème était le capital. Cependant, l’auteur ne manque pas de rappeler une période très importante de lecture de Marx en France, réalisée par des théologiens juste avant et juste après la Seconde Guerre mondiale, chez des auteurs comme Louis-Joseph Lebret et Jean-Yves Calvez. Il s’agit ainsi là d’une tradition de lecture de Marx qui mériterait d’être rédécouverte. Le philosophe jésuite Henrique Cláudio Vaz et les théologiens Allan da Silva Coelho et Jo Mo Sung, composent un ensemble de penseurs brésiliens présenté par Andrade comme des lecteurs du Capital illustrant bien la durée et l’enracinement d’une telle approche dans ce pays, qui s’étend des années 1960 jusqu’à l’époque actuelle.
Le Mexique est l’autre pays où cette lecture s’est développée de manière très accentuée. Andrade accorde de l’importance à un forum de dialogue organisé en 1983, à l’occasion du centenaire de la mort de Marx, dans plusieurs villes mexicaines, durant lequel plusieurs théologiens comme Enrique Marroquín, Rubén Dri, Jorge Pixley se sont exprimés, et dont les interventions ont donné lieu à l’important ouvrage Marxistas y Cristianos. Selon Andrade, « Rubén Dri met l’accent sur la dimension prophétique-apocalyptique de l’Ancien Testament qui serait le terreau de la théologie de la libération. En même temps, il offre une analyse des »affinités électives » entre le projet de Jésus de Nazareth et celui de Karl Marx » (p. 115). Pixley, de son côté, insiste sur l’idée que « la pratique du culte permet de différencier les idoles des dieux. La lutte des prophètes contre les idoles apparaissant comme symétrique de la lutte de Marx contre le fétichisme » (p. 116).
Le théologien et sociologue brésilien Hugo Assmann, membre de l’École DEI (département de recherche œcuménique) insiste beaucoup sur la critique du fétichisme, de même que sur une mise en avant de l’importance de la sécularisation pour le christianisme dans l’espace public contemporain. En partenariat avec Franz Hinkelammert, un autre membre du DEI, il met en avant le fait que l’économie capitaliste fonctionne au fond comme une théologie sécularisée. Ils pensent le capitalisme comme un « système d’apparences fétichistes », mais aussi comme une « religion quotidienne exigeant des sacrifices » (p. 126).
Auteur d’une œuvre considérable, Hinkelammert, curieusement allemand, est, selon Andrade, celui qui a le plus développé cette approche analytique consistant à analyser le rapport entre théologie et économie. Après s’être formé en Allemagne, Hinkelammert arrive au Chili dans les années 1960 où il reste une décennie avant de partir en exil suite au coup d’État de 1973. Il revient ensuite pour un temps au Honduras avant de partir s’installer au Costa Rica. Dans cet essai, Luis Martínez Andrade réussit à tisser un lien avec les autres essais du recueil, notamment autour de la critique du capitalisme comme religion, cœur de ses travaux et thématique commune à plusieurs auteurs en Amérique latine, et à entrevoir la possibilité d’inventer un socialisme latino-américain pour l’avenir.
Note
[1] Cf. Neumann, Alexandre, « Le courant chaud de l’École de Francfort », Variations, vol. 12, 2008.









