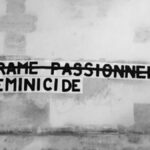Masculinités, colonialité et néolibéralisme. Entretien avec Raewyn Connell
Raewyn Connell, professeure de sociologie à l’Université de Sydney, était présente à Paris en juin dernier dans le cadre des journées d’études « Les masculinités au prisme de l’hégémonie » à l’École des Hautes Études en Sciences Sociales. L’occasion pour nous de revenir sur sa trajectoire de chercheure ainsi que sur l’histoire et l’actualité des approches critiques des masculinités.
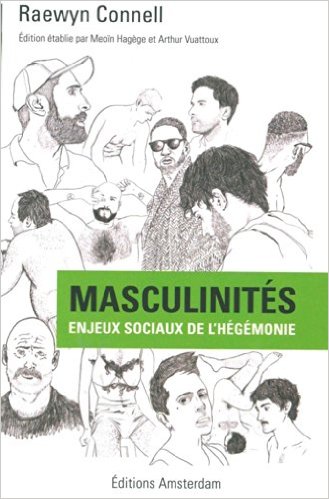
Après avoir consacré ses recherches aux dynamiques de classe (Ruling Class, Ruling Culture, 1977) et aux relations entre rapports de classe et de genre en milieu scolaire (Making the Difference, 1982), Raewyn Connell développe une théorie du genre comme structure sociale (Gender and Power, 1987). Elle publie en 1995, l’ouvrage Masculinities, rapidement traduit en plusieurs langues européennes, ainsi qu’en japonais, chinois et hébreu entre autres. Cet ouvrage constitue une référence majeure pour les sciences sociales et pour le développement des études sur les masculinités [masculinity studies].
Les masculinity studies se sont notamment constituées autour du concept de « masculinité hégémonique », qui apparaît en Australie dans des travaux de sociologie de l’éducation au début des années 1980, avant de connaître sa première formalisation théorique dans un article de 1985 (Carrigan, Connell, Lee, « Towards a new sociology of masculinity »). Raewyn Connell avance ensuite une conceptualisation renouvelée de ce concept (Masculinities, 1995/2005 ; « Hegemonic Masculinity : Rethinking the concept », 2005) qu’elle déploie sur de nouveaux terrains : la santé, la sexualité, la colonialité (Southern Theory, 2007) et la globalisation (Gender : in world perspective, 2009). Ce concept vise à analyser les processus de hiérarchisation, de normalisation et de marginalisation des masculinités, par lesquels certaines catégories d’hommes imposent, à travers un travail sur eux-mêmes et sur les autres, leur domination aux femmes, mais également à d’autres catégories d’hommes.
Pour commencer, nous aimerions que vous reveniez sur le contexte d’émergence du concept de masculinité hégémonique. Comment expliquez-vous que le projet des masculinity studies ait été formulé pour la première fois en tant que tel dans l’Australie des années 1980 ?
Sachez d’abord qu’il n’y pas que des kangourous et des crocodiles en Australie ! Plus sérieusement, il est ici important de rappeler que l’Australie est un pays majoritairement urbain, dépendant économiquement de l’exportation de minerais et de produits agricoles. Dans la première moitié des années 1980, le pays connaissait une profonde transformation culturelle et s’apprêtait à traverser une importante transition économique. Un détour historique s’impose pour comprendre ce contexte singulier.
L’Australie moderne est le résultat de l’invasion européenne sur un territoire occupé depuis au moins quarante mille ans par des peuples indigènes qui y avaient construit une culture et un rapport à la terre complexes. Les colons ont écrasé les sociétés aborigènes sur la quasi totalité du continent (seul un tiers de la population aborigène y a survécu), pour y établir un avant-poste masculinisé du capitalisme européen, spécialisé dans le commerce de matières premières (laine, minerais, blé, viande) avec la métropole.
Les vagues migratoires européennes, associées à des politiques étatiques de développement, ont généré des villes et des infrastructures orientées vers l’industrie d’exportation. La population coloniale blanche a développé une idéologie raciste (dont le prolongement contemporain est la politique de l’« Australie blanche »), une identité nationale masculinisée et une culture dépendante, assez loyale envers l’Empire britannique. Le Vingtième Siècle a vu l’émergence d’une économie industrielle et d’un État-providence associés à un syndicalisme puissant, quoiqu’encore une fois dominé par les hommes, ainsi que l’avènement d’une bourgeoisie industrielle. Ces transformations ont eu pour effet d’accélérer le développement et la modernisation du système éducatif.
Les années 1960 et 1970 ont vu l’émergence de contestations de cet ordre social. D’abord avec la renaissance politique et culturelle aborigène, qui a débouché sur le mouvement pour le droit à la terre [Lands Rights movement]. Un mouvement étudiant iconoclaste a ensuite été le laboratoire d’une contre-culture, dont un mouvement écologiste a notamment émergé. Un mouvement pour la paix s’opposait alors à l’engagement de l’Australie dans des guerres impérialistes. Ce qui nous intéresse plus directement dans cette histoire, c’est l’émergence d’une contestation féministe du patriarcat australien qui s’est formulée à ce moment là, rapidement suivie par les combats gay et lesbien contre la répression et la discrimination sexuelle.
Le mouvement de libération des femmes a été particulièrement influent au cours des années 1970. Certaines féministes se sont rapprochées de groupes modernisateurs à l’intérieur du Parti Travailliste, déployant ainsi leur influence au cœur de l’État. D’autres ont crée des programmes de women’s studies à l’université, transformant les manières d’étudier l’histoire, la littérature et la sociologie. Plus généralement, l’impact culturel du féminisme a permis l’émergence de questionnements sur le sexisme et la subordination des femmes dans les domaines de l’éducation, des médias, de la sexualité, de la vie familiale, du travail et du syndicalisme.
Plusieurs facteurs ont ainsi convergé à l’aube des années 1980 et permis une mise en question des hommes et de la masculinité. Le militarisme et l’héroïsme guerrier avaient été vivement critiqués par le mouvement pour la paix. La masculinité hétérosexuelle était questionnée par le mouvement de libération gay ; et, à mesure que se développait l’épidémie de VIH/sida, c’était également la masculinité gay qui se voyait interrogée. Les sciences sociales féministes remettaient en cause la « naturalité » des formes dominantes de masculinité. Un certain nombre d’avancées féministes ayant été obtenues à travers des alliances avec des hommes au sein du Parti Travaillistes et des bureaucraties d’État, la question de la participation des hommes à des changements positifs dans les rapports de genre gagnait aussi en visibilité.
Les deux plus grand•e• romancièr•e•s australien•ne•s de l’ère moderne sont par ailleurs une femme, Christina Sead, et un homme homosexuel, Patrick White ; on ne peut donc pas parler d’un establishment culturel patriarcal puissant en Australie. La New Left et la contre-culture ont donné aux jeunes intellectuel•le•s de ma génération le sentiment que toute institution pouvait et devait être contestée. L’expansion du système universitaire (dans le cadre de la politique modernisatrice de l’Etat australien des années 1940 à 1970) a donné à nombreux/euses d’entre nous une base institutionnelle et des ressources pour la recherche.
Ces années constituent donc un moment historique où les murs qui protégeaient la masculinité conventionnelle se fissuraient soudainement, tandis que de nouvelles coalitions émergeaient et développaient de nouvelles perspectives.
Pourquoi avoir mobilisé le concept d’hégémonie, plutôt qu’une autre conceptualisation de la domination, pour étudier les masculinités ?
Le concept d’hégémonie circulait déjà au sein de la gauche australienne dans les années 1970 pour penser les rapports de classe. Nous mobilisions ce concept pour analyser le pouvoir des hommes d’affaires et des hommes politiques conservateurs dans un pays qui avait un mouvement syndical très puissant et un Parti Travailliste capable de gagner des élections. Ce concept est d’ailleurs un élément central du cadre théorique de Ruling Class, Ruling Culture1.
Le terme venait d’Antonio Gramsci. Une partie de son travail était à l’époque disponible, en traduction anglaise ou sous la forme de commentaires. Son nom était connu. Il y avait une migration italienne vers l’Australie, et la gauche australienne suivait de près l’actualité du Parti Communiste Italien (qui vouait un culte à Gramsci), de la « voie italienne » et de l’Eurocommunisme. J’avais également étudié ce concept dans un tout autre contexte, dans le cadre d’enseignements de licence à l’Université de Melbourne. J’étudiais alors la politique grecque des quatrième et cinquième siècles avant JC, d’où vient l’idée de l’eghemon dans une alliance de forces politiques2.
L’emploi du terme d’hégémonie s’est ensuite avéré évident lorsqu’il s’est agi d’analyser une configuration particulière des rapports de genre, une situation dans laquelle la centralité, le leadership et le pouvoir d’une minorité avait été stabilisés ; et où cette prédominance était moins imposée par la force qu’organiquement intégrée à la culture et aux routines de la vie quotidienne.
J’ai toujours été très réticente vis-à-vis des théories fonctionnalistes et des théories de la reproduction sociale, qu’elles émanent de la droite comme de la gauche, et qu’elles concernent la classe ou le genre. Lorsque ces théories sont le fait d’intellectuels conservateurs (comme Parsons ou Easton), elles deviennent partie prenante de l’ordre hégémonique. Et même lorsqu’elles émanent de penseurs plus progressistes (comme Althusser, Bourdieu ou Poulantzas), ces théories tendent à inhiber, plutôt qu’à augmenter, la capacité d’agir militante. Ma réticence envers ces théories s’est notamment développée lors de mon travail auprès d’enseignant•e•s en école publique, à qui il n’est d’aucune aide d’expliquer qu’ils et elles sont voué•e•s à la reproduction des hiérarchies sociales. Ce dont ils et elles ont besoin, ce sont de théories qui ouvrent sur des pratiques pédagogiques de transformation sociale.
Dans l’article « Rethinking the concept »3, vous revenez sur les usages, les critiques et les traductions culturelles dont le concept de masculinité hégémonique a fait l’objet. Quel a été, en retour, l’effet de cette circulation globalisée du concept sur votre propre travail ?
C’est paradoxal. La prolifération globalisée des recherches sur les masculinités est telle que je ne suis pas en mesure de tout suivre. Je m’efforce d’en lire le plus possible et nombreux/euses sont ceux et celles qui ont la gentillesse de me faire parvenir leurs travaux – parfois dans des langues que je ne peux pas lire, mais cela m’intéresse toujours !
Ce tournant global des études sur la masculinité doit nous rendre attentifs/ives à la dimension collective de la production de connaissances, ainsi qu’au caractère international de la force de travail impliquée dans ce processus. Les sciences sociales anglophones mainstream sont très auto-référentielles et ne se confrontent pas assez avec les autres contextes géographiques et culturels. Par contraste avec certains de mes collègues anglophones, je crois que ma vision plus sombre et plus complexe des enjeux liés à la masculinité, provient de ma localisation sur les rives du Pacifique Sud et de ma collaboration avec des chercheur•e•s au-delà de la métropole.
Cette circulation globalisée des idées m’a aussi obligé, avec le temps, à questionner certains des présupposés constitutifs de la première version de mon modèle de l’hégémonie dans les rapports de genre. L’ironie du sort est que je me rends désormais compte que ce modèle initial partage en réalité beaucoup avec les systèmes théoriques clos que je m’efforçais par ailleurs de dépasser ! Une meilleure connaissance de l’histoire du colonialisme, des sociétés post-coloniales, ainsi que de leurs dynamiques genrées, m’a obligé à reconnaître que l’on ne peut pas prendre pour présupposé de départ l’existence d’un ordre du genre stable. D’abord parce que les ordres du genre pré-coloniaux ne sont eux-mêmes pas statiques. Mais surtout parce que la colonisation détruit les structures sociales locales et les dynamiques qui leurs sont propres. Par la suite, le colonialisme reconstruit – ou s’efforce de reconstruire – un ordre du genre reposant sur de nouvelles bases ; mais ce qui en résulte est une société aux tensions exacerbées et à la violence endémique. Les rapports de pouvoir post-coloniaux globalisés rejouent ces dynamiques et ces conflits dans de nouveaux termes. Par rapport au modèle initial, je conçois aujourd’hui l’hégémonie comme une tentative de réalisation du pouvoir [achievement of power] davantage pétrie de contradictions, historiquement transitoire et plus directement liée à la violence.
Comment les études sur les masculinités peuvent-elles contribuer à la lutte contre le masculinisme et à la résistance face au backlash anti-féministe ?
Il y a deux aspects à cette question. Les masculinity studies sont avant tout un projet de production de connaissances : enquêter, théoriser, publier, diffuser. Je crois (mais il s’agit là d’une croyance aveuglée par l’héritage des Lumières et par les traditions protestante et socialiste dont je suis issue !) que la production du savoir et l’enseignement public sont capables de faire reculer les préjugés et l’obscurantisme. Un corpus de connaissances solides et accessibles sur les enjeux relatifs aux masculinités est en soi une ressource sociale.
L’autre versant de cette question, plus politique, concerne les manières dont les idées issues de ce corpus de connaissances peuvent être déployées dans des combats pour l’égalité de genre. Une contribution importante des masculinity studies peut ici tout simplement consister en l’apport de la preuve – désormais très bien documentée – que les masculinités sont diverses et historiquement changeantes. Le dogme de la fixité des caractères masculins (ou féminins) est en effet une pièce essentielle de la boîte à outils des réactionnaires du genre, que leur langage soit pseudo-scientifique ou pseudo-religieux. Nous pouvons désormais démontrer, preuves à l’appui, l’absurdité de ce dogme.
Il peut aussi être important de montrer que les hommes ne profitent pas en bloc4 des dividendes masculins générés par un ordre du genre patriarcal. Il y a des niveaux de profit très différents et certains groupes d’hommes payent en réalité un prix fort (en pauvreté, en violence, en dépression) pour le maintien de l’ordre du genre en vigueur. Ce que qui veut dire que certains hommes (et leur nombre ne fait qu’augmenter) tireront des bénéfices de la transformation progressiste de l’ordre du genre et qu’ils peuvent donc constituer des alliés dans le combat pour le changement. De telles coalitions ont émergé au sein de la génération précédente5 et elles continueront à émerger. Elles sont en fait actuellement à l’œuvre – un exemple parmi d’autres est l’engagement d’hommes dans des recherches et des programmes d’action contre la violence de genre avec lesquels je collabore en Asie du Sud-Est.
Vous êtes essentiellement connue en France comme une sociologue spécialiste des masculinités. Pourtant, vos premiers travaux portent sur les rapports de classe et vos travaux les plus récents portent sur la globalisation et la colonialité du pouvoir. Comment ces trois dimensions s’articulent-elles ?
Mes toutes premières publications portaient en fait sur la conscientisation sociale et politique des enfants (je reprenais certaines idées de Piaget) et sur les politiques électorales de droite en Australie. Je suis maintenant dans le monde de la recherche depuis plus de quarante ans et j’ai travaillé sur un large éventail de questions allant de l’éducation scolaire à la théorie sociale critique, en passant par l’analyse de genre, la sexualité et la prévention du VIH, le travail des intellectuel•le•s, ou la réforme étatique – et encore bien d’autres choses, disponibles sur mon site Internet www.raewynconnell.net
Ces différents projets ne sont pas nécessairement unis par une cohérence. Je me suis attachée à répondre aux problèmes publics, aux crises et aux nouveaux cadres de pensée au fil de leur émergence. J’ai travaillé au sein d’une dizaine d’équipes de recherche, qui mobilisaient chacune des styles et des méthodes de recherche différents. Il serait faux de dire que chacun de ces projets était partie prenante d’un grand projet critique cohérent.
Mais je pense qu’il existe des connexions entre ces projets. C’est en tous cas la thèse convaincante de Demetris Z. Demetriou, qui a étudié attentivement les liens entre mes recherches sur les rapports de classe et celles sur les rapports de genre6 … et je dois avouer que c’est un peu terrifiant de voir son propre travail soumis à une lecture aussi rigoureuse !
Je crois que mes recherches sur les masculinités, les rapports de classe et la colonialité du savoir partagent un même engagement critique envers le pouvoir, les inégalités sociales, l’institutionnalisation des privilèges et la justice sociale dans son sens le plus large.
Elles partagent aussi une conscience historique (un de mes ouvrages les plus connus en Australie s’intitule d’ailleurs Class Structure in Australian History7) et, ainsi, une attention aux changements structurels et aux luttes sociales. C’est une démarche qui me paraît essentielle pour toute recherche – y compris très localisée – mue par un souci de justice sociale.
Ces agendas de recherche ont par ailleurs en commun de s’attacher à rendre compte de la texture du réel, de la matière rugueuse des processus sociaux et de l’irréductibilité des gens, de l’expérience et des institutions. Durant ces années, l’entretien biographique et l’analyse par étude de cas sont les outils que j’ai le plus mobilisés. Il s’agit d’une méthode lente, laborieuse, rétive à l’automatisation. Elle est sans équivalent pour rendre compte de la complexité des situations locales tout en prenant le pouls des dynamiques globales. Cette méthode force également les chercheur•e•s à interagir avec des personnes en chair et en os, que les routines scientifiques tendent à abstraire à travers leur lexique : « sujet », « acteur », « agent ». Ils et elles sont alors contraint•e•s à les traiter avec respect, y compris lorsque leurs pratiques sociales leurs sont détestables. Je me suis par exemple retrouvée dans cette situation lors mes entretiens avec des hommes d’affaire.
Dans Southern Theory, vous proposez un récit alternatif de la production du savoir en sciences sociales. Quelles sont les implications de cette approche critique pour les études de genre et, plus particulièrement, pour l’étude des masculinités ?
La thèse de Southern Theory a des nombreuses implications pour les études de genre. Je consacre justement une partie importante de mon travail le plus récent à l’étude de ces implications.
En un mot, ce que nous entendons par gender theory est en fait une théorisation des rapports de genre issue de la métropole globale, c’est-à-dire de l’Europe et l’Amérique du Nord. Il n’est alors pas surprenant que cette théorisation fasse sens par rapport aux expériences sociales propres à ces régions. Aussi évident que cela puisse paraître du point de vue de la sociologie de la connaissance, cela est rarement pris en compte dans les études de genre telles qu’elles sont pratiquées.
Or ces pays ne se sont pas développé de manière isolée : nous parlons là des métropoles coloniales d’antan et des centres du capitalisme globalisé d’aujourd’hui. Ces pays ont construit une économie globale du savoir dans laquelle la métropole est le lieu de la théorie et la périphérie (où vit la grande majorité de la population mondiale) est le lieu de la collecte des données. La production du savoir dans la périphérie est alors fortement subordonnée aux concepts, théories, méthodologies et paradigmes de la métropole. Il s’agit d’un modèle général, qui s’applique aux études de genre.
Les sociétés colonisées se sont toutefois attachées à penser la colonisation indépendamment des colons. Les sociétés de la périphérie continuent de produire un travail intellectuel à rebours de cette économie dominante du savoir. C’est ce que j’appelle « la théorie du Sud » [southern theory], qui n’est pas un « savoir indigène » statique, mais une réponse intellectuelle à l’expérience sociale de la colonisation et aux sociétés postcoloniales d’aujourd’hui. Southern Theory raconte l’histoire d’un vaste ensemble de projets intellectuels menés sur différents continents. L’ouvrage s’inscrit dans un mouvement théorique plus large et en plein essor qui montre la richesse de la pensée sociale issue des Suds, parmi lesquels Alternative Discourses in Asian Social Science8de Farid Alatas, Provincializing Europe9 de Dipesh Chakrabarty, ou encore Theory from the South10 de Jean and John Comaroff.
Re-Orienting Western Feminisms11 de Chilla Bulbeck est un livre qui montre la prolifération de la pensée féministe à travers les Suds. Il y a également d’excellentes revues féministes telles que Cadernos PAGU et Estudos Feministas au Brésil, Feminist Africa en Afrique du Sud, l’Indian Journal of Gender Studies en Inde, Debate Feminista au Mexique, al-Raida au Liban ou encore Australian Feminist Studies en Australie dont les chercheur•e•s de la métropole peuvent apprendre beaucoup. Des chercheures féministes importantes telles que Bina Agarwal, Fatima Mernissi, Amina Mama, Heleith Saffioti ou Teresa Valdés devraient faire partie de toutes les listes de lecture proposées aux étudiant•e•s des universités du Nord.
Les universitaires du Nord qui travaillent dans le domaine des études sur les masculinités ont parfois connaissance des recherches empiriques sur les Suds. Peu se confrontent en revanche aux savoirs sur les hommes et les masculinités issus des mondes postcoloniaux. Ceci est en partie dû au fait que ces dernières ne sont pas toujours étiquetées en tant que « recherches sur les masculinités ». Il y a pourtant beaucoup à apprendre des écrits d’Ashis Nandy12 sur les dynamiques interactives à l’œuvre dans la formation des masculinités ; de ceux d’Octavio Paz13 sur les mouvements politiques et culturels conservateurs en termes de genre ; ainsi que des romans de Chinua Achebe14 au sujet de l’impact du pouvoir extérieur sur le maintien de l’autorité masculine. Et je ne me réfère ici qu’à d’anciennes générations d’intellectuels. Ce travail de décentrement est, je crois, le défi le plus important à relever pour les études sur les masculinités de demain.
Vous avez récemment insisté sur l’importance d’envisager les travailleurs/euses intellectuel•le•s comme des travailleurs/euses15. Quelles en sont les implications pratiques ?
Les enseignements que je tire des recherches que j’ai consacré au travail intellectuel – qu’il s’agisse d’histoires de vie, d’études quantitatives ou de théorisations, et que ces travaux portent sur l’Australie ou sur d’autres régions16 – nous ramènent à ce que je disais à l’instant sur l’économie globale de la connaissance. La production du savoir est un processus social – un processus social globalisé. Cette production mobilise une force de travail différenciée qui, envisagée à l’échelle globale, représente une formation sociale importante. Cette production requière des ressources sociales, elle a des conséquences complexes et elle est historiquement changeante.
Ceci a des implications pratiques importantes. Il est d’abord fondamental de reconnaître les positions différenciées des divers groupes impliqués dans ce qui est apparemment un champ académique unifié, en l’occurrence les masculinity studies. Quel type de travail obtient les ressources? Quel type de travail manque de ressources ?
Envisager les chercheur•e•s comme des travailleurs/euses revient à placer la focale sur les rapports concrets qu’ils et elles entretiennent les un•e•s avec les autres, par exemple sur les formes de travail coopératif et de pratiques communicationnelles qui sont impliquées dans un champ scientifique donné. Cela place également la focale sur les formes de gouvernementalité et de contrôle qui en viennent à régir ce champ scientifique – à l’instar du tournant managérial dans la gestion des universités, de la part croissante des fonds privés dans le financement de la recherche, ou de la prédominance des ONG et des programmes d’aide dans le financement de la recherche sociale dans les pays pauvres.
Quelle peut être la contribution des études sur les masculinités à la critique du néolibéralisme globalisé ?
La culture néolibérale est – et c’est un point important – masculinisée dès le départ. Le modèle de l’ « acteur rationnel », autour duquel la théorie économique néolibérale s’est construite, est une figure masculine. Les politiques néolibérales, dans leur rejet de toute forme de démocratie participative, n’ont cesse de recourir à la figure politique de l’« homme fort » et vouent un culte à la prise de décision autoritaire, rationnelle, efficace et sans pitié. La marchandisation des sports de compétition masculins, de la Formule 1 à la Coupe du Monde de football, constitue un laboratoire fascinant pour l’étude du néolibéralisme et des dynamiques de masculinité.
Mais il existe des connexions plus concrètes entre masculinité et néolibéralisme, notamment via le management entrepreneurial. La globalisation néolibérale produit de nouvelles institutions et de nouveaux espaces sociaux qui s’étendent à l’échelle globale – notamment à travers le world wide web, l’État sécuritaire transnational, les marchés mondiaux et les firmes multinationales. Chacune de ces institutions est organisée par un régime de genre complexe et géographiquement étendu.
Ce sont des arènes de formation de la masculinité – et ce sont aujourd’hui parmi les arènes les plus importantes à étudier. Nous avons besoin de plus de recherches dans ce domaine. Il faudrait que les études localisées sur les masculinités soient davantage attentives aux connexions entre les contextes locaux et ces arènes globales.
Au cœur des firmes multinationales – ainsi qu’au-delà de ces firmes, dans d’autres arènes globales – se déploie la masculinité des nouvelles élites managériales et patronales. Ces élites étant difficiles d’accès, y compris pour les chercheurs du Nord, différentes stratégies d’approche ont été mises en place : l’étude des représentations médiatiques des managers, l’étude de leurs traces documentaires, ou encore l’entrée par la jeune génération (cela a été mon approche). Quelques chercheur•e•s ingénieux/euses sont parvenu•e•s à avoir un accès plus direct et je suis sûre que l’on apprendra bientôt beaucoup des résultats de ces recherches.
La recherche sur les masculinités n’est bien sûr pas la seule clé de compréhension de l’ordre néolibéral mondial. Mais celle-ci aidera à la compréhension du fonctionnement des institutions néolibérales, ainsi que des contextes dans lesquels les décisions sont prises et les stratégies arrêtées. Comment, par exemple, les projets des firmes multinationales qui saccagent les terres, déplacent des populations, détruisent des écosystèmes, génèrent de la violence sociale ou déversent de la pollution pour les prochains milliers d’années sont-ils pensés et mis en œuvre ? L’analyse de la dimension genrée de la culture managériale, ainsi que des projets de vie des hommes qui dirigent ces firmes, nous permettra de mieux comprendre et ainsi de mieux lutter contre ces modes de gestion et d’exploitation.
Propos recueillis et traduits par Mélanie Gourarier, Gianfranco Rebucini et Florian Voros
Nos contenus sont sous licence Creative Commons, libres de diffusion, et Copyleft. Toute parution peut donc être librement reprise et partagée à des fins non commerciales, à la condition de ne pas la modifier et de mentionner auteur·e(s) et URL d’origine activée.
à voir aussi
références
| ⇧1 | R.W. Connell, Ruling Class, Ruling Culture. Studies in conflict, power and hegemony in Australian Life, Cambridge University Press, Cambridge, 1977. |
|---|---|
| ⇧2 | NdT : À ce propos, George Hoare et Nathan Sperber écrivent : « En grec ancien, le terme [hégémonie] dérive de eghestai qui signifie « diriger », « conduire ». Ce mot donnera plus tard eghemon qui, durant la guerre du Péloponnèse, désigne la cité la plus puissante, en position directrice dans l’alliance de différentes cités grecques entre elles », Introduction à Antonio Gramsci, La Découverte, Paris, 2013, p. 94. |
| ⇧3 | R.W. Connell, James Messerschmidt, « Hegemonic Masculinity : Rethninking the Concept », in Gender & Society, vol. 19, n°6, 2005, p. 829-859. |
| ⇧4 | NdT : En français dans le texte. |
| ⇧5 | NdT : Sur ce point, voir : Pauline Debenest, Vincent Gay et Gabriel Girard, « Les masculinités et les hommes dans les mouvements féministes, entretien avec Raewyn Connell » in Féminisme au pluriel, Syllepse, Paris, 2010, p.59-76. |
| ⇧6 | Demetris Z. Demetriou, « Towards a genealogy of R.W. Connell’s notion of ‘‘structure’’, 1971-1977 », in Nathan Hollier (dir.) , Ruling Australia, Australian Scholarly Publishing, Melbourne, 2004, p. 24-44. |
| ⇧7 | R.W. Connell, Terry Irving, Class Structure in Australian History : Documents, Narrative and Arguments, Longman, Melbourne, 1980. |
| ⇧8 | Syed Farid Alatas, Alternative Discourses in Asian Social Science : Responses to Eurocentrism, Sage Publishers, New Dehli, Thousand Oaks et Londres, 2006. |
| ⇧9 | Dipesh Chakrabarty, Provincialiser l’Europe. La pensée postcoloniale et la difference historique, trad. Nicolas Vieillescazes et Olivier Ruchet, Editions Amsterdam, Paris, 2009 [edition originale : 2007]. |
| ⇧10 | Jean Comaroff, John L. Comaroff, Theory from the South : Or How Euro-America Is Evolving Towards Africa, Paradigm Publishers, Boulder, Colorado, 2011. |
| ⇧11 | Chilla Bulbeck, Re-Orienting Western Feminisms : Women’s Diversity in a Postcolonial World, Cambridge University, Press, Cambridge, 1998. |
| ⇧12 | Ashis Nandy, The intimate ennemy. Loss and recovery of self under colonialism, Oxford University Press, New Dehli, 1983. NdT : Un portrait intellectuel et politique d’Ashis Nandy a été réalisé par : Marc Saint-Upéry, « L’expérience impériale et l’esprit indien », in La Revue des Livres, n°5, mai-juin 2012. |
| ⇧13 | Octavio Paz, Le labyrinthe de la solitude, nouvelle édition augmentée, trad. Jean-Clarence Lambert, Gallimard, Paris, 1990 [édition originale : El laberinto de la soldedad, 1950] |
| ⇧14 | Chinua Achebe, Le monde s’effondre, trad. Michel Ligny, Editions Présence Africaine, Paris, 1966 [édition originale : Things Fall Apart, 1958] |
| ⇧15 | Raewyn Connell, « La vocation de la sociologie : un travail collectif à l’échelle mondiale » in Dialogue global, vol. 3, n°3, mai 2013, p. 4-6. |
| ⇧16 | Une liste des travaux de Raewyn Connell sur le travail intellectuel est consultable sur son site web. |
![Découvrir les géographies féministes et queers [Podcast]](https://www.contretemps.eu/wp-content/uploads/2021-06-26-12.46.39-1-150x150.jpg)