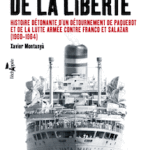À lire : un extrait de « Les fils de la nuit », d’Antoine Gimenez et les Giménologues
Antoine Gimenez & les Giménologues, Les fils de la nuit. Souvenirs de la guerre d’Espagne. 19 juillet 1936 – 9 février 1939, Paris, Libertalia, 2016, 22€.
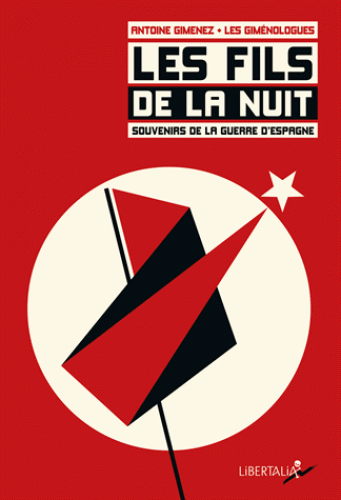
Les circonstances de la mort de Durruti sont obscures, et aucun historien à ce jour n’a pu les démêler. Certains savent peut-être la vérité, ou croient la savoir, mais la gardent encore pour eux. Les prochaines années nous livreront peut-être quelques témoignages décisifs, qui auront le défaut néanmoins d’être de seconde main, dans le meilleur des cas.
Rappelons en préambule ce qui est à peu près établi, avec de petites variantes selon les témoins.
Durruti arrive à Madrid le 14 novembre, et ses hommes le lendemain matin vers 9 heures : ils sont placés sur le front dès le 16 à 2 heures du matin.
Les jours suivants, 17 et 18, se passent en terribles combats à la cité universitaire, où les hommes de la colonne Durruti ne sont pas relevés. Le 18, ils ont été décimés, et il ne reste plus que 400 combattants. En fin de journée, Durruti s’entretient au ministère de la Guerre avec José Miaja et Vicente Rojo, respectivement président de la Junte de défense de Madrid et chef d’état-major du premier, afin de mettre en place la relève de ses troupes. Ceux-ci lui demandent de tenir encore un jour. Vers 20 heures, il quitte le ministère et se rend à son quartier général, où il converse avec Eduardo Val, secrétaire du Comité de défense de la CNT de Madrid, à propos de la militarisation des milices et des manœuvres communistes pour prendre le contrôle de la situation à Madrid. Ils mentionnent une réunion de militants convoquée à ce sujet le lendemain 19 vers 16 heures. Peu après arrive Cipriano Mera, chef d’une colonne anarcho-syndicaliste madrilène. Celui-ci et Durruti se donnent alors rendez-vous pour le lendemain matin à 6 heures au qg de la colonne Durruti, afin d’entreprendre la conquête de l’hôpital Clínico, un bâtiment d’importance stratégique.
Pendant toute la matinée jusqu’aux environs de midi, Mera et Durruti suivent les opérations qui ne permettent de prendre le contrôle que d’une partie du Clínico. Durruti se rend ensuite à son qg et c’est là qu’Antonio Bonilla, délégué général de la formation de blindés, arrive peu après pour lui donner les dernières nouvelles concernant le Clínico, où des miliciens sont coupés de leurs arrières :
Il était 13 heures ce 19 novembre quand je décidai d’aller parler à Durruti pour lui expliquer ce qui s’était passé. Lorente conduisait la voiture, et un charpentier catalan très valeureux, Miguel Doga, m’accompagnait. En arrivant à la caserne, nous vîmes la « Packard » de Durruti qui était en marche, et qui allait partir avec Manzana. Je lui expliquai ce qui se passait, et il [Durruti] décida d’aller se rendre compte par lui-même. Je dis à Julio Graves (le chauffeur) de suivre notre voiture, parce qu’il fallait éviter de passer par les zones battues par le feu, et c’est ce qu’il fit. Manzana, comme de coutume, portait son « naranjero » à l’épaule, et un foulard pendait de son cou où il reposait de temps en temps sa main droite, car il était blessé à un doigt depuis quelques semaines. Durruti se déplaçait en apparence sans arme, mais il portait, comme d’habitude, un « Colt 45 » sous sa veste de cuir. Leur voiture nous suivit jusqu’à ce que nous parvenions près des chalets qu’occupaient nos forces diminuées. Alors leur voiture se gara, et nous fîmes de même environ 20 mètres en avant.
Durruti descendit pour aller dire quelque chose à quelques miliciens qui étaient là en train de prendre le soleil, derrière un mur. Cette zone n’était pas battue par le feu. C’est dans ce lieu que Durruti fut blessé mortellement et que la révolution connut le plus dur et inimaginable revers.
Nous étions dans l’autre voiture, quelque 20 mètres plus loin, et nous sommes restés garés trois ou quatre minutes. Quand Durruti remonta dans la voiture, nous démarrâmes et, en regardant derrière pour s’assurer qu’elle nous suivait, nous vîmes que la « Packard » faisait demi-tour et partait à toute vitesse. Je sortis de la voiture et demandai aux jeunes ce qui s’était passé. Ils me répondirent qu’il y avait eu un blessé. Je leur demandai s’ils savaient qui était l’homme qui leur avait parlé, et ils me répondirent que non. Je dis à Lorente que nous rentrions immédiatement. Il était 14 h 30[1].
Le corps blessé de Durruti est transporté à l’hôtel Ritz, qui sert d’hôpital à la colonne, puis immédiatement à la salle d’opérations où les docteurs Santamaría et Martínez Fraile lui donnent les premiers soins. Devant la peur d’entreprendre une opération risquée et de la rater, ils font appel à un chirurgien expérimenté, Bastos Ansart, qui constate la gravité de la blessure et estime qu’elle ne pourra manquer d’emporter le blessé. Les médecins ne tentent donc pas d’opérer. Durruti entre alors dans une lente agonie qui prend fin le lendemain vers 4 heures.
Pendant ce temps, Bonilla se rend au qg de la colonne :
Manzana me reçut. Je lui demandai où était Durruti, et il me dit qu’il était parti à une réunion du Comité national. Je lui répondis que c’était un mensonge, puisque le Comité national de la CNT n’était pas à Madrid. Son visage changea de couleur, et il me dit que s’il était dans la colonne, c’était pour Durruti et pour nous autres, et que si nous n’avions plus confiance en lui, il s’en irait.
« Tu m’as menti – lui dis-je –, mais je te tiens pour responsable de ce qui a pu arriver, et je t’enjoins de tout me dire à un autre moment. »
Je devais rejoindre les miens. À 5 heures du matin le lendemain, le compagnon Mora vint en moto pour m’annoncer la mort de Durruti[2].
Nous n’allons pas entrer maintenant dans le détail des différentes versions de la mort de Durruti, car elles regorgent de menus faits, dont la plupart sont fantaisistes, et se détruisent toutes mutuellement. Pas une seule ne tient véritablement debout, même si celle de Bonilla est sans doute celle qui se rapproche le plus de la vérité, selon les paroles de Joan Llarch, qui a consacré un livre entier à la question.
Pour mémoire, rappelons quand même brièvement les principales versions qui ont circulé.
Celle de Manzana, tout d’abord, telle qu’elle est rapportée par Cipriano Mera, dans ses mémoires[3], publiés en 1976. Mera se trouve vers 17 heures en compagnie d’Eduardo Val au Comité de défense quand arrive Manzana qui lui rapporte les conditions de la blessure de Durruti : ils étaient cinq dans la voiture, Durruti et deux agents de liaison, Yoldi et lui-même. Arrivé à portée du Clínico, Durruti est touché par une balle tirée par les franquistes depuis le bâtiment qu’ils contrôlent. Après s’être confié à Mera, Manzana lui demande de garder le secret, afin de ne pas démoraliser les troupes. Cette version est à la base de celle qui sera élaborée par la CNT pour servir de version officielle. Et elle sera cautionnée par Ricardo Sanz, qui est désigné le 20 par le Comité national (en présence de García Oliver, Mera et Montseny) pour prendre la succession de Durruti à Madrid, tandis que Manzana sera bientôt envoyé en Aragon pour prendre en main le reste de la colonne, alors en pleine effervescence à cause des décrets de militarisation que les miliciens refusent dans leur majorité et de la conviction de la plupart que Durruti a été tué par les communistes.
Concernant cet état d’esprit des miliciens, nous pouvons verser au dossier le témoignage du milicien suisse Edi Gmür, membre du Groupe international :
Moses a répondu : « […] Les communistes veulent prendre le pouvoir en Espagne. Mais ils n’y parviendront que quand les anarchistes seront anéantis. Oui, ils seraient bien contents si nous nous cassions le nez ! Mais ils se trompent, ces gredins. » « Il y a aussi des gredins parmi les anarchistes », s’est exclamé l’Estonien, qui est communiste. Bortz s’est mis de la partie : « Vous n’avez rien à dire. Allez dans les Brigades à Madrid, si vous ne vous plaisez pas ici ! » Moses maugréait : « Faudrait tuer tous les communistes, ils ont bien assassiné notre Durruti ! » Alors je n’ai plus pu me maîtriser, et j’ai rugi : « Bande de salopards ! » Enfin est arrivé le commissaire politique qui a rétabli l’ordre. J’étais quand même en colère et déprimé. Le soir, j’ai demandé à Henrique s’il était vrai que Durruti avait été assassiné par nos gens. « C’est sûr, c’est les communistes qui l’ont abattu », m’a-t-il répondu. Il a tiré de sa poche une photo de Durruti mort. On voit nettement, sur le torse nu, l’entrée d’une balle dirigée droit sur le cœur. Je suis très déprimé. « Politique ! » ajoute Henrique[4].
Dans le même sens, le journaliste argentin José Gabriel écrit :
À Madrid, quand les factieux, ayant repris des forces, avancèrent par l’Estrémadure, on réclama la présence de Durruti pour organiser en une semaine une armée puissante ; mais le gouvernement républicain et socialo-communiste de Largo Caballero faisait la sourde oreille à cette demande, en même temps que celui de la Généralité catalane, d’identique filiation politique, maintenait les milices du caudillo faïste sans armes, afin de les discréditer, celles-là et celui-ci.
[…] Toutes [les versions officieuses sur la mort de Durruti] révèlent, néanmoins, que le peuple n’accepta pas la version officielle, pas plus qu’il ne l’avala quand le consul russe à Barcelone fit acte de présence à l’enterrement. Ce qui est sûr, c’est que Durruti, tué d’une balle en plein cœur, fut assassiné par la colonne internationale du général Kléber, une force « spécialisée dans le nettoyage de l’arrière-garde » (ainsi qu’elle se qualifiait sans complexe), installée par les républicains et les socialo-communistes sur le front du Centre pour contrôler le peuple espagnol qui se défendait des factieux. En l’assassinant, la République socialo-communiste assénait en son nom et au nom de l’Angleterre, de la France et de la Russie, un coup puissant au peuple travailleur espagnol. Ce n’est pas, pour sûr, la vérité reconnue officiellement par la CNT et la fai ; mais officiellement, les circonstances ont imposé à la direction de la CNT et de la fai des concessions que les affiliés de ces institutions n’approuvèrent pas tous, ainsi que le révèle, entre autres, l’apparition du groupe dissident Amigos de Durruti. Avec le temps, nous verrons avec précision, de la bouche même des victimaires, ces vérités confessées, voire affichées, et beaucoup d’autres[5].
La suite ne lui a pas donné raison…
Revenons à Sanz qui, en route pour Madrid, fait une escale à Valence, le 21, et y rencontre brièvement Manzana qui lui dit :
Ne va pas à Madrid ; ils vont te tuer comme lui – me dit-il en désignant le cadavre de Durruti [en transit pour Barcelone[6]].
Ne prenant pas le temps de lui demander plus d’explications, Sanz parvient à Madrid le soir du 23 ou du 24 novembre et, après avoir officiellement effectué une rapide enquête sur place (en fait, il ne semble pas avoir interrogé le moindre témoin direct), il annonce que Durruti est mort d’une balle tirée de l’hôpital Clínico, à 1 000 mètres de distance ; il déclare qu’il y avait sept personnes dans la voiture, Durruti, Manzana, Yoldi, Graves, un mécanicien et deux hommes d’escorte. Cette version sera la seule à avoir droit de cité pendant trente-cinq ans environ, même si Sanz donnera plus tard une version toute différente (voir infra).
Quand des historiens ou des écrivains comme Martínez Bande, Enzensberger ou Joan Llarch réexamineront la question, la thèse de l’accident provoqué par Durruti lui-même viendra remplacer progressivement celle de la balle franquiste, en raison des invraisemblances de cette dernière. Elle deviendra donc, en quelque sorte, la version officielle bis et sera exprimée, par exemple, par Diego Abad de Santillán dans un entretien donné en 1977 à Freddy Gomez, Paolo Gobetti et Paola Olivetti[7], où il affirme avoir appris la vérité directement de la bouche de Manzana, à savoir que Durruti aurait déclenché lui-même le coup de feu mortel en heurtant le marchepied de la voiture avec le bas de son naranjero. Santillán ajoute que Manzana l’a appelé le jour même pour lui annoncer la mort de Durruti. Mais alors, comment se fait-il que Manzana dise à certains que c’est une balle ennemie, et à d’autres que c’est un accident ? Et nous verrons plus loin qu’il donnera à Sanz, si on l’en croit, encore une autre version !
Pour approfondir un peu la question, on peut maintenant prendre connaissance des propos de García Oliver, dans son Eco de los pasos, publié en 1978 :
Je vis le sergent Manzana et le docteur Santamaría, tous deux en permanence aux côtés de Durruti, qui s’approchèrent de moi [le 22, à l’occasion de l’enterrement de Durruti à Barcelone]. […] Quasiment dans l’oreille, à voix très basse, Manzana me dit :
– Nous voudrions parler avec toi. Seul à seul. […]
– Il s’agit de quelque chose que nous avons caché sur la mort de Durruti. Nous laissons se propager à Madrid la nouvelle selon laquelle il a reçu un coup de feu, ce qui est naturel là où s’échangent tant de tirs. Mais cela n’est pas vrai. Durruti n’est pas mort comme la nouvelle en a couru. Sa mort fut un accident. Quand il est sorti de l’auto, il a glissé, la crosse de son « naranjero » a frappé le sol et le percuteur s’est déclenché, entraînant plusieurs tirs, dont l’un l’a touché. On n’a rien pu faire à l’hôpital. Il est mort.
Ces détails me parurent absurdes, mais ils ne me firent pas perdre mon calme. […] Ce qui est certain, c’est que la version de sa mort héroïque face à l’ennemi avait déjà circulé à profusion. On ne pouvait la démentir, et il n’aurait pas été indiqué de le faire. En plus, quand bien même on aurait enquêté, on n’aurait jamais su la vérité, car chacun, dans cet enfer de passions qu’était l’Espagne, aurait donné sa version, de préférence la version susceptible de porter le plus lourd préjudice moral aux anarcho-syndicalistes. Nos ennemis de l’intérieur et de l’extérieur en viendraient même à dire qu’il avait été assassiné par les anarchistes eux-mêmes.
[…]
À l’époque comme aujourd’hui, trente-sept ans après, cette version de la mort de Durruti que me donnèrent le sergent Manzana et le docteur Santamaría me parut invraisemblable. Il y avait une pièce qui ne s’insérait pas bien dans ce qui devenait une sorte de casse-tête. Cela ne tenait pas debout, qu’il ait « en sortant de la voiture, glissé et que le “ naranjero ” ait frappé le sol, déclenchant le tir ».
Il est certain que les « naranjeros », fusils-mitrailleurs allemands importés par la Guardia Civil, étaient dangereux si on les cognait, magasin chargé, contre le sol. De nombreux accidents s’étaient déjà produits.
Mais le fait est que je n’ai jamais vu Durruti avec un « naranjero ». Tout au plus portait-il un pistolet dans un étui à la ceinture. Je n’ai jamais vu non plus de photo de lui avec un « naranjero » dans les mains. Et on peut dire que Durruti se faisait photographier dans toutes les positions, y compris pendant son sommeil. Sur le front d’Aragon, il se déplaçait toujours en compagnie du docteur Santamaría, pour le cas où il serait blessé, et d’un compagnon photographe, pour le prendre en photo.
Étant donné le sérieux de Manzana et du docteur Santamaría, j’ai toujours cru que le « naranjero » qui avait tiré, et avait frappé Durruti, devait appartenir à l’un des compagnons de son escorte[8].
Ces révélations sont prolongées dans un autre passage de son livre :
Pendant de nombreuses années, la version du tir accidentel du « naranjero » demeura inconnue. Puis, au fil des ans, certains ne se firent pas faute, comme Santillán, de retirer le voile. Mais pas moi. Je n’ai absolument jamais admis cette version, car Durruti ne se déplaçait jamais avec un « naranjero » ni aucune arme à la main[9].
On saisit dans cet aveu tardif que García Oliver, dans les jours qui suivirent la mort de Durruti, s’est vu confier par Manzana que Durruti était l’auteur du coup de feu accidentel, qu’il ne l’a pas cru… et qu’il n’en a rien dit à personne. Cette dernière affirmation n’est d’ailleurs pas tout à fait vraie, si l’on en croit ce qu’Ortiz lui rappellera dans un courrier qu’il lui adressera après la publication de son Eco de los pasos :
Là où nous ne sommes pas d’accord, c’est au sujet de ce que tu m’as dit à l’enterrement de Durruti […] qu’il s’était tué avec le « naranjero » qui était parti tout seul[10]…
Mais Ortiz saisit l’occasion pour aller plus loin :
La balle qui a tué Durruti lui est entrÉe par l’omoplate et elle est sortie sous le tÉton du mÊme côtÉ… c’est-à-dire de haut en bas et d’arrière en avant… !
La veste qu’avait portée Durruti est la meilleure preuve de ce que je dis… alors… pourquoi tant de serments et de mensonges[11]… !!??
Dans une lettre antérieure adressée à Antonio Téllez, Ortiz avait posé la même question et y avait répondu : « Peut-être pour des raisons d’État[12] ? »
On voit donc qu’Ortiz nourrit les mêmes soupçons que García Oliver. Dans le livre qu’ils ont consacré à Antonio Ortiz, Gallardo et Márquez disent ceci :
Parmi les contacts de cette période parisienne, il faut distinguer la visite qu’il fit à Émilienne Morin [début 1939], la compagne de Durruti. […] Mais l’important pour Ortiz fut de voir la veste de cuir que portait son ami et compagnon (Durruti) le jour de sa mort : « Quand je vis la veste, j’en fus malade, car, c’était clair, la fable de García Oliver, au cours de l’enterrement, sur l’accident qui coûta la vie à Durruti ne tenait pas debout… La balle était entrée par l’arrière et on pouvait le constater au trou net sur la veste, tandis qu’à l’avant le trou plus grand présentait la déchirure typique d’une sortie de balle. »
C’est alors que fit son chemin dans sa tête l’idée qu’il conservera pour le restant de ses jours : on avait tué Durruti, et il accusait Manzana, sans pouvoir le démontrer : « La balle qui coûta la vie à Durruti était entrée par-dessus l’omoplate gauche et était ressortie près des fausses côtes. Or, un tir accidentel aurait pu dessiner une trajectoire horizontale, ou de bas en haut, mais jamais de haut en bas et par derrière[13]. »
On relève ici que García Oliver dissimule en disant qu’il s’est refusé à avancer la thèse de l’accident provoqué par Durruti, puisque c’est de cette version qu’il a fait état devant Ortiz le 22 novembre à Barcelone. On peut supposer qu’il ne s’est pas refusé au petit jeu des confidences différemment calibrées – il a fait la même à Émilienne Morin –, selon que l’on faisait partie ou non du premier cercle des initiés : en gros, pour la masse des militants, c’était la mort du héros abattu par une balle ennemie, pour les membres du cercle des militants proches des responsabilités, c’était Durruti qui s’était exécuté tout seul, et pour les militants du sommet habitués à toutes les intrigues, c’était encore autre chose… à savoir que c’était Manzana qui avait déclenché le tir, ainsi que l’exposera plus tard Bonilla :
La balle qui blessa mortellement Durruti sortit du naranjero que portait Manzana à l’épaule. Quand ils se disposèrent à remonter dans la voiture pour nous suivre, Manzana ouvrit la porte pour que Durruti prenne place sur le siège […]. Le naranjero lui glissa de l’épaule, la crosse heurta le marche-pied de la voiture, le fusil-mitrailleur partit tout seul et blessa Durruti. […] J’ai toujours maintenu le silence autour de la question de savoir si le coup de feu avait été accidentel ou non, car je tenais à le vérifier personnellement auprès de Manzana, mais je ne suis jamais parvenu à le revoir au cours de ces quarante dernières années[14].
Pour être plus précis sur ce point, nous pouvons faire état d’un courrier de Miguel Amorós adressé aux auteurs le 23 novembre 2005 :
[À propos de la version de Bonilla,] je dispose d’un document confidentiel de lui. Il s’agit d’une communication que me transmit Piqueras, qui est mort maintenant, intitulée « Travail pour la rencontre de militants vétérans, qui doit se tenir du 21 au 26 novembre 1977 à Barcelone ». En ce qui concerne la mort de Durruti, il dit : « […] [Bonilla réitère tout d’abord sa description des faits] Dans le numéro 80 de la revue Posible […], je déclare comment il fut blessé, mais trois voix se sont fait entendre pour s’étonner que j’aie gardé le silence sur la mort pendant quarante ans. Que ces trois voix, parmi lesquelles se trouve celle de sa compagne française Émilienne, entendent ceci : je me suis tu pendant quarante ans parce que je poursuivais Manzana pour le tuer. Et maintenant, pour terminer, j’invite ceux qui écriront à partir d’une version erronée de cette mort à la rectifier coûte que coûte, parce qu’on ne peut mentir à son sujet. »
Comme on peut le voir, l’étau se resserre autour de Manzana. Pour conforter encore un peu plus ces soupçons, nous pouvons livrer un témoignage qui nous a été communiqué par l’intermédiaire de César M. Lorenzo.
Selon un ancien milicien de la colonne Durruti, dont nous pouvons révéler aujourd’hui le nom, José Mariño Carballada, Durruti était bien accompagné des seuls Manzana et Graves, le chauffeur. Une autre voiture, dans laquelle se trouvaient le témoin ainsi que certains militants connus, tels que Liberto Ros et d’autres, s’était garée plus loin, entre 50 et 200 mètres, mais hors de vue de Durruti. Une troisième voiture, à bord de laquelle avait pris place, entre autres, Miguel Yoldi, se trouvait encore plus loin. En entendant une détonation provenant du lieu où se trouvait Durruti, alors que la zone était calme, les occupants de ces deux voitures arrivèrent sur les lieux, où ils trouvèrent un Manzana catastrophé qui leur expliqua qu’il venait de tuer accidentellement Durruti. Selon César M. Lorenzo, qui a recueilli les témoignages de Liberto Ros et de José Mariño, Graves avait déjà rentré avec Manzana le corps de Durruti dans la voiture. Mariño, confirmant les dires de Liberto Ros, a répété à César M. Lorenzo ce que Manzana leur avait confié :
Lorsque ce dernier ouvrit la portière pour que son chef prît place dans l’automobile, le fusil-mitrailleur de type naranjero qu’il portait à l’épaule gauche heurta le marchepied, laissant échapper une balle qui frappa, tout près du cœur, Durruti penché en avant[15].
Les témoins durent réagir très vite, avant d’emporter le corps de Durruti, qui n’était pas encore mort, et c’est dans cette précipitation que se mit au point la thèse de la balle ennemie tirée depuis le Clínico. À l’exception de Mariño, ils crurent Manzana, semble-t-il (c’était le cas, par exemple, de Liberto Ros, qui fit donc les mêmes révélations à César M. Lorenzo il y a déjà longtemps, mais qui n’en voyait pas moins en Manzana « un chic type »), en raison de sa grande proximité avec Durruti, surtout depuis la prise de la caserne d’Atarazanas.
Sur ce point, néanmoins, Ortiz
souligne avec insistance que c’est une erreur historique que de considérer le sergent Manzana comme faisant partie de ceux qui affrontèrent les officiers soulevés. « Au cours de l’occupation d’Atarazanas, Manzana fut trouvé enfermé dans une cellule et fut transféré au quartier général du Poum, où Valeriano Gordo se rendit plus tard pour le libérer[16]. »
Toujours est-il que, même si les témoins de la mort de Durruti eurent des doutes, ils estimèrent qu’on ne pouvait dire la vérité, d’abord parce que Manzana se serait fait exécuter, ensuite parce que les anarchistes ne pouvaient rendre publiques des circonstances aussi déplorables concernant la mort de leur héros.
Par ailleurs, César M. Lorenzo s’est souvenu d’un passage d’un écrit de son père, Horacio Prieto :
On disait que c’était un « paco » [tireur embusqué], un des nombreux qui opéraient par là, qui l’avait tué ; il se disait aussi que c’était son homme de confiance, Manzana, qui lui avait porté un coup de pistolet, involontairement bien sûr ; mais les insidieux disaient, également, que c’étaient ses propres amis anarchistes qui l’avaient tué, parce que Durruti se faisait à l’idée, petit à petit, de bonnes relations et d’un accord avec les communistes. Il est fort possible que ce soit les « pacos » qui l’aient tué […] en sachant, ou ne sachant pas, qui ils tuaient ; cela peut avoir été le tir involontaire du pistolet du sergent professionnel qu’était Manzana ; mais s’il le fit volontairement, qui peut savoir les raisons qui l’animèrent ! Et si ce ne sont ni les « pacos », ni le hasard d’un tir du pistolet de Manzana qui le tuèrent, ceux qui pouvaient couver le dessein de tuer Durruti ne pouvaient être autres que ceux qui avaient intérêt à ce que les Brigades internationales ne fussent pas éclipsées par le symbole « Durruti ». Ceux-ci tentèrent, plus tard, d’enlever Miguel Yoldi, comme ils le firent avec d’autres, qu’ils éliminèrent. Je crois fermement qu’en aucune façon ce ne furent les anarchistes qui tuèrent Durruti, qu’il fût tué intentionnellement par quelqu’un, ou par hasard ; il était trop admiré et aimé de tous pour que les anarchistes commettent un crime aussi sot[17].
Après nous avoir communiqué cet extrait, César M. Lorenzo ajouta ce commentaire :
Ce qui me frappe maintenant, c’est l’allusion trois fois répétée au pistolet de Manzana[18] !
À notre connaissance, parmi tous les textes publiés sur le sujet, c’est en 1972 qu’il est question pour la première fois du rôle éventuel joué par Manzana dans la mort de Durruti. En lisant les autres échanges épistolaires entre Camacho et García Oliver – entre 1970 et 1979, dans les années où chacun rédigeait son ouvrage –, on constate que ce dernier n’a jamais vraiment voulu aider Camacho dans ses recherches ; et, d’ailleurs, il ne répond pas à Diego sur les circonstances de la mort de Durruti. Ce qui ne l’empêchera pas de suggérer, dans son autobiographie parue en 1978, que Manzana pourrait bien être l’auteur du tir accidentel, et d’aller en cela dans le sens de la version de Víctor García…
Les pistes les plus sérieuses semblent donc mener à Manzana. Mais les questions surgissent alors : pourquoi aurait-il agi ainsi, et pour le compte de qui ? Une hypothèse mérite d’être émise, même si elle n’est mentionnée ici qu’avec la plus grande prudence, faute d’éléments suffisants pour l’étayer.
García Oliver, dans ses mémoires, affirme que Largo Caballero accepta, au cours d’une réunion du Conseil supérieur de guerre tenue le 14 novembre, et sur sa proposition, de nommer Durruti à la tête de la Junte de défense de Madrid en remplacement de Miaja (avec pour condition, imposée par Caballero, de garder cette décision secrète pendant huit jours)[20].
Si l’on accepte de croire García Oliver sur ce point, et surtout si l’on garde présent à l’esprit que personne dans ce Conseil n’avait une haute opinion des capacités de Durruti, que ce soit à un niveau militaire ou sur le plan politique, on peut se demander si cet accord n’aurait pas fonctionné comme un piège mortel pour Durruti : Miaja, qui était assez fier de sa position et se prenait un peu pour le sauveur de l’Espagne (c’était la raison pour laquelle Caballero voulait le destituer et lui cherchait un remplaçant), n’allait certainement pas se laisser débarquer facilement. On pouvait donc ainsi lui laisser l’initiative, c’est-à-dire en l’occurrence décider quand et comment se débarrasser de Durruti.
Pourquoi ne pas penser alors que Manzana aurait pu obéir à ses supérieurs, le général Miaja et le lieutenant-colonel Rojo, en bon soldat qu’il était (il faut savoir qu’il avait combattu dans le Rif, qu’il avait été plusieurs fois médaillé, et que tous ses états de service dans l’armée étaient élogieux) ? On a déjà émis l’hypothèse qu’il avait obéi à ses supérieurs militaires du camp franquiste[21], mais a-t-on pensé qu’il ait pu obéir à ses supérieurs du camp loyaliste ?
Cette hypothèse devrait alors être comprise comme une variante de la piste communiste, qui eut toutes les faveurs auprès des miliciens, puisque aussi bien il était clair à ce moment que Miaja et Rojo étaient en grande partie contrôlés par les communistes et les agents soviétiques, qui profiteront bientôt à outrance de cet ascendant pour placer leurs hommes aux postes clés de l’armée en voie de reconstruction. Si l’on ajoute à cela le fait que Miaja et Rojo étaient membres, avant le 19 juillet 1936, de l’ume (Unión Militar Española) – une organisation secrète au sein de l’armée dont le but était « de dresser, le moment venu, une barrière capable de sauver l’Espagne du joug communiste[22] » –, et que les communistes le savaient, ce qui constituait pour eux un excellent moyen de pression, on comprend à quel point il était vital pour eux de ne pas laisser entrer le loup Durruti dans la bergerie républicaine.
Si cette hypothèse pouvait être vérifiée, on comprendrait alors pourquoi Voline, chargé de la rédaction du journal L’Espagne Antifasciste, reçut à Paris le 21 novembre, venant de Barcelone, le télégramme suivant :
Durruti assassiné par un groupe communiste sur le front de Madrid.
Et pourquoi encore il reçut quelques heures plus tard ce démenti :
Annuler précédent télégramme pour sauvegarder l’unité d’action[23].
On peut supposer que les premières constatations menèrent les hautes sphères de la CNT à la piste communiste et qu’il ne s’agissait pas pour elles de laisser passer cette provocation venant de leurs pires ennemis, mais que des investigations plus approfondies les convainquirent que la piste menait plus loin et incriminait Miaja, tout l’état-major, et derrière lui l’ensemble du gouvernement. À ce niveau, il ne restait plus qu’à choisir l’affrontement généralisé avec la totalité du camp républicain… ou bien laisser choir.
Toujours dans le cadre de cette hypothèse, on peut tenter d’imaginer comment le piège s’est refermé sur Durruti : plusieurs responsables militaires, Mera par exemple, constatent dès le 18 que les forces ennemies semblent s’essouffler et jeter toutes leurs forces dans une ultime tentative pour prendre Madrid, et obtenir par là un succès psychologique important et une victoire diplomatique décisive, de nombreuses nations n’attendant que cela pour reconnaître Franco. Quand Durruti explique à l’état-major le 18 au soir que ses hommes sont à bout, celui-ci lui répond qu’il n’y a plus la moindre réserve et lui demande de tenir vingt-quatre heures. On peut supposer que Miaja attend de voir si le front craque – auquel cas on laissera volontiers Durruti prendre en charge une Junte de défense en perdition – ou s’il tient, et on ne lui laissera pas alors le bénéfice de cette glorieuse résistance, et on cherchera à se débarrasser de lui par tous les moyens. Toute cette évolution peut fort bien avoir été prévue par Largo Caballero, quand il a accepté une semaine plus tôt cette étrange promotion pour le célèbre anarchiste.
Cela dit, on peut se contenter d’avancer une version « faible » de cette théorie, à savoir qu’il s’agissait de nommer Durruti à la tête d’une Junte à laquelle on pourrait tranquillement attribuer toute la responsabilité de la débâcle. C’était après tout le but principal du transfert de Durruti et d’une partie de sa colonne vers la capitale : lui faire porter tout le poids du revers militaire annoncé, et ainsi discréditer à jamais l’homme, les miliciens toujours butés dans leur refus de la militarisation, et derrière eux toutes les tendances radicales du mouvement anarchiste et anarcho-syndicaliste.
Comme il est de coutume de laisser, après le réquisitoire, la parole à l’accusé, nous citerons ce que Ricardo Sanz racontera bien plus tard, dans un texte rédigé en 1981 et publié en 1991, où il dira comment il rencontra Manzana à Barcelone, sans doute un an après la mort de Durruti, à l’occasion d’une exposition organisée en hommage à celui-ci. C’est alors que l’ancien sergent, devenu entre-temps capitaine à la tête d’une unité basée à Mataró, lui communiquera les « vraies » circonstances de la mort de son chef :
Nous descendîmes de la voiture, Durruti et moi ; nous fîmes quelques pas en direction des postes avancés, et nous rencontrâmes trois jeunes qui venaient en direction contraire. Durruti leur demanda :
– Où allez-vous, les gars ?
– Chercher des armes longues, parce que nous n’avons pas trouvé de fusils pour combattre, répondirent-ils.
– Il n’y a pas de fusils à l’arrière, répondit Durruti. Ils sont en ligne.
– Nous en trouverons, insistèrent les jeunes.
– Retournez aux tranchées, leur ordonna Durruti.
– Nous allons chercher des armes.
Alors, Durruti fit un geste comme pour sortir son pistolet. Un des jeunes, qui avait en main une arme de poing, tira sur Durruti et les trois partirent en courant. Durruti n’eut pas le temps de sortir son pistolet et je le reçus blessé et le traînai à la voiture, avec difficulté, car j’étais aussi blessé à ce moment-là[24].
On peut légitimement nourrir quelques doutes au sujet de cette version de Manzana, et tout d’abord sur le fait que les assaillants parvinrent à échapper au tireur d’élite qu’il était, même blessé. D’ailleurs, Ricardo Sanz ajoute :
Je devais lui donner l’impression qu’il n’avait pas dissipé mes doutes avec sa « confession » tardive. Nous demeurâmes comme demeurent les divorcés pour le reste de leur vie : avec le doute[25].
Puisque nous en sommes aux doutes, on peut aussi se demander pourquoi Ricardo Sanz nous livre, quarante-cinq ans plus tard (et même cinquante-cinq si l’on considère la date de publication), cette version, qui entre en complète contradiction avec celle qu’il a toujours défendue jusque-là, y compris dans un entretien avec Joan Llarch reproduit dans son ouvrage paru en 1973[26].
Pour conclure provisoirement dans cette ténébreuse affaire, citons les propos, en dépit de leur caractère un peu grandiloquent, et un rien démagogique, d’un observateur avisé :
Tout en lui adressant des flatteries, l’élément bourgeois du bloc « anti-fasciste » essaya sournoisement de réaliser une contre-révolution par le rétablissement du statu quo social et gouvernemental et par la reconstitution de l’Armée régulière. C’est alors que Durruti montra les dents et menaça les politiciens d’aller lui-même avec ses camarades du front mettre fin à leurs petites combines et à leurs flirts avec le fascisme.
Les ennemis de la liberté en Espagne comprirent qu’ils avaient à faire à un adversaire irréconciliable et qui se refuserait toujours à « jouer le jeu » des puissants de ce monde. Ils parlaient capitulation, militarisation, diplomatie, stratégie, capitaux et politique. Durruti répondait révolution. Toute conversation était impossible. Ne pouvant ni ébranler Durruti, ni le corrompre, la contre-révolution l’a assassiné[27].
Mais avant de vous laisser reprendre le fil de votre lecture, nous tenons à ajouter qu’il ne faudrait pas, sur la foi des éléments mentionnés plus haut dans cette notice, succomber à la tentation de tout expliquer par la main invisible des Soviétiques et des communistes espagnols, ne serait-ce qu’en raison des stratégies contre-révolutionnaires que les socialistes n’étaient pas les derniers à mettre en œuvre, le meilleur exemple en étant le contrôle partiel qu’ils surent conserver sur le terrible sim, en dépit de la forte mainmise communiste.
Et rien n’empêche de penser que les manœuvres pour faire entrer les anarchistes au gouvernement ont été en grande partie inaugurées et conduites par les socialistes, en mettant tout d’abord en avant un Largo Caballero tout auréolé d’une prétendue nouvelle jeunesse révolutionnaire…
Rien n’interdit non plus, pour finir, de considérer qu’une bonne partie de l’appareil cénétiste et faïste avait tout intérêt à marginaliser des individus comme Durruti, qui par leur seule existence et leur fort pouvoir symbolique conféraient et conservaient une certaine crédibilité aux options radicales qui s’inscrivaient dans la continuité de la révolution de juillet – ce n’est pas pour rien que certains prendront le nom d’Amigos de Durruti, afin de perpétuer cet héritage et de maintenir en vie ces options. Face à elles, et pour des raisons complexes qu’il ne s’agit pas non plus de diaboliser ad libitum, une bonne partie des appareils de la CNT et de la fai choisit de privilégier l’accord avec les forces politiques composant le Front populaire, ce qui l’amènera progressivement à accumuler les reculs et les compromis, voire les compromissions, dont les plus manifestes seront la participation aux multiples opérations répressives qui frapperont bientôt ceux des militants ouvriers et paysans qui resteront fidèles aux principes de l’anarchisme et de la lutte contre le capitalisme et l’État.
Notes
[1] Entretien donné à Pedro Costa Musté pour la revue Posible, n° 80, 22-28 juillet 1976, cité dans Abel Paz, Durruti en la revolución española, Madrid, Fundación Anselmo Lorenzo, p. 692.
[2] Ibid., p. 675.
[3] Cipriano Mera Sanz, Guerra, exilio y cárcel de un anarcosindicalista, Barcelone et Valence, CGT-CNT-FSS-Malatesta-Hormiga Roja, 2006.
[4] Edi Gmür & Albert Minnig, « Pour le bien de la révolution ». Deux volontaires suisses miliciens en Espagne, 1936-1937, Lausanne, CIRA, 2006, pp. 75 et 76.
[5] José Gabriel, La vida y la muerte en Aragón, Buenos Aires, Ediciones Imán pp. 165-167.
[6] Ricardo Sanz, « La muerte de Durruti en la batalla de Madrid », dans Boletín de l’Amicale de la 26e división, n° 3, 20 novembre 1991, p. 11.
[7] Cet entretien est reproduit et traduit dans À contretemps, n° 10.
[8] Juan García Oliver, El eco de los pasos, Paris & Barcelone, Ruedo Ibérico, 1978, pp. 340 et 341.
[9] Ibid., p. 529.
[10] Lettre envoyée du Venezuela, sans date, probablement en 1979, reproduite dans Juan Gallardo Romero & José Manuel Márquez Rodriguez, Ortiz, general sin dios ni amo, Barcelone, Hacer, p. 363.
[11] Ibid.
[12] Lettre du 9 mai 1977, IISG, fonds Téllez.
[13] Entretien avec Ortiz, 26 juillet 1995, dans Gallardo & Márquez, Ortiz, general sin dios ni amo, op. cit., pp. 287 et 288.
[14] Posible, n° 80, repris dans Edmundo Marculeta, Las seis muertes de Durruti, Barcelone, autoédition, 1984, pp. 43 et 44.
[15] César M. Lorenzo, livre en préparation, chapitre intitulé « Tantarantana ».
[16] Gallardo & Márquez, Ortiz, general sin dios ni amo, op. cit., p. 101.
[17] Horacio M. Prieto, Utopistas, ouvrage inédit, p. 123.
[18] Lettre aux auteurs du 28 août 2004.
[19] Correspondance de Diego Camacho, déposée au Centre Ascaso-Durruti de Montpellier. Lettre reproduite dans Balance, Cuaderno de historia número 38, Correspondencia entre Diego Camacho (« Abel Paz ») y Juan García Oliver, Barcelone, septembre 2014, p. 31.
[20] García Oliver, El eco de los pasos, op. cit., pp. 326 et 327.
[21] Voir El Periódico de Cataluña, 24 novembre 2002.
[22] Document franquiste, cité dans Burnett Bolloten, La Guerre d’Espagne, Révolution et contre-révolution, 1934-1939, Marseille, Agone, 2014, p. 408. Il faut préciser que cette accusation est controversée : voir Julio Aróstegui & Jesús A. Martínez, La Junta de Defensa de Madrid, Madrid, Comunidad de Madrid, 1984, pp. 68 et 69.
[23] Témoignage de son fils Léo Voline, datant de 1985 et publié dans le Bulletin du cira de Marseille, nos 26-27, p. 73.
[24] Sanz, « La muerte de Durruti en la batalla de Madrid », art. cit., p. 16.
[25] Ibid.
[26] Joan Llarch, La muerte de Durruti, Barcelone, Edicions 29, 1983.
[27] André Prudhommeaux, Où va l’Espagne ? Nîmes, Les Cahiers de Terre Libre, 1937, p. 41.