
Philosophie et révolution. Sur le Gramsci d’André Tosel
Les éditions Amsterdam ont publié en novembre 2022 une sélection des écrits d’André Tosel sur Gramsci, sous le titre Le fil de Gramsci. Philosophie et politique de la praxis. Avant d’entrer plus en détail dans le contenu de l’ouvrage, il nous faut dire que sa publication est une bonne nouvelle. Tout d’abord parce qu’il permet de sauver de l’oubli l’apport de Tosel, mais aussi, et surtout, parce qu’il offre un matériau très utile pour repenser des questions fondamentales du marxisme ; des questions qui peuvent être rediscutées telles que Gramsci les a formulées ou au-delà de l’approche proposée par le communiste sarde.
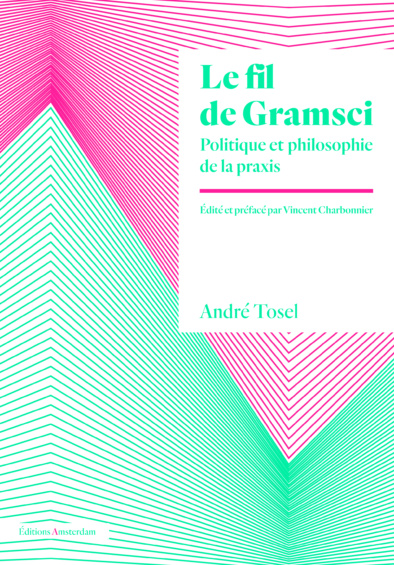
La préface, rédigée par l’éditeur du livre, Vincent Charbonnier, débute de façon malheureuse, en affirmant que les études gramsciennes se sont développées principalement en Italie et dans le monde anglophone, oubliant l’Amérique latine et signalant ainsi, involontairement, l’horizon limité qui affecte encore aujourd’hui une bonne partie de l’intelligentsia européenne. Toutefois, au-delà de ce faux pas initial, en présentant la pensée de Gramsci comme un « fil rouge » des réflexions du philosophe français, ce texte est une introduction appropriée aussi bien au volume qu’aux préoccupations théoriques de Tosel,.
L’ouvrage est composé de textes publiés dans les années 1980 et 1990 et divisé en trois parties, respectivement intitulées « le marxisme comme philosophie de la praxis », « questions de stratégie révolutionnaire » et « Gramsci et la France ». Nous commenterons les textes qui composent chacune d’entre elles, puis nous présenterons quelques réflexions et remarques de conclusion.
Philosophie de la praxis : science, langage, idéologie et politique
La première partie est celle qui traite des problèmes théoriques les plus denses. Elle s’ouvre sur l’article de 1984 « Philosophie de la praxis et dialectique », qui remet en question la lecture du marxisme en termes de « matérialisme dialectique et de matérialisme historique » et tente en même temps de rétablir le rôle de la dialectique dans la lecture gramscienne du marxisme comme philosophie de la praxis. Si Tosel fait référence à Boukharine et à la Troisième Internationale, sa critique peut aussi être étendue à la lecture d’Althusser dans les années 1960. Contre l’idée d’un marxisme présenté comme « l’unité d’une philosophie et d’une science », la philosophie de la praxis remet en cause l’image d’une théorie qui « se donne comme un objet à réfléchir et à manipuler », contre laquelle elle revendique l’immanence de la totalité des rapports sociaux.
A partir de là, Tosel renoue avec la conception de Gramsci de la dialectique comme « doctrine de la connaissance et substance essentielle de l’historiographie et de la science politique » contre sa dégradation en une « sous-espèce de la logique formelle ». Cette polémique, Gramsci l’a également menée contre les lectures modérées du processus historique (Proudhon, Gioberti, Croce), pour que l’histoire soit comprise dans sa totalité et son intégralité (économie, politique, modes de pensée) et à partir de ses antagonismes constitutifs, contre l’atténuation de l’antithèse entre les forces en présence. Les concepts d’immanence (sur le plan philosophique), d’hégémonie (sur le plan politique) et de catharsis (comme moment d’élaboration subjective des contradictions de la structure, de passage de la lutte économique à la politique et enfin comme médiation entre philosophie et politique), apparaissent comme centraux pour le marxisme compris comme une philosophie de la praxis.
De ce point de vue, Tosel apporte également à la discussion la conception gramscienne de l’objectivité et de la pratique scientifique, en soulignant le rôle assigné par Gramsci à la médiation de la pratique humaine pour la construction de la connaissance de la réalité. Il convient de souligner que la réflexion de Gramsci sur la construction de l’objectivité scientifique est en relation étroite avec l’avancée (et les contradictions) de l’unification culturelle, et dans ce cadre, avec la définition gramscienne de la « lutte pour l’objectivité ». De ce point de vue, il est également possible de débattre avec les positions qui considèrent Gramsci comme un subjectiviste, sans se rendre compte qu’il ne remettait pas en cause l’existence de la réalité matérielle mais la naïveté épistémologique du manuel de Boukharine. Le texte se termine par une réflexion sur la manière subtile dont Gramsci fait preuve, d’une part, de peu de sympathie pour les tentatives d’Engels de transformer la dialectique en « loi cosmique », tout en défendant, de l’autre, la conception engelsienne selon laquelle le développement des sciences naturelles a démontré la matérialité et l’objectivité du monde.
Il est intéressant de noter que dans ces débats, et surtout dans les commentaires sur la conception réaliste naïve de l’objectivité que Gramsci critique dans le manuel de Boukharine, l’auteur des Cahiers de prison procède lui-même à une sorte de contraposition de registres, qui n’est pas pleinement explicitée : alors que Boukharine se réfère à une conception de l’objectivité d’un point de vue ontologique, Gramsci le fait d’un point de vue gnoséologique et historico-culturel, de sorte que, si l’on prend certaines formulations isolément, son approche peut sembler affectée d’une certaine touche subjectiviste. Gramsci a insisté sur le fait que la conception marxiste de la matière ne coïncidait pas exactement avec celle du matérialisme pré-marxiste, et mit l’accent sur la matière « organisée pour la production », un point sur lequel nous reviendrons plus tard. Dans les conclusions, Tosel soutient que la philosophie de la praxis a donné une nouvelle chance à la dialectique de la nature, en tant que façon de penser la relation du marxisme aux sciences naturelles qui rapproche la lutte pour l’objectivité scientifique de la lutte pour l’hégémonie sur le plan politique et idéologique.
Dans l’article suivant, « Philosophie de la praxis et ontologie de l’être social » (1987), Tosel établit une comparaison entre l’ontologie de l’être social de Lukács et la philosophie de la praxis de Gramsci. Il étudie ainsi le rapport entre les élaborations tardives du philosophe communiste hongrois et ses propres conceptions antérieures exposées dans Histoire et conscience de classe, ainsi qu’avec la position de Gramsci. Le verdict est qu’il existe des différences importantes, mais aussi des points de contact entre les deux approches. Tosel a souligné que, face à des courants de la philosophie du 20esiècle comme le néo-positivisme ou l’existentialisme de Heidegger, mais aussi à l’encontre les garanties du diamat stalinien, l’originalité de la tentative de Lukács résidait dans la recherche de la puissance inépuisée de la pensée de Marx, en remontant jusqu’à ses fondements ontologiques et en tentant à partir de là de remettre en question certains nœuds de la modernité. Selon Tosel, Lukács relit Marx à une époque de manipulation et d’objectivation extrêmes des relations capitalistes avec un regard « quasi-objectiviste » : l’être social et son ontologie laissent derrière eux les réflexions juvéniles du « sujet-objet identique » autant que la praxéologie.
Tosel propose une reconstruction des arguments de Lukács qui met l’accent sur les catégories de l’organique et de l’inorganique, de la causalité et de la téléologie, ainsi que sur la triade objectivation-aliénation-réification. Si l’on veut établir une comparaison avec la philosophie gramscienne de la praxis, il faut noter que celle-ci commence là où l’ontologie termine son travail. Mais Tosel voit une possibilité de traduire cette ontologie lukacsienne dans le langage gramscien de la praxis, en concevant l’ontologie de l’être social comme faisant partie de la praxis, à partir de la centralité du travail. La catégorie de la catharsis joue le rôle de remaniement de l’objectivité (des structures) du point de vue de la compréhension subjective (et de l’action). Tosel opère sur ce point une remise en question cette catégorie, en soulevant la question de savoir si l’approche gramscienne de la catharsis n’est pas redevable de la pensée subjectiviste, en particulier de la philosophie actualiste. Mais il résout le problème en soulignant la relation que Gramsci établit entre liberté et nécessité, structure et superstructures, de sorte qu’il n’y a pas d’acte de volonté qui ne se déploie en dehors d’un contexte donné. Revenant à la comparaison avec Lukács, Tosel affirme que l’ontologie de l’être social est la base d’une éthique, à partir de laquelle le point de vue de la classe, du parti, de l’État-nation et du parti-État est dépassé dans une conception universaliste de l’humanité, dont les liens possibles avec la philosophie gramscienne de la praxis et sa réflexion sur la liberté sont à la fois réels et encore à éclaircir.
Le troisième chapitre de cette partie, « La philosophie de la praxis comme conception intégrale du monde et/ou comme langage unifié » (1992), interroge l’idée de l’autosuffisance du marxisme en tant que « conception du monde » et la relation de cette définition avec la question du langage. Tosel part de la situation historique posée par la restauration capitaliste dans les sociétés dites « socialistes » et souligne que la synthèse de la philosophie et de la politique dans le cadre de l’approche « intégrale » proposée par Gramsci apparaît suspecte de totalitarisme et d’autoritarisme. Il propose alors de revisiter les réflexions théoriques de Gramsci et de les présenter comme des alternatives tant au stalinisme qu’à l’idéologie néolibérale. En même temps, dans un monde où il semblait que le capitalisme avait définitivement triomphé (comme voulait surtout le faire croire la propagande triomphaliste du système lui-même), l’idée de Gramsci de l’autosuffisance du marxisme comme conception du monde pouvait sembler dérisoire. Mais, pour celles et ceux qui voulaient bien prêter attention à ses idées, le communiste sarde, enterré de son vivant par les geôliers fascistes, puis canonisé par les lectures réformistes et réenterré par l’offensive néolibérale en compagnie du mal-nommé « marxisme-léninisme », a continué à lancer des assauts habiles contre l’idéologie bourgeoise. S’opposant à toute tentative de transformer la « vision du monde » en un ensemble de principes rigides auxquels ses adhérents doivent adhérer, Tosel souligne l’importance de l’historicisation de la philosophie à laquelle Gramsci a procédée – en tant que lecteur de Marx et recréateur du marxisme – de telle sorte qu’elle ne puisse pas être comprise en dehors de l’histoire.
Ainsi, l’autosuffisance du marxisme ne consiste pas dans son caractère fermé ou endogame, mais dans sa capacité à comprendre sa propre historicité et, à partir de là, à construire une volonté collective. Contre un néolibéralisme qui se vante d’étendre la démocratie, mais sous des formes de plus en plus vidées de leur contenu, bureaucratiques et dégradées, Tosel a souligné le caractère démocratisant de la philosophie de la praxis comme projet d’universalisation des conditions de libération des classes subalternes et de construction d’une forme de vie en commun, le communisme. Dans cette réflexion, Tosel reprend les élaborations de Gramsci sur la question du « conformisme social » et de la « technique civile », tous deux liés aux modes d’organisation politique de la société, mais aussi à la dimension du langage. D’où les conceptions de la traductibilité des langues, qui dépassent leur dimension strictement linguistique et les relient à la nécessaire mise en forme d’une position idéologique en accord avec une pratique politique révolutionnaire.
Ce thème est également abordé dans le texte suivant, « La pratique de la traduction et la théorie de la traductibilité des langues scientifiques et philosophiques chez Antonio Gramsci » (2000, extrait des actes d’un colloque de 1992), qui traite de l’importance de la pratique de la traduction chez Gramsci et de sa relation avec la conception de la traductibilité comme catégorie d’importance méthodologique dans les Cahiers de prison.
Cette première partie du livre se termine par une étude originale intitulée « Gramsci devant Vico ou Vico dans Gramsci » (1996, issue des actes d’un colloque de 1994), dans laquelle Tosel analyse l’influence du penseur napolitain – récupéré à sa manière par Benedetto Croce – sur la pensée du théoricien communiste. Il relève une présence minimale de Vico dans certains articles de Gramsci entre 1916 et 1918. Mais dans les Cahiers de prison, le philosophe napolitain est mentionné une vingtaine de fois, généralement en rapport avec les débats dirigés contre Benedetto Croce. La tentation est alors grande, nous dit Tosel, de faire de Vico une sorte d’ancêtre illustre de l’historicisme contemporain. Toutefois, on peut penser qu’il y a également une influence plus directe de Vico sur Gramsci. Tosel commence son examen des usages de Vico par Gramsci par l’article « Socialisme et culture » (1916), dans lequel Gramsci s’appuie sur l’interprétation par Vico du dicton grec « connais-toi toi-même » (γνῶθι σεαυτόν / nosce te ipsum), pour souligner l’auto-éducation du prolétariat et sa lutte pour l’accès à la culture. Pendant la période 1917-1922, dans le cadre d’une relecture de l’histoire qui souligne l’importance de la volonté, les références à Vico deviennent plus occasionnelles. Mais dans un article de 1918 intitulé « La critique » – une polémique avec le socialiste réformiste Paolo Treves –, Gramsci met l’accent sur la lecture que fait Vico de la question de la Providence, en soulignant qu’elle fonctionne comme une croyance fataliste qui, à son tour, incite à l’action (un argument qu’il reprendra plus tard dans les Cahiers à propos du déterminisme marxiste), de sorte que Vico apparaît comme une référence importante pour penser le processus de l’histoire.
Dans les Cahiers de prison, la question de Vico devient plus complexe. D’une part, en lien avec ses relectures de la dialectique selon Croce, Gramsci considère que Vico est inclus par Croce dans un mouvement de pensée représente une régression par rapport à Hegel. Vico semble également perdant dans la comparaison avec l’auteur de la Science de la logique dans la mesure où sa conception de la Providence apparaît comme une sorte de restauration des conceptions catholiques, alors que Hegel avait cherché en Napoléon (c’est-à-dire dans la politique réelle) l’incarnation de ses conceptions philosophiques.
Tosel poursuit en analysant le sauvetage gramscien de trois thèmes propres à Vico. Le premier d’entre eux découle de la maxime verum factum convertuntur (le vrai et le fait sont convertibles). Gramsci s’oppose ici à une lecture idéaliste postérieure proposée par Croce, en soulignant que le lien entre la vérité, les faits et la praxis est une question fondamentale du marxisme. La deuxième maxime vichienne est certo si converte nel vero (le certain devient le vrai), une question qui pour Vico était liée à la lecture de l’histoire en termes de combinaison de la raison (le vrai pour la philosophie) et des faits documentés et analysables à partir de la philologie (le certain). Au sein d’une conception idéaliste mais historiciste, cette relation entre le vrai et la vérité, le fait et la raison, laissait une place à la singularité et à l’éventualité de l’histoire. Ce thème apparaît aussi clairement dans les réflexions gramsciennes sur la compréhension de l’histoire et des rapports de forces en termes de « philologie vivante », ainsi que dans l’élargissement de la définition de la philosophie comme lutte pour l’hégémonie et la formation de la conception du monde d’un groupe social, qui combine la construction de vérités théoriques et de certitudes historiques à travers la configuration d’une praxis dont la continuité rend le groupe plus homogène et conscient de ses objectifs.
Enfin, Tosel s’attarde sur la discussion gramscienne de la conception vichienne de la Providence, dont Croce avait proposé une interprétation idéaliste. Selon lui, Gramsci suggère la possibilité d’une interprétation différente, mais ne la produit pas, bien qu’il relie la question à ses lectures sur Ricardo et le problème du « marché déterminé ». Ici, il me semble que l’on pourrait dire que Gramsci – là encore de manière pas entièrement systématique – a produit cette lecture matérialiste historique de la Providence vichienne à travers la proposition théorique de lire les restaurations comme une « ruse de la Providence », c’est-à-dire comme des processus qui imposent en premier lieu la guerre de position et la révolution passive mais qui – à l’encontre les prévisions de leurs promoteurs – apparaissent comme des facteurs de mûrissement des forces contraintes par la direction réformiste à affronter le cours restaurationniste[1].
Hégémonie ou révolution passive
La deuxième partie, consacrée aux problèmes de stratégie révolutionnaire, s’ouvre sur le texte « ”Est et Ouest”. Les problèmes de la stratégie révolutionnaire dans l’analyse gramscienne des Cahiers de prison » (texte extrait du recueil L’esprit de scission), qui passe en revue les principales élaborations de Gramsci sur les questions de la guerre de positions et de la guerre de manœuvre, de la révolution passive et du parti en tant que Prince moderne. Tosel insiste ici sur l’idée qu’après la Commune de Paris commence une période de guerre de positions, au sein de laquelle la Révolution russe serait une anomalie, bien que Gramsci évoque également d’autres éléments de périodisation, dans lesquels il poser la question de façon plus ouverte. Il écrit par exemple :
« Dans l’Europe, de 1789 à 1870, on a eu une guerre de mouvement (politique) dans la Révolution française et une longue guerre de positions de 1815 à 1870 ; à l’époque actuelle, la guerre de mouvements a eu lieu politiquement de mars 1917 à mars 1921 et a été suivie d’une guerre de positions dont le représentant, aussi bien pratique (pour l’Italie) qu’idéologique, pour l’Europe, est le fascisme ».[2]
Il ne s’agit pas de trouver la citation occasionnelle pour proposer telle ou telle lecture, mais de signaler que, chez Gramsci, cette réflexion sur la guerre de positions a un caractère central et en même temps qu’elle comporte de multiples variantes dans ses formulations. On peut relever des passages dans lesquels la guerre de positions apparaît comme prédominante après 1870, d’autres dans lesquels 1917 semble être le moment charnière entre la primauté d’une forme de lutte et d’une autre, d’autres encore, comme celui que je viens de citer, qui périodise la question en d’autres termes. Ceci est également lié à la question de l’État intégral et au problème de savoir si cette catégorie peut être appliquée à l’État libéral ou aux changements de formes d’État caractéristiques de l’entre-deux-guerres. C’est une question que nous avons déjà analysée à propos du livre de Yohann Douet, étant donné que l’articulation entre l’État et la société civile que suppose la catégorie de l’État intégral implique que la guerre de positions devient la forme centrale de lutte. La question du rôle de l’intelligentsia, la reformulation de la problématique du parti en termes de « Prince moderne » et la relation entre le parti et l’Etat, que Tosel analyse en termes de « méta-jacobinisme », complètent l’exposé.
En définissant la révolution passive comme la stratégie poursuivie par la bourgeoisie pour assimiler et neutraliser la politique révolutionnaire de la classe ouvrière, la guerre de positions implique une lutte globale, qui n’exclut pas le « moment politico-militaire » et exige à son tour une lutte pour la « réforme morale et intellectuelle », tous thèmes caractéristiques du débat gramscien. Tosel en donne un exposé qui a le mérite d’offrir une délimitation claire par rapport à celles et ceux qui ont fait de la révolution passive leur propre stratégie. Le « méta-jacobinisme » auquel Tosel fait allusion implique la pratique de la réorganisation de la société par le biais d’une démocratie substantielle qui surmonte la différence entre les dirigeants et les dirigés, bien que Tosel lui-même ait souligné que Gramsci avait une vision peu critique de l’identification entre le parti et l’État. Nous ajouterons que pour repenser cette question, il est nécessaire de rétablir l’importance des conseils d’usine et de la démocratie soviétique comme partie intégrante de l’hégémonie.
Une critique que l’on peut adresser à l’approche de Tosel dans cet article est précisément qu’il n’analyse pas le problème stratégique de manière plus concrète, c’est-à-dire dans quelle mesure ses réflexions conduisent à une approche différente de la question de la stratégie et en quoi celle-ci consisterait. Le peu de poids accordé dans l’article à la question de la violence révolutionnaire et aux relations des forces politico-militaires peut être vu comme l’expression de ce manque.
Le texte suivant, « Pour une réévaluation du moment éthico-politique chez Gramsci » (1990), est une tentative particulièrement intéressante pour repenser le problème de l’idéologie de masse créée par l’offensive néolibérale et le poids que doit avoir la lutte idéologique et pour les valeurs dans le cadre de la lutte politique pour le communisme. Tosel revient ici sur le concept de catharsis. Ce texte se combine bien avec le texte suivant, « Américanisme, rationalisation, universalité selon Gramsci » (1989), qui reprend les réflexions gramsciennes sur l’américanisme et le fordisme et la manière spécifique dont Gramsci a pensé la relation entre la modernisation économique capitaliste et la lutte pour l’hégémonie. Selon le théoricien sarde, l’hégémonie peut être envisagée dans sa forme la plus élémentaire comme une alliance de l’ouvrier fordiste et du paysan méridional, ce qui conduit à son tour à la notion d’une modernité alternative à celle du capitalisme et à une conception internationaliste qui a souvent été minimisée dans les lectures de Gramsci en tant que penseur centré presque exclusivement sur le cadre de l’analyse nationale.
L’article « Sur quelques distinctions gramsciennes. Économie et politique. Société civile et État » (1995) clôt cette deuxième partie. Il reprend la discussion du concept d’État intégral, dont Tosel déduit la possibilité d’une double lecture. Alors que l’on peut penser que la relation entre l’État et la société civile garantit un exercice de l’hégémonie par le biais du consensus (et donc avec une forme plus ou moins démocratique), c’est plutôt le contraire qui est vrai : la coercition ne peut pas être éliminée par des formes évolutives, parce que la société civile elle-même est affectée par un conflit de classes, dont l’existence de l’État est l’expression historique concrète. Ainsi, la lecture de Tosel, qui souligne l’importance de la société civile en tant que terrain de contestation hégémonique, se sépare des lectures qui la présentent comme un espace neutre. Dans le même sens, dans les différents articles qui composent l’ouvrage, l’hégémonie n’apparaît pas comme une influence intellectuelle ou idéologique générale, mais comme l’hégémonie de la classe productrice, dont l’autonomie dans le domaine de la production est consubstantielle à l’hégémonie sur le plan politique.
Gramsci en France
La troisième partie est constituée des articles « Gramsci face à la Révolution française. La question du jacobinisme » (1984), et « Gramsci en France » (1995). Il convient ici de noter le contraste entre l’intérêt de Gramsci pour l’histoire politique et sociale française et le manque de succès de Gramsci en France, où ses travaux ont été reçus assez tardivement.
Le premier article commence par une récapitulation des analyses de Marx sur la Révolution française et le jacobinisme, avant de passer aux lectures gramsciennes sur le sujet, de l’anti-jacobinisme de jeunesse à une réévaluation du jacobinisme en termes de révolution permanente et d’hégémonie dans les Cahiers de prison. Cette opération de réévaluation lie le jacobinisme à la formation de l’État moderne en tant que garantie de l’hégémonie bourgeoise au-delà des limites économiques et corporatives de cette classe. La question du « méta-jacobinisme » fait ici retour à travers la figure du Prince moderne, qui synthétise les éléments de continuité et de dépassement que la politique révolutionnaire de la classe ouvrière garde, dans le contexte de la révolution capitaliste passive, avec la vieille expérience de la révolution bourgeoise et ses leçons.
Le dernier article reprend les lectures de Gramsci en France, en désignant la période 1945-1959 comme celle d’une « réception difficile », notamment en raison de la résistance du PCF à intégrer les élaborations de Gramsci dans son univers théoriques. Tosel met par la suite en évidence les polémiques menées par Althusser dans les années 1960 et 1970, autour de deux moments différenciés, l’un de critique de l’historicisme et l’autre de réflexion sur l’hégémonie et les appareils idéologiques d’Etat. En même temps, Tosel considère qu’il y a eu, entre 1966 et 1977, une série de débats qu’il synthétise dans la figure des « équivoques de l’hégémonie » dans laquelle est apparue l’identification forcée de Gramsci à l’eurocommunisme, suivie d’une étape qui est allée « de l’effacement à la déconstruction » (1977-1993).
Au moment où l’offensive néolibérale battait son plein, Tosel a envisagé la possibilité d’un nouveau développement du marxisme, à la fois celui de Marx et celui de Gramsci, comme une justification du projet communiste. Les événements ultérieurs lui ont largement donné raison : la grève française de 1995 a marqué le retour de la lutte des classes tenue pour acquise par le triomphalisme capitaliste, et ouvert le champ des « mille et un marxismes » dont Tosel faisait lui-même partie. Le développement des études gramsciennes s’est accéléré au cours des décennies suivantes.
En conclusion : vers de nouveaux départs
Ce livre est une bonne introduction aux lectures de Gramsci effectuées par Tosel, tout en servant d’introduction à la pensée du communiste sarde. Tout au long des différents articles, notamment ceux de la première partie, Tosel expose une réflexion cohérente sur la question de la praxis, qu’il oppose aux lectures matérialistes mécanistes ou organicistes, mais aussi aux vues idéalistes et subjectivistes. Le matérialisme apparaît comme une condition préalable à la centralité de la praxis sur le plan théorique.
En guise de réflexion sur cette question, nous devrions nous demander si le marxisme d’aujourd’hui ne devrait pas être plus proche d’un « matérialiste contemplatif » que ne le pensaient Marx, Lénine, Trotsky ou Gramsci. Cela renvoie, tout d’abord, à la manière de caractériser le matérialisme chez Gramsci. Dans un passage des Cahiers de prison, Gramsci souligne la fortune inégale dans l’histoire de la philosophie des concepts de « matérialisme » et d’ « immanence » (que Gramsci lui-même privilégie) et affirme que Marx n’a jamais qualifié sa conception de « matérialiste » (Cahier 11 §16), Cette dernière affirmation, plutôt énigmatique de la part d’un traducteur des « Thèses sur Feuerbach », peut être facilement comprise en examinant les affinités entre le « nouveau matérialisme » qu’annoncent les Thèses marxiennes[3] et la « nouvelle immanence » des Cahiers. Gramsci a également défini la philosophie de la praxis comme « un humanisme absolu de l’histoire » (Q11 §27), comme une manière de se référer à une pensée pleinement intégrée à l’histoire réelle et non aux philosophies idéalistes de l’histoire ou au matérialisme pré-marxiste. Sa façon de s’exprimer est clairement influencée par son appropriation de l’historicisme et de l’idéalisme italien et allemand, ainsi que par les lectures du marxisme d’Antonio Labriola.
Ainsi, la terminologie qu’il utilise doit beaucoup à son contexte, mais le contenu de ses réflexions théoriques va au-delà de celui-ci. Je veux dire, par exemple, qu’aujourd’hui je ne serais pas enclin à définir le marxisme comme un « historicisme absolu ». D’abord parce qu’il n’y a pas d’historicisme actuel avec lequel il serait possible de dialoguer de manière critique comme Gramsci l’a fait avec Croce ; ensuite, parce que l’historicisme ne suffit pas pour repenser le rapport entre la société et la nature – une question que la crise écologique a mise au premier plan. Cependant, un concept tel que la « nouvelle immanence » (C10 II §9), qui suppose la synthèse de l’économie, de la philosophie, de l’histoire et de la politique, est susceptible d’inclure la réflexion sur le rapport entre la société humaine et la nature à travers les sciences que l’on appelle habituellement « sciences naturelles » en accordant à ce rapport un poids plus important que celui que Gramsci lui-même lui attribuait au sein de la philosophie de la praxis. Paradoxalement, la meilleure façon de la mettre en pratique serait de s’éloigner de l’historicisme, en actualisant la réflexion marxiste en fonction de notre situation historique actuelle. En ce sens, il n’y a rien de plus gramscien que d’essayer de penser les problèmes dans leur contexte et leur spécificité, au lieu de reproduire les citations de Gramsci, et rien de plus matérialiste que d’essayer de penser la forme actuelle de la « nouvelle immanence ».
En s’éloignant un peu de la question du matérialisme de Gramsci et en s’intéressant plus généralement à la manière dont le rapport entre société et nature a été historiquement pensé dans le marxisme, le contexte actuel pose non seulement la question d’écarter les formes les plus délirantes de productivisme telles que celles promues par le stalinisme (discrédité depuis longtemps) mais aussi de rediscuter d’une manière de comprendre le marxisme lui-même qui atténue le « côté actif », ou plutôt, qui le formule en termes de transformation plus mesurée de la réalité naturelle que ce que concevait une grande partie du marxisme du 20e siècle, comme l’a souligné à son époque Manuel Sacristán et comme Marx lui-même le concevait dans ses réflexions sur les effets négatifs du capitalisme sur la terre, les conditions de vie et la santé des classes populaires[4].
Sur la question stratégique, l’aspect le plus intéressant, et le plus original, du livre est le traitement de la question de la révolution passive en tant que stratégie poursuivie par la bourgeoisie et la proposition que la lutte pour l’hégémonie implique de dépasser à la fois la révolution passive et la démocratie libérale et bourgeoise dans les termes de démocratie de la classe productrice. Sur ce point, le manque de réception de la pensée de Trotsky par Tosel semble avoir une incidence sur le caractère abstrait de ses appels à dépasser le parti-état et le parti unique comme formes caractéristiques du stalinisme.
Enfin, et dans la continuité de ce que nous avons signalé à propose de la préface du livre, la récapitulation des difficultés du développement des débats gramsciens en France (et sans nier la richesse des différentes contributions existant dans cette sphère nationale) semble ne pas avoir de « solution française », ce dont Tosel lui-même était bien conscient, raison pour laquelle il entretenait un lien étroit avec les débats en Italie. L’ouverture à une dimension plus globale du débat gramscien (généralement très difficile pour ceux qui vivent sur le sol européen, au-delà de la reconnaissance d’une certaine « réception » ici ou là) pourrait être une clé. L’autre possibilité, plus « nationale », pourrait être « l’usage » de Gramsci pour approfondir la réflexion sur la réalité française, qui synthétise une série de questions qui rendent sa pensée actuelle : la crise de la démocratie libérale, la crise des partis traditionnels, un mouvement ouvrier, traditionnellement organisé par le syndicalisme, qui se caractérise désormais par une composition de plus en plus multiethnique et féminisée, autant de questions qui constituent la « forme actuelle » de l’hégémonie et qui – si l’on tient compte de la situation française actuelle – vont se poser comme les clés de nouvelles réflexions théoriques servant à actualiser l’héritage de Gramsci.
*
Juan Dal Maso est membre du PTS (Parti des travailleurs socialistes) argentin depuis 1997 et l’auteur des ouvrages Gramsci’s Marxism (2016), traduit en portugais et en italien, Hegemony and Class Struggle (2018), traduit en anglais, et Althusser y Sacristán (2020), co-écrit avec Ariel Petruccelli.
Cet article a été initialement publié sur le site La Izquierda Diario le 12 février 2023. Traduction Contretemps.
Illustration : Wikimedia Commons.
Notes
[1] Cf. sur ce point Cahier10 II §41 XVI, écrit entre août et décembre 1932 et Cahier 15 §11, écrit entre mars et avril 1933.
[2] Cahier 10 I §9, écrit entre la mi-avril et la mi-mai 1932
[3] Cf. notamment la dixième des thèses sur Feuerbach dans laquelle apparaît la formulation de « nouveau matérialisme » : « Le point de vue de l’ancien matérialisme est la société civile-bourgeoise (bürgerliche Gesellschaft). Le point de vue du nouveau matérialisme, c’est la société humaine, ou l’humanité socialisée (die vergesellschaftete Menschheit) – NdT.
[4] Voir à ce sujet l’article de Facundo Nahuel Martín « Materialismo (no solo) histórico. Une defensa de Sebastiano Timpanaro » [Un matérialisme (pas seulement) historique. Une défense de Sebastiano Timpanaro]






![Gramsci, penseur de l’hégémonie [Podcast]](https://www.contretemps.eu/wp-content/uploads/Gramisci-150x150.jpg)