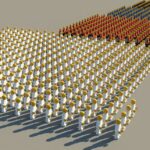Transformer les idées existantes en idées révolutionnaires : la bataille des idées selon Gramsci
Objet de récupérations venant de divers bords politiques, de déformations au sein même de la gauche et en particulier dans le Parti Communiste des années d’après-guerre, Antonio Gramsci est souvent réduit à la défense de la conquête du pouvoir par la bataille des idées. Rien de plus réducteur et de plus faux comme l’explique ici Andrea Cavazzini, qui restitue la place que Gramsci accorde aux idées dans les processus révolutionnaires. Pour ce dernier, l’un des objectifs centraux des communistes devait être de lutter contre le pouvoir des idées dominantes et de transformer les idées existantes, en particulier dans les classes exploitées et opprimées, en idées « justes », c’est-à-dire révolutionnaires.
***
Des actualités « inactuelles »
On constate, aujourd’hui, une présence grandissante de Gramsci, non seulement dans la recherche savante et « engagée », mais aussi dans le discours public et médiatique, voire dans l’industrie de la culture au sens large du terme[1]. Il peut être intéressant, d’un point de vue « gramscien » précisément, de voir quelle image de Gramsci véhicule cette présence, en faisant provisoirement abstraction des analyses plus fines et articulées de sa pensée (qui existent aussi, bien entendu et heureusement, dans le cadre de cet intérêt diffus).
Par exemple, l’émission radio Le Book Club affirme, dans la bio du communiste italien, que Gramsci a « développé la théorie de l’hégémonie culturelle, dont l’idée fondamentale réside dans la conquête du pouvoir par les idées »[2]. Dans un autre média, hérodote.net, on peut lire que Gramsci « développe sa théorie de l’hégémonie culturelle, selon laquelle le combat des idées précède le combat politique »[3]. On pourra en outre rappeler que Jean-Michel Blanquer a lancé en 2021 un cercle de réflexion « anti-wokisme » en se réclamant de Gramsci et de sa « théorie des victoires culturelles à remporter avant de pouvoir gagner le pouvoir politique »[4] et que, en 2007 déjà, Nicolas Sarkozy a déclaré au Figaro : « Au fond, j’ai fait mienne l’analyse de Gramsci : le pouvoir se gagne par les idées »[5].
Finalement, l’image de Gramsci qui émerge de ces quelques exemples (ni exhaustifs ni homogènes) est assez univoque : l’auteur italien serait le théoricien de techniques ou de méthodes efficaces pour mener et gagner la lutte politique, des méthodes se résumant à conquérir le pouvoir à travers les idées – Gramsci en symbole de la politique vue comme manipulation des représentations et des discours.
Romain Descendre et Jean-Claude Zancarini ont rappelé à juste titre que cette image aplatie et caricaturale vient aux hommes politiques récents de l’appropriation superficielle et instrumentale de Gramsci faite par la Nouvelle Droite[6]. Cette généalogie est certainement pertinente, mais elle a une portée plus vaste que l’opération menée par Alain de Benoist, l’image de Gramsci en tant que théoricien de la prise du pouvoir par les idées débordant largement les cercles idéologiques droitiers.
On ne peut en réalité entièrement dissocier cette image à la fois triomphaliste (Gramsci inspirateur d’une prise efficace du pouvoir) et idéaliste (Gramsci théoricien du pouvoir par les idées) de l’appropriation gramscienne par la stratégie eurocommuniste du Parti Communiste Italien dans les années 1970. Ainsi, Jean-Claude Zancarini rappelle que l’expression « gagner la bataille des idées », souvent associée au penseur sarde, ne se trouve pas en tant que telle dans ses écrits, et que le seul lien réel entre cette phrase et Gramsci est la rubrique de l’Ordine Nuovo intitulée « La bataille des idées ».
Tout cela est strictement vrai. Pourtant, on peut supposer que l’engouement pour cette formule ne vient pas d’une connaissance précise de l’organe théorique des Conseils d’usine turinois en 1919-1921. La rubrique de l’Ordine Nuovo est largement tenue par Palmiro Togliatti, le futur secrétaire général du PCI. Or, après la guerre, « La bataille des idées » devient le titre d’une rubrique de la revue culturelle du PCI, Rinascita, dirigée justement par Togliatti. Il faut rejeter sans hésitation toute lecture faisant de l’œuvre de Togliatti une trahison ou une déformation de la pensée de Gramsci.
Toutefois, l’accent mis sur les « idées » en tant que champ d’une bataille pour la construction du consensus correspond à l’appropriation de Gramsci par la stratégie du PCI dans le contexte de la République italienne – un contexte qui rendait de toute évidence impossible, après Yalta et les événements grecs, d’envisager une prise du pouvoir révolutionnaire malgré l’énorme puissance du parti communiste. Or dans un tel contexte il est presque inévitable que la « bataille des idées » – au sens, somme toute assez traditionnel, d’élaboration et diffusion pédagogique d’une série d’orientations intellectuelles et culturelles – tende à devenir l’ersatz de la capacité de l’organisation à opérer des transformations radicales des institutions et de la structure économique et à coïncider avec l’activité stratégique du Parti.
Toutefois, la centralité de la « bataille des idées », qui devient au fur et à mesure indistinguable de la notion d’hégémonie, est largement issue de la polémique anticommuniste des cercles intellectuels de droite, notamment catholiques-traditionnalistes, soucieux de la dissolution de la civilisation chrétienne que semble impliquer la pénétration dans les mentalités des idées élaborées et transmises par un Parti communiste formellement exclu du pouvoir gouvernemental.
L’histoire de cette lecture de l’action du PCI et de la société italienne, qui débouche, à l’époque de Berlusconi, sur le mythe d’une société italienne dominée pendant des décennies par les idées communistes et progressistes, reste à écrire : elle n’est pas sans importance pour entendre tant la posture violemment revancharde du gouvernement d’extrême droite italien que les propos sur Mai 68 ou sur le marxisme universitaire de MM. Sarkozy, Valls et Blanquer[7].
Gramsci et les « idées » entre l’eurocommunisme et la crise du marxisme
Il faudra pourtant se borner ici à suivre les manières dont, au sein de la gauche communiste, le thème de la culture et de l’hégémonie a fait l’objet d’un clivage dont les effets ont également surdéterminé les discours « de droite » sur l’hégémonie de la mentalité communiste. Car la réduction de cette fameuse notion à une théorie de la construction progressive du consensus dans la société date en effet de l’appropriation de Gramsci par le PCI, certes déjà à partir des années 1950, mais avec une accélération et un changement de statut lors de l’opération « eurocommuniste » dans les années 1970, visant, non seulement à fournir aux partis communistes présents du côté « atlantique » du « Rideau de Fer » un espace d’action et d’existence, mais à normaliser désormais leur présence au sein des appareils étatiques et des rapports sociaux capitalistes.
En 2007, un ancien dirigeant de la Nouvelle Gauche extraparlementaire refusait de parler d’« actualité de Gramsci » en faisant allusion aux « actualisations » menées dans les années 1970 par le PCI afin de cautionner à travers l’œuvre du communiste sarde l’intégration du Parti au système politique italien: « « Il n’y a aucune “impressionnante actualité” de Gramsci, et il ne peut pas y en avoir »[8]. Selon Raul Mordenti, en effet, Gramsci est l’initiateur d’une recherche inachevée et interminable surgissant d’une défaite historique des perspectives révolutionnaires mondiales, entre l’écrasement du Biennio Rosso en Italie, l’Action de Mars en Allemagne et l’essor du fascisme. On peut mesurer par-là le paradoxe que constituent les références à Gramsci en tant que théoricien d’une prise du pouvoir victorieuse, d’une conquête efficace de la société par les « idées ».
C’est contre l’opération « eurocommuniste » que Louis Althusser, dans un manuscrit inédit écrit en 1978 et récemment publié, entreprend une critique de Gramsci fortement surdéterminée par la lecture que le PCI donnait de l’hégémonie. Ainsi, selon Althusser, « la force ne paraît chez Gramsci que pour préparer sa pure et simple disparition dans le concept d’État comme hégémonie »[9]. L’hégémonie s’opposerait donc à la force, en représenterait la sublimation au sein d’un État vu comme lieu de la conciliation des antagonismes (ou du moins de la disparition des conflits irréductibles) :
« [Gramsci] va « gonfler » démesurément le concept d’hégémonie pour lui faire jouer pratiquement le rôle de substitut du concept de classe dominante ou de dictature de classe […]. Gramsci finira par penser l’État comme hégémonie, ou plutôt l’État comme le phénomène d’une hégémonie qui l’embrasse et le domine.[10] »
Gramsci penserait donc l’hégémonie comme l’opérateur d’un dépassement de la domination de classe – dépassement théorique, mais aussi pratico-politique, car le vocabulaire de l’hégémonie remplacerait celui de la dictature comme grammaire de la conquête du pouvoir. Une telle conquête se ferait désormais à travers la pénétration systématique de la société civile par des stratégies de formation du consensus enveloppant ou « embrassant » l’État en tant que « socle » irréductible du conflit et de la domination. Ainsi, la réflexion gramscienne indiquerait une voie pour parvenir à prendre le pouvoir de manière « civilisée », capable donc d’émousser le tranchant des luttes de classe et d’adoucir les mœurs du conflit politique.
Si la critique d’Althusser est tout à fait pertinente devant le « gramscisme » du PCI dans les années 1970, elle n’en reste pas moins insuffisante par rapport au statut, structurellement problématique, de la notion d’hégémonie et de la réflexion gramscienne en général. Car Gramsci dit exactement le contraire de ce que lui reproche Althusser, et que lui-même reproche en réalité à Benedetto Croce :
« On peut dire que, concrètement, Croce met l’accent, quant à l’activité historico-politique, uniquement sur le moment politique que l’on appelle « hégémonie », le moment du consensus, de la direction culturelle, en le distinguant ainsi du moment de la force, de la contrainte, de l’intervention législative et étatique voire policière. »[11]
Autrement dit, Gramsci, critiquant les communistes italiens par anticipation, exclut que l’activité politique « historique » (au sens de « créatrice d’histoire », « historiquement déterminante ») puisse consister uniquement dans la production d’un consensus ou d’une unification sociale et politique autour d’une « direction culturelle » (ou, pour parler plus directement, autour des « idées »).
Transformer les idées
Mais, si Gramsci ne croit pas à la toute-puissance du consensus et de la « culture », quel est dans sa méditation le statut du moment culturel ou « idéel » ?
Comme la remarque de Raul Mordenti nous invite à le penser, un tel statut ne saurait être qu’inachevé et problématique, objet d’une analyse et d’une élaboration perpétuelles : non pas recette efficace pour la prise silencieuse du pouvoir dans l’opinion publique ou pour l’apprivoisement de la guerre civile latente dans les sociétés divisées en classes, mais lieu d’un problème ouvert par les impasses du processus révolutionnaire, qui se traduit par la méditation d’un conflit interminable. On peut en effet estimer que la clé de la réflexion gramscienne sur la culture et les idées n’est pas la figure du consensus, mais celle de la polarité entre sens commun et conception du monde.
Le statut politique des idées, chez Gramsci, est souvent lié moins à la construction d’un consensus qu’à des actes d’appropriation et de transformation critiques des idées existantes : « Le choix et la critique d’une conception du monde est un fait politique »[12]. Il est donc question de choisir et de critiquer les conceptions du monde, les idées qui structurent les sensibilités et les comportements, non seulement de les utiliser, voire de les transmettre unilatéralement et d’en imprégner les multitudes. Certes, selon Gramsci :
Tout acte historique ne peut pas ne pas être accompli par l’« homme collectif », autrement dit il implique d’atteindre une unité « culturelle-sociale », ce par quoi une multiplicité de volontés désagrégées, avec une hétérogénéité des fins, sont soudées les unes aux autres au nom d’une fin identique, sur la base d’une même conception du monde. »[13]
Mais il convient d’articuler le moment de l’unité à l’ensemble de la problématique de Gramsci, qui insiste fortement sur le processus de libération des actions et des pensées par rapport aux idées « désagrégées » et « hétérogènes » – un processus de réforme de l’intelligence sans lequel il n’y a pas de conception du monde cohérente possible :
« Faut-il préférer « penser » sans avoir une conscience critique, d’une manière désorganisée et contingente, donc « participer » à une conception du monde « imposée » mécaniquement par le milieu extérieur, c’est-à-dire par l’un des nombreux groupes sociaux dans lesquels chacun est impliqué automatiquement depuis son accès à la vie consciente […] ou faut-il au contraire préférer élaborer sa propre conception du monde de manière consciente et critique et partant […] choisir sa propre sphère d’activité, participer activement à la production de l’histoire du monde, être son propre guide et ne pas accepter passivement de l’extérieur l’empreinte donnée à sa propre personnalité ? »[14]
Dans ce passage, le statut des « idées » est irréductible à celui d’un instrument de manipulation ou de pacification. Selon Gramsci, les « idées » sont d’abord les idées d’autrui – mais d’un autrui qui n’est en réalité personne – c’est-à-dire des idées transmises et reproduites de manière anonyme par les rapports sociaux : ce sont moins les idées que nous « avons » que des idées qui nous « ont », qui nous habitent tout en venant d’ailleurs, et qui opèrent cette séparation intime des individus par rapport à eux-mêmes par laquelle ils sont empêchés de se conduire eux-mêmes, d’être les « guides de soi-même ».
Des idées qui nous agissent
Il y a chez Gramsci une véritable hantise de la passivité, de tout schéma comportemental et intellectuel simplement reçu, non reconstruit par un acte conscient et maître de lui-même. Une conception du monde n’a de valeur que si elle est élaborée et affirmée par une activité libre, par laquelle le sujet agissant se retrouve dans ses propres expressions. Le « sens commun » constitue le pôle opposé à la conception du monde en tant que produit de l’activité critique : il est
« la conception du monde absorbée de manière non critique depuis les différents milieux sociaux et culturels où se développe l’individualité morale de l’homme moyen […] une conception désorganisée, incohérente, inconséquente, conforme à la position sociale et culturelle des multitudes »[15].
Autrement dit, le sens commun est la pensée par laquelle celui qui pense est pensé et agi au lieu d’être pensant et agissant : la pensée qui pense en moi en quelque sorte sans moi et contre moi, contre la libération possible de mes capacités d’agir et de penser.
Les « idées » sont ainsi, pour Gramsci, le champ d’une tension irréductible entre la passivité et l’activation ou le devenir-actif : ce qui est incompatible avec la vision d’un consensus qui serait le simple produit de la pénétration de certains schémas culturels au sein de la société à travers les agissements plus ou moins occultes des professionnels de la persuasion. Une hégémonie réelle ne saurait coïncider avec un consensus de fait, avec les idées qui s’affirment effectivement dans un temps et un lieu empiriques : elle n’est hégémonique que si la conception du monde qui la soutient promeut et exprime l’activation des puissances subjectives de ceux qui l’adoptent. Il y a donc une différence irréductible entre les idées efficaces et les idées « justes » : ces dernières ne sont jamais séparables de l’activité critique d’une prise de conscience.
Ainsi, Gramsci peut à la fois faire l’éloge de l’Église catholique à cause de la capacité dont elle a fait preuve de produire l’unité des idées et des sentiments des multitudes et critiquer cette même institution dans la mesure où l’unité entre les classes cultivées et les gens ordinaires n’est réalisée dans les civilisations chrétiennes traditionnelles qu’en limitant l’exercice de l’activité critique et la libération intellectuelle[16]. Ce qui montre encore une fois que le fil conducteur de la réflexion de Gramsci n’est pas la prise du pouvoir par les idées mais la transformation des idées existantes par laquelle s’expriment les puissances intellectuelles des classes et des groupes révolutionnaires.
La difficile sortie de la subordination
Il n’est pas difficile de rappeler, devant certaines manipulations grossières, que Gramsci ne réfléchit pas du point de vue d’un candidat à l’élection présidentielle ou d’un think tank ministériel, mais uniquement à partir du mouvement ouvrier communiste et des perspectives révolutionnaires qu’Octobre 1917 a ouvertes (et rapidement refermées, du moins à l’échelle de la révolution mondiale).
Toutefois, il convient de prêter beaucoup d’attention à la manière dont Gramsci appréhende lesdites perspectives. Lors de l’écriture des Quaderni, ce qui se présente à sa réflexion est une perspective bloquée ou suspendue, comme Raul Mordenti l’a rappelé. Gramsci est le penseur d’une grande percée révolutionnaire qui n’a pas pu aboutir, et l’attention qu’il accorde à la passivité, à l’agir inachevé, incohérent, voire aliéné, relève de l’expérience directe des défaillances de l’agir révolutionnaire, des effets désastreux de l’incapacité des acteurs révolutionnaires à devenir actifs :
« L’histoire des groupes sociaux subalternes est nécessairement fragmentaire et épisodique. Il ne fait aucun doute que, dans l’activité historique de ces groupes, il y a une tendance vers l’unification, ne serait-ce que sur un plan provisoire, mais une telle tendance est perpétuellement brisée par l’initiative des groupes dominants […]. Les groupes sociaux subalternes subissent toujours l’initiative des groupes dominants, même lorsqu’ils se révoltent et s’insurgent, et ce n’est que la victoire « permanente » qui brise, et jamais de manière immédiate, la subordination. »[17]
Le problème est donc la présence, et l’efficacité, de la domination au cœur même de l’activité des groupes subalternes, ce qui fait de celle-ci précisément une fausse activité, une activité toujours-déjà détournée et appropriée par les classes dominantes.
Ainsi, Gramsci peut, d’une part, affirmer que « la moindre trace d’initiative autonome de la part des groupes subalternes devrait avoir une valeur immense pour l’historien »[18], et, d’autre part, éviter toute vision triomphaliste et naïve des manifestations de ces mêmes groupes, dont les insurrections et les révoltes sont la plupart du temps des non-actions, marquées et habitées par les effets de la domination. Gramsci a appris de la défaite de la révolution mondiale que l’expropriation des exploités touche jusqu’aux formes de leur indocilité individuelle et collective. Le renversement de cette expropriation, la capacité à retrouver la maîtrise de soi, de ses pensées et de ses actes, devient ainsi la clé effective de la notion d’hégémonie.
Cette problématique peut expliquer aussi certains aspects du statut de l’éducation dans la réflexion de Gramsci, lequel est parfois sensible à une idée de pédagogie « verticale » en tant qu’opérateur de la sortie des gens ordinaires et des groupes exploités de l’état de minorité. Ainsi, il tend dans certaines méditations, à réintroduire une division du travail entre le « peuple » et ses « instituteurs » qui correspond moins à la problématique marxiste qu’à celle du rationalisme pédagogique bourgeois, par exemple celui de la Troisième République :
« L’élément populaire « ressent », mais ne comprend pas, il ne sait pas toujours ; l’élément intellectuel « sait », mais ne comprend pas toujours, et surtout il ne « ressent » pas »[19].
Ce qui relève d’une anthropologie assez traditionnelle (et un peu primaire) entre le peuple-affect et l’élite-intellect qui se concilie assez mal avec l’idée, bien plus consistante chez Gramsci, que l’organisation et les pratiques de lutte sont, pour les classes dominées, des fonctions intellectuelles à part entière, irréductibles à des pures expressions émotionnelles qu’il s’agirait d’entraîner vers la clarté de l’intelligence. Il serait vain, je crois, de nier que chez Gramsci une tendance existe vers une forme de pédagogisme autoritaire, qui correspond assez bien d’ailleurs à la manière dont Togliatti entendait la pratique intellectuelle de « La bataille des idées » et de Rinascita, à savoir la pratique d’un magistère énonçant la ligne et redressant les déviations.
Renversements et révolutions
On peut d’ailleurs approfondir l’analyse de cette tendance en suggérant qu’elle s’articule à une certaine insensibilité, souvent remarquée chez Gramsci, aux effets de domination immanents aux appareils des partis ouvriers et à l’organisation technique-industrielle (le « fordisme »), auxquels on pourra donc ajouter les appareils et l’organisation éducatifs développés par les États-nations modernes et par les sociétés capitalistes bourgeoises.
Un commentaire de Jean-Marie Vincent expose avec une très grande lucidité à la fois la complexité de la rupture vis-à-vis de la passivité des exploités, qui ne repose nullement sur une transmission pédagogique unilatérale mais implique l’investissement actif des pratiques politiques et productives, et la sous-estimation des effets de domination et de minorisation des formes organisationnelles censées faire de ces pratiques le lieu d’exercice des fonctions intellectuelles :
« Le parti se doit d’opposer à la violence symbolique de la bourgeoisie, qui « naturalise » les rapports sociaux et nie leur historicité, une contre-violence symbolique qui ouvre de nouveaux horizons et s’affirme comme pédagogie de masse pour transformer des habitudes, des conduites quotidiennes et des façons de percevoir le monde et la société dans les milieux populaires […]. L’autodiscipline inculquée par le parti et par les syndicats, autant que par le management, apparaît ainsi comme la condition de possibilité d’un homme nouveau et de nouveaux rapports sociaux. Dans l’esprit de Gramsci, en effet, les ouvriers, en s’organisant collectivement contre le fonctionnement tayloriste des entreprises, mais aussi conformément à lui, développent peu à peu une véritable intellectualité de masse, vecteur de la culture future du communisme. »[20]
Or, tout comme l’organisation tayloriste-fordiste du travail introduit une rationalité et une efficacité difficiles à dissocier de leurs effets de domination vis-à-vis d’une force-travail rendue passive[21], l’organisation politique et syndicale des travailleurs s’avère structurellement ambiguë :
« Sous le couvert d’une relation pédagogique aux masses, [le parti] tend à établir avec elles des rapports paternalistes. L’objectif affiché, qui est de mettre fin à la passivité de ceux qui sont exploités, est en fait en contradiction avec la méthode employée : faire intérioriser, par inculcation systématique, des types de comportement, des schémas d’interprétation élaborés au sommet. »[22]
La division rigide entre base et sommet s’exprime de toute évidence dans l’opposition entre le « peuple qui ressent » et les « intellectuels qui savent » et par l’usage de l’expression « les hommes simples »[23], certes entre guillemets, mais néanmoins difficile à concilier avec ce que Gramsci soutient depuis l’expérience de l’Ordine Nuovo, à savoir qu’il n’y a rien de « simple », au niveau tant de l’intellect que de l’affect, dans un ouvrier qui accède au militantisme politique et syndical.
Ainsi, dans le texte paru en 1920 dans l’Ordine nuovo intitulé « Le Parti communiste » :
« L’ouvrier communiste qui, après huit heures de travail à l’usine, travaille encore huit heures pour le Parti, pour le Syndicat, pour la Coopérative, de manière désintéressée, et ce pendant des semaines, des mois, des années, cet ouvrier donc est, du point de vue de l’histoire de l’Homme, bien supérieur à l’esclave ou à l’artisan qui défiait tout danger mortel pour se rendre aux prières clandestines […]. Le fait même que l’ouvrier arrive toujours à penser, bien qu’il soit réduit à agir sans connaître les mobiles et les moyens de son activité pratique – ce fait ne constitue-t-il pas un miracle ? Ce miracle de l’ouvrier qui conquiert chaque jour l’autonomie de son esprit et la liberté de créer dans l’ordre des idées, qui lutte pour cela contre la fatigue, contre l’ennui, contre la monotonie du geste qui tend à mécaniser et donc à tuer la vie intérieure – un tel miracle s’organise dans le Parti communiste, dans la volonté de lutte et de création révolutionnaire qui s’exprime dans le Parti communiste.[24] »
La fonction du Parti ne consiste donc pas à éclairer les « simples », mais à prolonger et à systématiser une scission, une rupture embryonnaire avec sa propre passivité qui commence à se construire depuis les premières réactions face à l’hétéronomie des tâches industrielles. C’est le Parti non pas comme pédagogue collectif, mais comme analyseur ou instance critique et analytique – au sens étymologique des termes d’analyses et de critique, à savoir « décomposition » et « séparation » ou « distinction », les dominés se trouvant confrontés à la tâche de se « séparer » d’eux-mêmes, de « décomposer » la synthèse de leur existence produite et reproduite par leur domination.
De toute évidence, cette idée très exigeante du Parti ne s’est réalisée dans l’histoire que pendant de très courtes séquences. Les rapports verticaux et l’« inculcation » se sont imposés, et il faut rappeler que Gramsci en a été l’un des acteurs, en partie involontaires, lors de la campagne de bolchevisation des Partis communistes par la Troisième Internationale. Comme le rappelle Jean-Marie Vincent, Gramsci estimait que le parti n’aurait pas fait obstacle à l’autonomie intellectuelle des militants et des travailleurs tant que des échanges nombreux auraient été possibles entre dirigeants, cadres et base[25]. Mais comment s’assurer que ces échanges se poursuivent et agissent efficacement ?
Gramsci dans l’histoire du communisme
Quoi qu’il en soit, ces apories présentes chez Gramsci sont celles de toute l’expérience communiste et révolutionnaire dans la première partie du XXe siècle. Gramsci n’est pas le créateur d’une « voie italienne » vers le socialisme, mais un acteur (italien) du mouvement communiste mondial et de ses impasses. Il l’a lui-même reconnu, à travers des formules souvent saisissantes :
« La théorisation et la réalisation de l’hégémonie opérée par Ilitch [Lénine] a été aussi un grand événement « métaphysique. »[26]
Comme Lukács et Althusser, Gramsci estime que la pratique politique de Lénine a une portée philosophique. L’étude approfondie de cette position nous porterait sans doute trop loin : on se limitera ici à observer que l’auteur italien attribue à Lénine la « théorisation » et la « réalisation » de l’hégémonie. Ce concept vient en effet des débats au sein du Parti russe autour des rapports entre la paysannerie et le pouvoir post-révolutionnaire. Jean-Claude Zancarini a insisté sur les différences entre l’hégémonie chez Lénine et sa reprise par Gramsci :
« La définition même de ce qu’est l’hégémonie du prolétariat est en jeu dans la façon de poser la question des rapports entre villes et campagnes, entre ouvriers et paysans. Lénine pense et écrit encore en 1923 que « l’attitude de la ville envers la campagne » est « un problème politique essentiel dont l’importance est décisive pour toute notre révolution » et décide de la « retraite » de la NEP. Il n’a cependant jamais hésité à régler la question de l’approvisionnement des villes par la coercition et la force armée. Et c’est bien cette conception coercitive de l’hégémonie du prolétariat qui finira par l’emporter définitivement avec la politique stalinienne de collectivisation forcée des campagnes à partir de 1929.
Si l’on suit les prises de position de Gramsci sur cette question de 1919 à 1926, on se rend compte qu’il la pose de façon différente ; pour le dire simplement, il développe une conception de l’hégémonie du prolétariat vis-à-vis de la paysannerie en termes d’alliance et de persuasion, de confiance et de consenso (terme qui renvoie à la fois au « consentement » et au « consensus », que nous traduirons désormais par ce dernier mot), jamais en termes de coercition. Selon Gramsci, le prolétariat, pour être hégémonique, doit se comporter en classe dirigeante (qui montre le chemin, la direction à suivre) et non en classe dominante qui impose ses points de vue. »[27]
Il ne fait aucun doute que Gramsci accentue le moment du consensus en utilisant l’expérience soviétique comme une source d’enseignements, surtout à travers ses impasses et ses dérives. Il convient néanmoins de nuancer sa distance par rapport à Lénine. Bien entendu, les positions de Gramsci s’opposent directement à la politique de l’URSS en 1928 envers les paysans, mais peut-on dire pour autant que cela exprime une différence radicale entre les visions respectives de l’hégémonie chez Lénine et chez Gramsci ?
D’abord, comme le montre le passage cité où il critique la centralité unilatérale du consensus chez Croce, Gramsci n’exclut nullement, du moins en principe, le moment de la coercition de sa notion d’hégémonie ; ensuite, il ne semble pas attribuer à Lénine un autre concept d’hégémonie, ce qui suggère que les différences concernant le traitement du problème de la paysannerie sont moins des différences de principes que des écarts au sein d’un seul paradigme.
Mais le problème posé par cette phrase énigmatique sur Lénine n’est pas le degré de compatibilité entre le dirigeant italien et le dirigeant bolchevik. Il est peut-être plus utile de s’interroger sur l’indissociabilité des réflexions, et des apories, de Gramsci, d’une part, et, d’autre part, le devenir de la Révolution d’Octobre. La problématique de la passivité et de la stagnation des conduites des classes exploitées est centrale, non seulement dans la pensée de Gramsci, mais aussi dans la trajectoire d’Octobre et finalement dans ce qu’Isaac Deutscher qualifiait de tragédie du bolchevisme, à savoir la pente inéluctable qui mène le Parti du rôle d’avant-garde à la fonction d’ersatz de l’autonomie politique des classes exploitées.
Si l’on parcourt des textes (moins fréquentés que d’autres) de Lénine ou de Trotsky, on constate que les dirigeants bolcheviks ont une conscience aiguë du fait que, faute d’une sortie réelle de la minorité imposée aux masses par la domination, faute donc d’une conquête de leurs propres puissances intellectuelles de la part des exploités, la démocratie soviétique n’est qu’un vœu pieux. Ainsi, en 1917, Lénine affirme :
« Une des tâches les plus importantes de notre temps, sinon la plus importante, consiste à stimuler aussi largement que possible cette initiative spontanée des ouvriers, de tous les travailleurs et exploités en général, dans leur labeur fécond d’organisation. Il faut détruire à tout prix ce vieux préjugé absurde, barbare, infâme et odieux, selon lequel seules les prétendues « classes supérieures », seuls les riches ou ceux qui sont passés par l’école des classes riches, peuvent administrer l’État, organiser l’édification de la société socialiste.
C’est là un préjugé. Il est entretenu par une routine pourrie, par l’encroûtement, par l’habitude de l’esclave, et plus encore par la cupidité sordide des capitalistes, qui ont intérêt à administrer en pillant et à piller en administrant. Non, les ouvriers n’oublieront pas un seul instant qu’ils ont besoin de la force du savoir. Le zèle extraordinaire qu’ils mettent à s’instruire, surtout aujourd’hui, atteste qu’à cet égard il n’y a pas, il ne peut y avoir d’erreur au sein du prolétariat.
Mais pour ce qui est du travail d’organisation, il est à la portée du commun des ouvriers et des paysans, pourvu qu’ils sachent lire et écrire, qu’ils connaissent les hommes et soient munis d’une expérience pratique. Parmi la « plèbe », dont les intellectuels bourgeois parlent avec hauteur et mépris, ces hommes sont légion. Au sein de la classe ouvrière et de la paysannerie, ces talents constituent une source intarissable et encore intacte. Les ouvriers et les paysans sont encore « timides ». Ils ne se sont pas encore faits à l’idée qu’aujourd’hui ce sont eux la classe dominante ; ils ne sont pas encore assez résolus.
La révolution ne pouvait pas susciter d’emblée ces qualités chez des millions et des millions d’hommes que la faim et la misère avaient contraints toute leur vie durant à travailler sous la trique. Mais la force, la vitalité, l’invincibilité de la Révolution d’Octobre 1917 tiennent précisément au fait qu’elle éveille ces qualités, renverse toutes les vieilles barrières, rompt les liens vétustes, et engage les travailleurs dans la voie où ils créent eux-mêmes la vie nouvelle. »[28]
Gramsci semble faire écho à ce passage lorsqu’il affirme, dans des lignes que nous avons citées, que les subalternes ne peuvent accéder à un régime de conduite et de pensée véritablement actif qu’après avoir obtenu des victoires stratégiques et avoir basculé, au moins en partie, du côté des forces dominantes et dirigeantes. En tout cas, Lénine dit clairement que, sans un échange constant entre les forces intellectuelles des exploités et le processus révolutionnaire, celui-ci ne pourra que régresser vers les formes précédentes de la domination.
En ce qui concerne Trotsky, lorsqu’il se consacre aux problèmes de la vie quotidienne – par exemple le langage, les manières, les mœurs –, il semble se rapprocher des analyses micrologiques de Gramsci traquant l’efficacité « aliénante » des habitudes et des schémas passivement reçus dans les tréfonds de l’esprit des classes dominées :
« La grossièreté du langage – la grossièreté russe en particulier – est un héritage de l’esclavage, de l’humiliation, du mépris pour la dignité humaine, celle d’autrui, et la sienne propre. Il faudrait demander aux philologues, aux linguistes aux folkloristes si l’on trouve dans d’autres pays une grossièreté aussi débridée, aussi répugnante et aussi choquante que chez nous pour autant que je sache, on n’en trouve nulle part ailleurs. Dans les couches populaires, la grossièreté exprimait le désespoir, l’irritation, et avant tout une situation d’esclave sans espoir, sans issue. Mais cette même grossièreté dans les couches supérieures, dans la bouche d’un maître ou d’un intendant de domaine, était l’expression d’une supériorité de classe, d’un bon droit d’esclavagiste, inébranlable.
On dit que les proverbes sont l’expression de la sagesse populaire ; c’est aussi celle de l’ignorance, des préjugés et de l’esclavage. « Un gros mot s’oublie vite », dit un ancien proverbe russe, qui ne reflète pas seulement l’esclavage, mais aussi son acceptation passive. Deux types de grossièreté – celle des barines, des fonctionnaires, de la police, une grossièreté rassasiée, à la voix grasse, et une autre, affamée, désespérée – ont coloré la vie russe de leur teinte repoussante. Et la révolution en a hérité, comme de beaucoup d’autres choses.
Mais la révolution, c’est avant tout l’éveil de la personnalité humaine dans des couches qui autrefois n’en avaient aucune. Malgré toute la cruauté et la férocité sanglante de ses méthodes, la révolution est avant tout et surtout un éveil du sens de l’humain ; elle permet de progresser, de faire plus attention à sa dignité propre et à celle des autres, d’aider les gens faibles et sans défense. La révolution n’est pas, une révolution, si, de toutes ses forces et par tous les moyens, elle ne permet pas à la femme, doublement et triplement aliénée, de se développer personnellement et socialement. La révolution n’est pas une révolution si elle ne porte pas le plus grand intérêt aux enfants ; ils sont l’avenir au nom duquel elle s’effectue. »[29]
Le rôle central attribué au « réveil » des capacités intellectuelles, à l’accès à l’autonomie et à la liberté de l’esprit de la part des dominés, nourrit les espoirs, et parfois les illusions, des révolutionnaires bolcheviks. De même, la hantise de la passivité des « subalternes », de l’incapacité des acteurs de la révolution à assumer jusqu’au bout les tâches de la construction consciente d’une nouvelle civilisation, n’est pas que de Gramsci : elle est omniprésente et constante chez les révolutionnaires russes, avant et après Octobre.
Par-là, on pourrait interroger l’opposition entre le marxisme « européen » de Gramsci et celui des bolcheviks, lequel représenterait un marxisme adéquat à des pays arriérés et archaïques. Il ne fait aucun doute que la structure sociale russe était différente de celle des pays d’Europe occidentale en 1917 ; mais précisément cette structure et ses effets négatifs sur le processus révolutionnaire ont fait l’objet des préoccupations des bolcheviks, dont l’action n’est pas que le reflet passif de la situation russe, mais une tentative de la traiter et de la transformer.
Symétriquement, la passivité des subalternes, le poids « archaïque » de la domination reproduisant une minorité « naturalisée » est un problème qui, pour Gramsci, se pose aussi dans les pays « développées », au sein des sociétés civiles articulées, comme l’essor du fascisme en Europe le montre sans ambiguïté.
Conclusions
Si le parcours que nous avons proposé dans les textes et les réflexions de Gramsci est pertinent, on peut suggérer les conclusions suivantes. Gramsci n’est pas un penseur de la conquête du pouvoir par les idées, mais un penseur de la lutte contre le pouvoir que certaines idées exercent sur les acteurs (virtuels ou actuels) des processus révolutionnaires. Par conséquent, il est un penseur de la transformation des idées existantes en idées « justes ». Pour Gramsci, il n’y a pas de processus révolutionnaire sans sortie de l’état de minorité, et il n’y a pas de sortie de la minorité sans mise en jeu, et au travail, de la Vérité et du Savoir, sans transformation et invention de leurs manières d’instruire et de cliver les comportements humains.
En ce sens, il me semble – mais c’est sur ce point que le discours serait à rouvrir entièrement – que Gramsci ne peut être qualifié de communiste « démocratique » sans qualifier davantage l’adjectif. Si par « démocratie » on entend une pratique de l’action politique collective, indissociable de la remise en cause et de la modification incessante des hiérarchies et des distributions inégalitaires du pouvoir de décider et de proposer, alors il est assez clair que Gramsci, à l’instar de toute la tradition marxiste, n’estime pas qu’une telle pratique est toujours immédiatement possible. Il y a un primat des conditions de la pratique démocratique sur l’exercice de cette pratique, et ces conditions consistent dans la capacité à briser les structures, les rapports et les « idées » qui séparent les acteurs de l’appropriation de leur puissance d’agir et de penser.
Or cette rupture est un problème ouvert qui, s’il ne peut pas être considéré simplement comme chronologiquement antérieur à celui de la mobilisation et de l’invention de pratiques collectives, il n’en reste pas moins logiquement distinct de ce dernier. Quoi qu’il en soit, il est peut-être possible de conclure que ce qui rend Gramsci irréductible à la vision dominante aujourd’hui de ce que « politique » veut dire est l’idée que la seule politique « juste » consiste en une révolution qui touche l’homme dans ce qu’il a de plus profond.
*
Illustration : Graziano Origa / Wikimedia Commons.
Vous pouvez retrouver de nombreux articles sur Gramsci dans notre dossier qui lui est consacré.
Notes
[1] Nous signalons, parmi les contributions importantes, Jean-Claude Zancarini–Romain Descendre, L’œuvre-vie d’Antonio Gramsci, Paris, La Découverte, 2023 et Yohann Douet, L’Histoire et la question de la modernité chez Antonio Gramsci, Paris, Garnier, 2022. Plus ancien, André Tosel, Etudier Gramsci. Pour une critique continue de la révolution passive capitaliste, Paris, Kimé, 2016. La liste n’est pas exhaustive.
[2] Podcast de Le Book Club du 9 mai 2023, « Antonio Gramsci : penser la révolution ».
[3] « Antonio Gramsci (1891-1937). Marxiste à l’italienne ».
[4] Reportage de France Inter par Timur Ozturk, le 14 octobre 2021.
[5] Robert Maggiori, « Il faut sauver Antonio Gramsci de ses ennemis », in Libération du 9 août 2016.
[6] « « Tout le monde se dit gramscien mais personne ne sait de quoi il parle » », Entretien avec Romain Descendre et Jean-Claude Zancarini », in Le Vent se lève, 13 juin 2021.
[7] Ce discours, dont la référence à Gramsci n’est jamais absente, est toujours très fréquent dans les milieux de la droite italienne. Par exemple, dans cet article du philosophe Vittorio Mathieu s’inspirant de son confrère Augusto Del Noce (dont la critique de l’évolution néo-libérale du PCI reste toutefois à méditer) : « Après 1968, la mentalité communiste (d’autant plus qu’elle reste non explicite) s’insinue et s’installe dans la culture, depuis l’Université jusqu’aux écoles primaires […]. À travers ce processus, Gramsci voulait parvenir à un totalitarisme consensuel, avec un usage le moins important possible de la violence » (Il Giornale, 16 septembre 2004). Plus récemment, un article dans la revue Tempi affiche ces propos légèrement surréels (mais très répandus dans d’innombrables publications italiennes, marginales ou légitimes, savantes ou destinées au grand public) : « À l’école, c’est Gramsci qui a gagné (hélas). Les idées du fondateur du PCI sur l’hégémonie culturelle ont imprégné notre éducation au point de devenir pensée commune. Depuis Galilée jusqu’au gender » (Egisto Mercati, in Tempi, 17/09/2020). Une comparaison de ces propos avec les discours, d’une part, sur le complot révolutionnaire judéo-maçonnique et, d’autre part, sur la pénétration islamiste des institutions républicaines serait de toute évidence instructive.
[8] Raul Mordenti, Gramsci e la rivoluzione necessaria, Rome, Editori Riuniti, 2011, p. 8.
[9] Louis Althusser, Que faire ?, Paris, PUF, 2018, p. 107.
[10] Ibid., p. 96-97.
[11]Antonio Gramsci, Lettere dal carcere,édition dirigée par Sergio Caprioglio et Elsa Fubini, Turin, Einaudi, 1965, p. 615 [tous les passages de Gramsci sont traduits par moi-même A.C.].
[12] Antonio Gramsci, Quaderni del carcere, édition critique par Valentino Gerratana, Turin, Einaudi, 1975, p. 1379.
[13] Ibid., p. 1331.
[14] Ibid., pp. 1375-1376.
[15] Ibid., p. 1396.
[16] Ibid., p. 1380 sq.
[17] Ibid., p. 2283-2284.
[18] Ibid., p. 2284.
[19] Ibid., p. 1505.
[20] Jean-Marie Vincent, Max Weber ou la démocratie inachevée, Paris, Le Félin, 1998, pp. 166-167.
[21] La compréhension et l’analyse de ces effets sera l’enjeu théorique et politique des Quaderni rossi en Italie à la fin des années 1950, lesquels vont rompre avec la référence gramscienne explicite et s’approprier les analyses de la réification développées en 1923 par Lukács.
[22] Jean-Marie Vincent, Max Weber…, op. cit., p. 167.
[23] Antonio Gramsci, Quaderni…, op. cit., p. 1381.
[24]Antonio Gramsci, « Le Parti communiste », in Cahiers du GRM, n° 18, 2021, Accès par OpenEdition.
[25] Max Weber…, op. cit., p. 168.
[26] Antonio Gramsci, Quaderni…, op. cit., p. 886.
[27] Jean-Claude Zancarini, « L’union de la ville et de la campagne. Machiavel et les jacobins », in Romain Descendre et Jean-Claude Zancarini (dir.), La France d’Antonio Gramsci, Lyon, ENS éditions, Accès par OpenEdition, 2021.
[28] Vladimir Lénine, « Comment organiser l’émulation ? » (1917), in Œuvres, t. 26, Paris-Moscou.
[29] Léon Trotsky, Les questions du mode vie (1923), p. 43.

![Gramsci, penseur de l’hégémonie [Podcast]](https://www.contretemps.eu/wp-content/uploads/Gramisci-150x150.jpg)