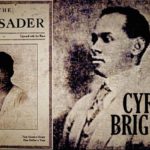Le socialisme américain face à la question raciale : entretien avec Paul Heideman
Paul Heideman est doctorant en sociologie à l’université de New-York et un contributeur régulier de Jacobin et de l’International Socialist Review. Docteur en études américaines de l’université Rutgers-Newark, il a beaucoup écrit sur la race et l’histoire de la gauche américaine. Il vient notamment de publier Class Struggle and the Color Line (Haymarket Books, 2018). En juin 2014, il a donné une conférence sur ces questions, organisée par la revue Période, à l’EHESS, que l’on peut écouter ici.
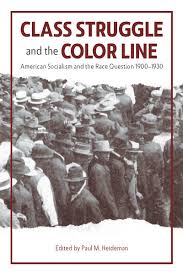
Dans le livre que tu as coordonné, Class Struggle and the Color Line, il a été décidé de se concentrer sur une période comprise entre 1900 et 1930. Pourquoi avoir fait le choix d’analyser cette période en particulier ?
Il y a plusieurs raisons pour lesquelles je pense que cette période est très importante. Premièrement, il s’agit de la période pendant laquelle le socialisme aux États-Unis est passé d’un mouvement marginal, isolé aux périphéries de la société américaine, à un mouvement de masse gagnant la confiance de centaines de milliers d’ouvriers. Cette période représente ainsi le premier moment où ce que les socialistes américains pensaient de la race pouvait avoir de réelles conséquences pour la lutte des classes. Elle représente également le début de la continuité organisationnelle de la gauche américaine. Des figures telles que Jay Lovestone et James P. Cannon allaient passer du Parti Socialiste au Parti Communiste puis à des groupes d’opposition communistes, emmenant avec eux des idées et expériences de chaque organisation. L’histoire du socialisme américain d’une grande partie du 20e siècle a été substantiellement façonnée par les personnes pour qui ces années ont été celles de leur formation politique.
Deuxièmement, c’est la période de l’histoire socialiste américaine qui est souvent reléguée à la préhistoire du socialisme et de la race. Pendant longtemps, on a tenu pour acquis que les socialistes américains n’ont pas apporté de contributions de valeur à la pensée sur la race avant 1930. Il existe certains livres classiques sur le communisme américain et la libération noire pendant la Grande Dépression — Communists in Harlem During the Depression de Mark Naison et Hammer and Hoe de Robin Kelley — mais, comparativement, beaucoup moins d’attention a été prêtée aux décennies précédentes. Au lieu de cela, le Parti Socialiste en particulier est souvent rejeté, accusé d’ignorer la race dans son ensemble ou d’avoir une approche colorblind, ce qui revenait au même. Je voulais montrer que l’expérience du socialisme américain était bien plus riche que cela, et que l’organisation brillante rapportée dans des livres comme ceux de Naison et Kelley plonge ses racines dans des dizaines d’années de débats menés par les socialistes américains sur la manière d’appréhender la question raciale.
L’une des phrases les plus connues lorsque l’on traite du socialisme étasunien et de la question de la race est probablement celle du grand dirigeant socialiste Eugene V. Debs, « Nous n’avons rien de spécifique à offrir aux noirs », publiée en 1913 dans l’International Socialist Review. Toutefois, tu écris que la perception qu’avait Debs de cette question est plus complexe qu’il n’y paraît. Pourrais-tu expliquer pourquoi ?
La citation de Debs est souvent utilisée pour représenter l’ensemble de la pensée du socialisme américain sur la race. Comme le montrent les documents de Debs, cette phrase n’est même pas une très bonne représentation de sa pensée sur la question. Debs était un militant qui s’opposait au racisme. Il décrivait le socialisme comme « le grand mouvement de destruction de l’esclavage » (à une époque où l’esclavage était encore bien ancré dans la mémoire de millions de personnes).
De plus, il s’opposait sans relâche aux tentatives, qui avaient cours au sein du PS, d’adaptation du parti au racisme américain. Lorsqu’un socialiste s’est montré en désaccord avec son antiracisme dans une lettre à l’International Socialist Review, Debs a répondu dédaigneusement en déclarant qu’un parti adhérant à la ligne de couleur « renonçait à sa propre vie, et serait bientôt méprisé et déserté comme une chose impropre, ne laissant qu’un relent aux narines des gens honnêtes. » Dans les débats sur l’immigration, alors que de larges pans du parti étaient en faveur de la restriction de l’immigration depuis la Chine, Debs attaquait les soutiens de cette restriction comme des traîtres à l’héritage historique du socialisme.
Il est vrai que Debs n’a pas suffisamment lutté en faveur de cette position (ou pour n’importe laquelle de ses positions !) au sein du parti. Mais il s’agit là d’une autre question. La richesse de sa propre pensée sur la question raciale ne peut être réduite à cette citation. La richesse et la diversité du débat au sein du PS ne peut clairement pas se résumer à celle-ci. 
Ton livre est structuré en cinq parties : le parti socialiste, l’IWW, le Messenger, le Crusader et le Parti Communiste. Pourquoi avoir choisi d’inclure des journaux, comme le Messenger ou le Crusader ?
D’une part, les écrits de ces journaux ne sont pas aussi connus qu’ils le devraient. Bien qu’aucun de ces deux journaux ne soit vraiment obscur, chacun est généralement traité comme une simple composante, respectivement du Parti Socialiste et du Parti Communiste. Je voulais donner une idée de l’originalité des écrits publiés dans ces journaux, et du fait qu’aucun des deux ne peut être réduit au contexte organisationnel dans lequel ils étaient produits. Ces journaux étaient également les deux projets intellectuels les plus soutenus du marxisme noir américain de cette période. Ils ont bâti les fondations, chacun à leur manière, de ce que de futurs marxistes noirs tels que George Padmore et CLR James allaient développer par la suite au sein d’œuvres plus conséquentes.
Le Messenger était édité par deux jeunes membres du Parti Socialiste A. Philip Randolph et Chandler Owen, qui avaient migré du sud et qui se sont vite bâtis, grâce à leur journal, une réputation de pugnacité et de radicalisme. Ils soutenaient l’IWW, critiquaient le racisme et le conservatisme de l’AFL, soutenaient l’autodéfense armée contre la violence des suprémacistes blancs et soutenaient les bolchéviques en Russie. Ce type de formation politique au sein du PS se trouvant totalement effacée par la citation de Debs sur le « rien à offrir », je souhaitais donc une section conséquente sur le Messenger afin de restaurer cet héritage radical.
Le Crusader était publié par Cyril Briggs, un immigré caribéen qui avait commencé comme nationaliste noir avant de rapidement devenir également un radical de la lutte des classes. Briggs était intéressant pour toutes les manières novatrices dont il combinait le radicalisme noir et le socialisme. Il soutenait, par exemple, l’émigration noire vers l’Afrique, mais affirmait que le but de celle-ci était de faire tomber le colonialisme et de bâtir le socialisme en Afrique. Il s’agissait là d’une vision très différente de celle de personnalités telles que Marcus Garvey, qui soutenait également l’émigration, mais pensait que les noirs américains devaient aller en Afrique pour civiliser les Africains.
Dans le texte d’introduction des éditoriaux du Messenger, tu écris que « bien que certains chercheurs aient marqué le Messenger du sceau du radicalisme de ‘’la classe d’abord’’, à cause de l’allégeance au Parti Socialiste et de son opposition au nationalisme noir, une telle description fausse dramatiquement le contenu politique de la revue ». Pourrais-tu revenir sur la perception qu’avait ce journal du racisme, mais également sur l’importance que la Révolution russe d’octobre 1917 avait pour le Messenger ?
Le Messenger faisait de la propagande en faveur de l’autodéfense armée contre le lynchage. Il appelait à une grève générale dans le sud contre le lynchage. Il s’attaquait au racisme au sein du mouvement ouvrier. Décrire tout ceci comme un radicalisme de « la classe avant tout » est un abus de langage, mais c’est pourtant une description encore trop courante dans l’historiographie. Il est vrai que la théorisation explicite du journal sur la race réduisait souvent les choses à la classe, mais cela ne faisait que prouver qu’il n’y avait pas de simple concordance entre la théorie et la pratique.
Certains des écrits les plus intéressants du Messenger concernent la Révolution russe, que la revue soutenait sans réserve et suivait attentivement. Pour le Messenger, la Révolution russe était un exemple qui devait inspirer les noirs américains. Voyant le sort des Juifs russes, une oppression à laquelle les noirs américains s’identifiaient, les contributeurs du Messenger en concluaient que si les Juifs avaient pu passer des pogroms à des sièges importants au gouvernement (tenus par des bolchéviques tels que Léon Trotsky), alors une révolution socialiste aux États-Unis pouvait faire de même pour le peuple noir ici.

Dans quelle mesure l’influence des Caribéens noirs a-t-elle joué un rôle dans la lutte contre le racisme au sein de la gauche étasunienne ?
Les immigrés caribéens ont fourni nombre des cadres noirs durant cette période de l’histoire socialiste. Winston James, dans son excellent livre Holding Aloft the Banner of Ethiopia, développe magnifiquement bien la façon dont cela s’est produit. Une partie importante de ce processus résidait dans les systèmes raciaux, qui étaient souvent plus lâches dans la Caraïbe, avec des gradations entre « noir » et « blanc ». Cependant, aux États-Unis, la « règle de la goutte de sang » déterminait la race : vous étiez soit noir ou blanc, en haut ou en bas. Ainsi, de nombreux caribéens noirs ont fait l’expérience d’une sorte de « rétrogradation raciale » en arrivant aux États-Unis, faisant l’expérience du système racial étasunien sans avoir été préparés socialement à accepter que celui-ci soit insurmontable. De la même manière, ils n’avaient pas passé leurs vies entières à apprendre ce que Richard Wright allait, plus tard, appeler « l’éthique de vie de Jim Crow ». Ils s’opposaient donc au système avec ce que les noirs nés aux États-Unis percevaient comme une franchise suicidaire.
La prédominance d’immigrés caribéens au sein de la gauche noire durant cette période était tellement connue qu’un officiel de la NAACP a fait une blague selon laquelle « un radical noir est un Antillais suréduqué sans travail ». C’était, bien évidemment, exagéré, mais les exemples d’Hubert Harrison, Cyril Briggs, W.A. Domingo et Claude McKay montrent que cette formule reposait tout de même sur quelque chose de réel.
Dans les documents sur l’IWW, publiés dans le livre, y compris dans le texte de Ben Fletcher « The Negro and Organized Labor », l’opposition à l’American Federation of Labor (AFL) semble être un point important. Pourrais-tu revenir sur les différences entre l’IWW et l’AFL sur la question du racisme ? Pourrais-tu également développer les différences entre la propagande de l’IWW contre le racisme et sa pratique ?
L’AFL, née à la fin du 19e siècle, était la principale organisation pour les ouvriers américains durant toute la période couverte par le livre. En comparaison à des mouvements syndicaux dans une grande partie de l’Europe, l’AFL était assez conservatrice. Sa vision du syndicalisme se basait sur l’organisation collective des ouvriers qualifiés afin de conserver leurs faibles qualifications, et ainsi garder le prix de ces qualifications élevées.
Il n’y a jamais eu réellement d’intérêt pour l’organisation de la vaste masse d’ouvriers non-qualifiés. Cette attitude coïncidait, bien sûr, assez facilement avec le racisme de nombreux travailleurs blancs américains, qui voyaient les noirs comme des concurrents particulièrement dangereux sur le marché du travail. En résultait un mouvement syndical d’où l’exclusion des travailleurs noirs était assez commune, et où la ségrégation entre habitants était, bien souvent, le meilleur scénario possible. Bien sûr, sur le long terme, cela a tout simplement engendré le fait que de nombreux Américains noirs ont grandi en détestant les syndicats et étaient tout à fait satisfaits de faire le travail de briseurs de grève, comme cela est arrivé durant la grande grève de la métallurgie en 1919.
Entre-temps, l’IWW était apparu en tant que syndicat radical, fondé en 1905 par des syndicalistes qui n’étaient pas satisfaits de l’AFL. Dès le début, l’IWW s’est engagé pour l’égalitarisme racial au sein du mouvement ouvrier. Il a, par exemple, organisé les charpentiers noirs et blancs ensemble dans le sud, malgré la violence suprémaciste blanche.
Toutefois, ce qui est réellement fascinant concernant l’IWW durant ces années-là est que si vous vous contentez de lire leur propagande, vous pouvez penser qu’ils étaient très mauvais sur la race, en ce qu’ils suivaient une ligne réductionniste de classe assez simpliste. Ils affirmaient que les noirs américains n’avaient des problèmes que parce qu’ils étaient pauvres, non pas parce qu’ils étaient noirs ; que la guerre de Sécession n’était qu’une lutte entre différentes parties de la classe dirigeante, que les ouvriers n’y avaient aucun intérêt, etc. C’est un chapitre intéressant de l’histoire, car il montre que l’on ne peut pas simplement réduire les actions d’un groupe à ses écrits. C’est plus complexe que cela.
La dernière partie de ton livre porte sur le Parti Communiste (CPUSA). Comment as-tu choisi les auteurs que tu as inclus dans cette partie ? Pourrais-tu revenir sur la thèse de la « ceinture noire » (Black Belt) ?
En ce qui concerne le CPUSA et la race, il existe un récit standard dans la littérature. Celle-ci dit que, durant la majeure partie de ses premières années, le parti ne prêtait pas réellement attention à la question raciale. Puis, en 1928, la thèse de la Black Belt est venue du Comintern. Il s’agissait d’une résolution affirmant que les comtés à majorité noire du sud des États-Unis constituaient une nation opprimée, dont le PC supporterait la lutte pour l’autodétermination. Cela aurait poussé le parti à finalement prendre en compte la race, et à poser les bases de leur organisation très impressionnante de l’antiracisme durant les années 1930 et 1940.
Ce que j’essaye de montrer dans la section sur le PC dans le livre, c’est que cette histoire est, pour l’essentiel, inexacte. Premièrement, le PC a hérité davantage qu’un réductionnisme colorblind du PS. Comme le montre le livre, des membres de l’aile gauche du PS, comme Louis Fraina, publiaient des textes très tranchants sur l’oppression raciale au milieu des années 1910. Ceux-ci allaient façonner la vision du PC sur cette question. Secondo, le vrai tournant du Comintern a eu lieu en 1922, avec le quatrième congrès et ses thèses sur la question noire. Ces thèses, inspirées en partie par les interventions de Claude McKay au congrès, sont ce qui a réellement poussé le parti américain à prêter une attention sérieuse à la race aux États-Unis. Le résultat a été immédiat. Si vous lisez la littérature du PC après 1922, vous pouvez trouver des textes très détaillés sur l’histoire et la politique noire. Il y a un texte de Robert Minor dans le livre qui analyse l’histoire des révoltes d’esclaves aux États-Unis, et qui affirme que les Américains noirs n’ont pas uniquement été les victimes du racisme, mais qu’ils ont toujours lutté contre celui-ci.
Il est vrai que l’organisation communiste durant ces années-là était en retard par rapport à ces innovations théoriques, mais le PC a échoué, à nouveau, dans presque toutes ses tentatives d’organisation au milieu des années 1920. Pendant cette période toutefois, des cadres noirs affirmaient que le parti devait allouer davantage de ressources à l’organisation des ouvriers noirs. Nombre des mêmes cadres défendant cette position, comme James Ford par exemple, s’étaient, dans un premier temps, opposés à la thèse de la Black Belt en 1928. Toutefois, comme il est rapidement apparu qu’aucune dissidence ne serait tolérée dans le PC totalement stalinisé, ils sont rentrés dans les rangs. Mais je pense que c’est distordre l’histoire que d’attribuer le succès du PC dans l’organisation contre le racisme durant les années 1930 à la thèse de la Black Belt, plutôt qu’aux communistes noirs qui plaidaient depuis des années pour que le parti s’améliore sur cette question.

Bien que le contexte soit extrêmement différent de celui auquel tu t’intéresses dans ce livre, penses-tu que les socialistes d’aujourd’hui puissent tirer des leçons de tous les débats sur le racisme du début du XXe siècle ?
Oui, absolument. Les différences de contexte sont, à l’évidence, immenses. Aux États-Unis, l’une des plus importantes différences est qu’il n’est plus controversé de défendre l’idée que l’antiracisme doit être au centre du radicalisme américain. Cela est en partie dû aux batailles menées par les communistes et les socialistes contre le racisme et en partie grâce au mouvement pour les droits civiques qui a défini une moralité publique sur la race, il n’est pas controversé à gauche de dire que a) le racisme est un problème important aux États-Unis et b) lutter contre celui-ci devrait-être une préoccupation principale de la gauche.
Aujourd’hui, de jeunes blancs qui se radicalisent le deviennent principalement en raison du racisme débridé dans le pays. Le contexte à gauche est donc entièrement différent. Bien qu’il y ait certaines formations, à gauche, qui aient une perspective économique réductionniste, l’effet principal de celle-ci va être de s’isoler des couches radicalisées plutôt que de réellement gagner un large consensus autour de cette perspective.
Bien évidemment, la structure du racisme américain a également énormément changé. Aujourd’hui, le racisme ne se maintient plus par les lois Jim Crow qui ciblaient spécifiquement les Américains noirs. Il se reproduit plutôt via les institutions comme le marché du travail, du logement et, bien sûr, le système carcéral.
Pour revenir au livre, ce que le PS et le PC ont le mieux compris est que, afin de vraiment lutter contre le racisme aux États-Unis, il faut également s’attaquer au capitalisme américain, car c’est ce qui, en fin de compte, se cache derrière le racisme. C’est encore plus vrai aujourd’hui. Alors que la colère contre le racisme est assez largement répandue aux États-Unis, on admet beaucoup moins le fait que s’attaquer au racisme nécessite de s’attaque aux structures premières du pouvoir dans la société américaine – les employeurs, les banques, l’industrie immobilière, etc. S’emparer de ces structures de pouvoir et les amener à un certain degré de contrôle démocratique est, bien évidemment, la tâche du mouvement socialiste. Ainsi, les réflexions les plus intéressantes produites par le PS et le PC il y a un siècle sont encore d’une grande pertinence aujourd’hui. Tout le problème consiste à appliquer ces réflexions aux configurations spécifiques du pouvoir et de la domination auxquelles on a affaire aujourd’hui.
Entretien réalisé par Selim Nadi. Traduit de l’anglais par Sophie Coudray et Selim Nadi.