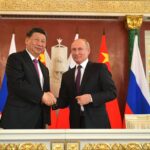Un capitalisme global pacifié ? À propos du livre de Leo Panitch et Sam Gindin
Christakis Georgiou présente pour Contretemps une analyse de l’ouvrage The Making of Global Capitalism : The Political Economy of American Empire de Leo Panitch et Sam Gindin (Verso, 2012), l’une des contributions majeures du matérialisme historique académique anglo-saxon des dernières années. L’une des thèses de l’ouvrage tient dans le maintien de la position dominante des Etats-Unis dans le système interétatique et dans sa capacité à façonner le capitalisme mondial.
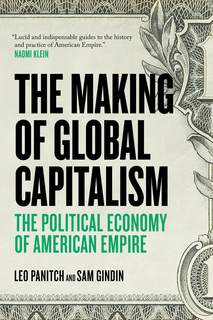
L’un des événements éditoriaux marquants dans le monde de la gauche radicale intellectuelle anglophone ces dernières années a sans conteste été la publication de l’ouvrage de Leo Panitch et Sam Gindin The Making of Global Capitalism : The Political Economy of American Empire en 2012. Par bien des aspects, cet ouvrage mériterait d’être lu et discuté largement en France. Il participe d’un riche débat entre marxistes contemporains sur la nature, l’évolution et les perspectives du système international et se situe dans la même catégorie que des ouvrages tels que Empire de Michael Hardt et Antonio Negri1, The New Imperialism de David Harvey2, Global Rivalries de Kees van der Pijl3, Adam Smith in Beijing de Giovanni Arrighi4, et Imperialism and Global Political Economy d’Alex Callinicos5. L’ensemble de ces ouvrages constituent des tentatives contemporaines (en ce sens qu’ils ont été publiés une fois que la poussière produite par la chute du stalinisme est retombée) par des auteurs renommés d’analyser l’évolution du système interétatique (de l’impérialisme si l’on préfère) dans une perspective de long-terme
L’ouvrage de Leo Panitch et Sam Gindin correspond à ces critères. Panitch est depuis 1985 le responsable de publication de la revue annuelle Socialist Register6, l’une des références anglophones de la nouvelle gauche intellectuelle ayant émergé dans les années soixante, mais aussi professeur d’économie politique comparative à la York University de Toronto au Canada. Gindin a été entre 1974 et 2000 le directeur de la recherche de la Canadian Auto Workers Union (le syndicat canadien des travailleurs de l’automobile) puis par la suite professeur à la même université. The Making of Global Capitalism est le fruit de plus de dix ans de recherches collaboratives entre les deux auteurs, dont les résultats ont régulièrement été publiés sous forme d’articles et ont alimenté le débat anglophone sur le système interétatique.
Comme la lecture des très nombreuses notes accompagnant le texte en témoigne, il s’appuie sur une quantité impressionnante de recherches, puisant à la fois dans la littérature marxiste actuelle et passée, la littérature institutionnaliste et historique relevant des disciplines académiques des relations internationales et de l’économie politique mais aussi dans des publications officielles et des archives gouvernementales américaines. L’attribution du Deutscher Memorial Prize en 20137 est venue souligner la réception dans l’ensemble extrêmement favorable de l’ouvrage dans le monde de la gauche radicale intellectuelle anglophone.
Le cadre théorique de l’ouvrage
La principale caractéristique de l’approche déployée dans l’ouvrage par Panitch et Gindin, et la principale force de leur travail, est leur volonté de produire un matérialisme historique historiciste et institutionnaliste. « [Les économistes politiques marxistes] se sont souvent heurtés à la propension du marxisme à analyser la trajectoire du capitalisme comme un produit dérivé de lois économiques abstraites. Les catégories conceptuelles que Marx développa pour définir les relations structurelles et la dynamique économique propres au capitalisme peuvent être extrêmement précieuses, mais seulement si elles instruisent une compréhension des choix faits, et des institutions particulières créées, par des acteurs historiques particuliers »8. Par conséquent, « aboutir à un meilleur matérialisme historique […] commence par une meilleure théorisation des dimensions institutionnelles de la concurrence, des classes et des États capitalistes »9.
Cette volonté est très probablement le produit d’une confrontation sérieuse et fructueuse avec la tradition et les auteurs de l’économie politique institutionnaliste, le courant qui domine les études en relations internationales économiques et en économie politique comparative en Amérique du Nord10. Les références bibliographiques mobilisées par les auteurs indiquent cela de façon très claire. Dans tous les cas, le résultat concret de cette volonté dans l’ouvrage est une attention très méticuleuse portée aux évolutions institutionnelles – notamment la constitution et l’évolution de ce que les auteurs appellent « capacités étatiques » – de cet empire américain qui aurait construit le « capitalisme global » dans lequel nous vivrions aujourd’hui.
Par conséquent, l’ouvrage est aussi une histoire du développement de l’appareil étatique américain et de la façon dont ce développement a été conditionné par le fait que les États-Unis sont devenus à partir de la Seconde Guerre mondiale la puissance dépositaire de la responsabilité de construire le « capitalisme global », c’est-à-dire d’éliminer progressivement les barrières à la circulation des marchandises et des capitaux par delà les frontières. Cette idée que l’État américain assure la reproduction du système capitaliste à l’échelle internationale, et non seulement sur le plan domestique, est condensée dans le concept de l’« internationalisation de l’État » qui revient sans cesse dans le texte.
Le biais institutionnaliste du cadre théorique mobilisé par Panitch et Gindin s’avère très fécond. Panitch et Gindin sont très sensibles aux rapports de forces internes à l’appareil étatique, rejetant à juste titre l’idée de l’unicité de l’État11. Les auteurs avancent, par exemple, à l’idée que ce fut l’insuffisance des « capacités étatiques » américaines durant l’entre-deux-guerres, et non pas, comme le prétendent les théoriciens de la « stabilité hégémonique », le poids de l’isolationnisme dans l’opinion publique américaine et au sein du Congrès12, qui empêcha les États-Unis d’agir en force stabilisatrice pour le système interétatique et ainsi de prévenir la spirale dépressive des années trente, l’effondrement de la coopération entre puissances capitalistes et l’enlisement vers la guerre.
Ils montrent aussi comment la doctrine et le rôle joué par le Federal Reserve System en tant que prêteur de dernier ressort aux banques « too big to fail » ont été progressivement mis au point au sein de l’appareil étatique américain en réponse aux problèmes concrets générés par le fonctionnement du système financier américain13, et comment à partir de la crise boursière de 1987 on a mis en place la « doctrine financière Powell » et celle de la « failure containment » (« endiguement des défaillances ») pour gérer les crises de liquidité survenues périodiquement sur les marchés financiers.
La première s’inspire de la doctrine militaire mise en œuvre durant la première guerre du Golfe (durant laquelle Colin Powell était le chef d’état-major des armées américaines) selon laquelle il fallait déployer une force écrasante pour vaincre l’adversaire en quelques jours ; dans le domaine financier, elle renvoie à l’idée qu’en cas de crise de liquidité, la banque centrale doit mettre à disposition des banques des liquidités à très grand volume pour arrêter la panique (une pratique largement déployée ces dernières années). La deuxième s’inspire aussi d’une doctrine militaire, celle prononcée pour la première fois par le président Harry Truman en 1947 à l’égard de l’Union Soviétique ; elle renvoie à l’idée que les crises de liquidité sont inévitables et que donc le rôle des politiques publiques n’est pas de les empêcher mais d’éviter qu’elles précipitent le système dans le gouffre. Enfin,
Le biais institutionnaliste explique également un deuxième paramètre du cadre théorique de l’ouvrage. Panitch et Gindin rejettent la distinction ontologique courante entre État et marché. Au contraire, ils affirment que ces deux ensembles de rapports sociaux sont mutuellement constitutifs l’un de l’autre. Ainsi, et c’est une autre grande qualité de cet ouvrage, ils produisent une histoire de la construction du « capitalisme global » dans laquelle durant la phase « néo-libérale » il n’y a pas recul ou retrait de l’État et affirmation du marché mais une restructuration profonde des rapports entre les deux, qui souvent implique la multiplication des règles encadrant le fonctionnement de l’activité marchande (l’essor, notamment, des règles prudentielles en matière financière).
Cette idée s’appuie sur l’analyse sous-jacente selon laquelle le projet de construction du « capitalisme global » a été mis au point durant la Seconde Guerre mondiale et que par conséquent la politique internationale américaine est caractérisée davantage par la linéarité de son évolution que par une rupture entre la phase « keynésienne » et celle « néo-libérale » censée être survenue durant les années soixante-dix (une autre idée que je plébiscite, même si Panitch et Gindin ne vont pas au bout de leur logique, ce qui consisterait à rejeter la pertinence analytique de ces termes14).
Le dernier élément du cadre théorique de l’ouvrage, et le moins convaincant, est une théorie de l’État, selon laquelle celui-ci jouit d’une « autonomie relative » à l’égard du capital, mais qui est contrainte par sa dépendance sur le succès de l’accumulation du capital pour lui assurer des recettes fiscales15. L’État est chargé de la reproduction sans heurt de l’ordre social capitaliste et se distancie des intérêts particuliers de tel ou tel capital. Par extrapolation, cette fonction se reproduit dans le domaine international dès lors que des « capacités étatiques » capables de permettre la projection internationale de l’État sont en place. D’où l’idée que l’« internationalisation de l’État » implique l’endossement par l’administration fédérale et ses diverses agences de la responsabilité de la reproduction du système capitaliste international.
L’analyse de Panitch et Gindin
L’analyse développée par les deux auteurs à partir de ce cadre théorique les situe quelque part entre les deux extrémités du spectre des positions que l’on peut retrouver dans les ouvrages susmentionnés. Panitch et Gindin rejettent l’ensemble d’analyses que l’on pourrait qualifier de « transnationalistes » et dont les ouvrages de Hardt et Negri sont exemplaires, selon lesquelles le développement des activités économiques par delà les frontières a conduit à la dévitalisation des structures étatiques nationales en les subsumant à un empire capitaliste transnational dans lequel se reconnaissent toutes les classes capitalistes du monde qui, par conséquent, se fondent désormais en une « classe capitaliste transnationale »16.
En même temps, ils rejettent les analyses de ceux qui cherchent à se situer dans la continuité des analyses « classiques » de l’impérialisme en voyant dans la persistance d’une pluralité de puissances dans le système étatique la source structurelle de « rivalités inter-impérialistes », chaque État poursuivant les intérêts de sa propre classe capitaliste par opposition à ceux des classes capitalistes dominant les autres États du système17.
Pour Panitch et Gindin, nous vivons depuis la Seconde Guerre mondiale dans un monde assimilable à un empire informel (car non colonialiste mais fondé sur l’égalité juridique entre souverainetés étatiques) américain où les États-Unis disposent d’une suprématie incontestée qui leur permet d’agir en tant que garant de la stabilité et de la reproduction du système capitaliste mondial dans son ensemble. Ce système est, notamment, dépourvu de dynamique foncièrement antagonique entre les grands États capitalistes et par conséquent il n’existe aucun projet alternatif à l’empire informel américain porté par une bourgeoisie concurrente.
Ceci ne découle pas seulement de la prépondérance américaine mais constitue également une conséquence de l’interpénétration des capitaux issus des différentes puissances qui crée des intérêts communs aux classes capitalistes nationales (qui restent pourtant toujours distinctes les unes des autres). Le jeu interétatique n’est donc pas un « jeu à somme nulle », au contraire de ce que prétendent les théoriciens de l’école « réaliste » des relations internationales (et comme le prétendent, en revanche, les théoriciens de l’école « idéaliste » ou « libérale »)18.
La « construction du capitalisme global » renvoie au projet poursuivi, et réalisé, par les États-Unis consistant à défragmenter le marché mondial en éliminant les barrières à la circulation des marchandises et des capitaux par-delà les frontières étatiques. Ainsi,
« la plus importante nouveauté dans la relation entre le capitalisme et l’impérialisme que la Seconde Guerre mondiale a mise en marche fut que les réseaux et les liens institutionnels impériaux les plus denses, qui auparavant allaient du Nord au Sud entre des états impériaux et leurs colonies formelles ou informelles, reliaient désormais les États-Unis et les autres États capitalistes majeurs. La création de conditions stables pour l’accumulation mondialisée du capital […] a été mise en œuvre par l’empire informel américain, qui réussit à intégrer toutes les autres puissances capitalistes dans un système efficace de coordination sous sa houlette »19. Par conséquent, « la mondialisation promue par les États-Unis a largement éliminé l’intérêt et la capacité de chaque ‘bourgeoisie nationale’ à agir comme une force cohérente et capable éventuellement de défier l’empire informel »20.
Précisément parce que l’acteur ayant permis l’avènement de ce « capitalisme global » sont les États-Unis et que ceux-ci dominent le système capitaliste à l’échelle internationale, ils sont également les principaux dépositaires de la responsabilité de la reproduction du système dans l’intérêt de toutes les classes capitalistes nationales. Les autres puissances capitalistes sont intégrées dans les dispositifs stratégiques et institutionnels dominés par les États-Unis et doivent eux aussi participer à l’effort et en partager la responsabilité. De fait, donc, l’analyse de la « construction du capitalisme global » devient l’analyse de la façon dont les États-Unis ont poursuivi cet objectif depuis leur émergence en tant que principale puissance étatique durant l’entre-deux-guerres (ce qui revient à minorer voire nier le rôle autonome joué par d’autres puissances – l’Europe, le Japon, la Russie ou la Chine).
C’est probablement aussi en partie pour cette raison que Panitch et Gindin font le choix explicite de négliger le rôle joué par le Pentagone et l’appareil militaire américain dans le développement et la reproduction de ce système au profit d’une analyse axée autour de ce qu’ils considèrent comme les centres cardinaux de l’empire informel américain, à savoir le Trésor et le Federal Reserve System. (Ils justifient ce choix également par référence aux analyses déjà nombreuses du militarisme américain.)
Mais la raison fondamentale pour laquelle ils mettent ces deux agences étatiques au cœur de leur analyse tient au fait que Panitch et Gindin considèrent que la centralité des marchés financiers américains dans le fonctionnement du système est la principale source du « pouvoir structurel » des États-Unis. Ces marchés captent une partie très importante de l’épargne mondiale et fournissent les étalons de référence pour le fonctionnement des marchés internationaux ainsi que la principale monnaie de réserve internationale. Le système financier mondial est organisé à partir et autour de la place de New York et l’actif financier pivot du système est le bon du Trésor américain.
La place centrale qu’occupe la finance américaine est fonction de la grande taille et donc de la liquidité des marchés financiers américains mais également du rôle prépondérant qu’y détiennent les marchés de titres au détriment du crédit bancaire21 et des capacités développées progressivement depuis les années trente par le Trésor et le Federal Reserve System pour gérer les crises de liquidité qui périodiquement déstabilisent le système. En effet, le fil analytique le plus résolument poursuivi à travers l’ensemble de l’ouvrage consiste à retracer la trajectoire historique par laquelle ce « pouvoir structurel » américain a été mis en place et solidifié, notamment à travers la construction de « capacités étatiques » pour encadrer et gérer le système financier américain dans un premier temps et le système financier mondial ensuite.
Ainsi, leur ouvrage est une histoire détaillée de la montée en puissance du Trésor et du Federal Reserve System et de l’évolution de l’infrastructure réglementaire financière américaine, mais aussi de la façon dont les institutions financières internationales créées en 1944 à Bretton Woods ont été conçues pour faciliter la projection internationale de ces « capacités étatiques » américaines. L’une des dimensions les plus importantes de l’histoire du système interétatique durant les vingt-cinq dernières années a donc été la capacité de l’administration fédérale à « marcher sur la corde raide consistant à encourager l’épanouissement de marchés financiers erratiques tout en gérant et endiguant les crises financières inévitables qu’ils généraient. La capacité à marcher sur ce fil durant pas moins de deux décennies après le krach de 1987 a, en fait, été un élément crucial de la capacité croissante de Wall Street à agir en tant que vortex aspirant du capital de partout dans le monde »22.
Cette analyse place Panitch et Gindin à l’une des deux extrémités du spectre des positions concernant la signification des « déficits jumeaux » américains (commercial et budgétaire), apparus durant les années quatre-vingt sous Reagan, résorbés sous Clinton, relancés par l’administration Bush et maintenus à des niveaux élevés par l’administration Obama. Ces déficits sont le reflet de la puissance américaine, et non pas de son déclin comme le prétendent les analyses « déclinistes » que l’on peut retrouver à gauche mais aussi chez des auteurs conservateurs23. Parce que New York et la dette publique américaine aspirent une partie si importante de l’épargne mondiale et que les États-Unis peuvent payer pour leurs importations avec leur propre monnaie, les déficits commerciaux n’ont plus d’importance ; c’est désormais la balance du capital et non pas des transactions courantes qui est déterminante pour le dollar24. Les auteurs voient dans le déroulement de la crise financière déclenchée par l’éclatement de la bulle immobilière américaine un démenti du « déclinisme ». « La crise a renforcé plutôt que sapé le rôle de l’empire américain »25. Le dollar a non seulement servi de valeur refuge durant ces dernières années à chaque fois que la fébrilité a regagné les investisseurs (y compris après la faillite de Lehman Brothers), mais la politique monétaire américaine a largement servi à stabiliser le système au delà des frontières de la juridiction américaine. « L’assouplissement quantitatif a essentiellement impliqué l’impression audacieuse de dollars américains, et a ainsi été dépendant de la volonté des investisseurs et banques centrales étrangers à continuer à détenir des dollars ; il a constitué le rappel le plus important jusqu’à ce jour de l’attractivité particulière et continue du dollar »26.
La finance américaine a, enfin, joué un autre rôle dans le maintien de la suprématie américaine. La crise des années soixante-dix a été bien réelle ; mais après avoir infligé une défaite cinglante au mouvement ouvrier, le capitalisme américain, sous l’impulsion de l’industrie financière, s’est revigoré. L’expansion des relations financières (la « financiarisation », notamment l’incorporation des travailleurs dans les réseaux financiers à travers le crédit immobilier et de consommation), la restructuration de l’industrie manufacturière (due à la vigueur des activités financières, notamment sur le marché des fusions et acquisitions), l’explosion des industries high-tech de la troisième révolution industrielle et du secteur des services aux entreprises « ont reconstitué la base matérielle de l’empire américain »27.
Forces et faiblesses du cadre théorique de l’ouvrage
L’ouvrage comporte donc beaucoup de points forts : le biais institutionnaliste et historiciste de l’analyse et l’attention portée au développement des « capacités étatiques » américaines ainsi que le rejet de la dichotomie État/marché ; la capacité à théoriser l’anticolonialisme impérial américain28; la reconnaissance que malgré les changements survenus depuis 1945 dans l’ordre interétatique (unification européenne, disparition de l’Union Soviétique, émergence de la Chine et de l’Inde et d’autres puissances secondaires) les États-Unis se maintiennent dans la position de l’unique puissance à capacité de projection globale ; le refus de reproduire le travers courant à gauche consistant à surestimer les contradictions du système et en particulier les difficultés que comporteraient les déficits jumeaux américains et la crise financière de 2008 pour les États-Unis. Malgré ces points forts, cependant, la charge analytique de l’ouvrage est mal avisée et repose sur des fondements contradictoires.
Avant d’en venir au paramètre empirique des faiblesses de l’analyse de Panitch et Gindin, il est nécessaire de regarder de plus près les prémisses théoriques de l’analyse.
La thèse centrale de l’ouvrage (l’avènement du « capitalisme global » sous la houlette des États-Unis condamne à l’obsolescence les rivalités interétatiques) repose principalement sur deux arguments distincts et d’inspiration contradictoire. Le premier est que l’asymétrie de pouvoir en faveur des États-Unis est telle qu’elle dissuade les autres puissances capitalistes de la tentation de défier l’ordre établi par ceux-ci et les conduit à se ranger derrière ceux-ci. Cet argument, malgré l’aversion des auteurs pour cette école de pensée, est typiquement « réaliste »29 et implique logiquement que la modification de la distribution du pouvoir effectif entre puissances capitalistes remettra en cause cet état de fait30. Le « capitalisme global » ne serait qu’un ordre interétatique historiquement donné et transitoire qui serait mécaniquement un jour supplanté par le jeu de la « loi du développement inégal ». On peut qualifier cet argument, par exemple avec des considérations institutionnalistes sur le développement de « capacités étatiques » permettant de combler l’écart entre puissance économique et pouvoir effectif, mais le fond de l’affaire ne change pas.
C’est pour cette raison que le deuxième argument de Panitch et Gindin est beaucoup plus en accord avec la logique d’ensemble des positions qu’ils défendent, en même temps qu’il est facilement reconnaissable par les théoriciens de l’école « libérale » ; l’interdépendance économique croissante entre les puissances capitalistes signifie que le jeu interétatique n’est pas « à somme nulle » et que donc toutes trouvent leur compte dans le système mis en place et supervisé par les États-Unis31. Le « réalisme » aurait donc engendré un système interétatique « libéral » (ou « idéaliste »), les institutions internationales ne seraient que des agences interétatiques chargées de la reproduction du système et à défaut d’un renversement du capitalisme lui-même par des forces sociales anti-capitalistes, cet ordre se reproduirait perpétuellement de façon stable32.
Le problème avec cet argument est qu’il identifie l’interdépendance économique à la coopération interétatique, alors que la réalité est qu’il ne s’agit que d’une des modalités de la concurrence entre capitaux et par extrapolation entre États. Ce problème est visible également dans le fait que Panitch et Gindin identifient le capitalisme au libre-échange : le « capitalisme global » serait réalisé puisque les barrières à la circulation internationale des marchandises et des capitaux auraient été définitivement abattues. Or, le libre-échange n’est qu’une des modalités du développement capitaliste et de la concurrence entre communautés nationales de capitaux ; le protectionnisme en est une autre parfaitement légitime, comme l’histoire économique américaine durant le dix-neuvième siècle le démontre clairement. La réalité sous-jacente commune à ces modalités est la concurrence internationale. A partir de là, le processus précis à travers lequel les activités économiques transfrontalières ont connu leur essor depuis les années cinquante obéit précisément à cette concurrence. Par conséquent, la réalité empirique de cette internationalisation économique ne correspond pas à la description qu’en font les auteurs dans l’ouvrage (j’y reviens plus bas).
Enfin, dernier problème sous-jacent ici, en disant que le jeu interétatique n’est pas « à somme nulle », les auteurs confondent accumulation élargie du capital/développement capitaliste et pouvoir. La prospérité matérielle n’est en effet pas « à somme nulle » ; que l’économie chinoise croisse n’implique pas que cela se fait au détriment de l’économie américaine. Mais le pouvoir, c’est-à-dire la capacité à dicter les règles et les comportements structurant la vie internationale, n’est par définition pas extensible ; si la Chine ou l’Europe acquièrent une influence croissante dans le système, cela se fait par définition au détriment de l’influence détenue par les États-Unis, ce qui leur donne la capacité de définir des règles plus favorables à leurs propres capitaux. La dotation financière du FMI peut, par exemple, s’accroître par des apports de nouvelles puissances, mais les droits de vote au sein de son conseil d’administration ne peuvent dépasser par définition les 100% ; si les droits de vote des nouvelles puissances augmentent ceux des puissances déjà en place doivent diminuer. C’est en ce sens que le concept de « déclin relatif » est opérant ; il n’implique pas un affaiblissement du capitalisme américain33 mais une influence moindre de l’administration fédérale dans le système interétatique. Encore une fois, cela se vérifie dans la réalité empirique de la distribution mouvante du pouvoir à l’échelle interétatique.
L’autre élément théorique problématique est la théorie de l’État et le lien entre celle-ci et l’obsolescence des rivalités interétatiques. Si le rôle de l’État capitaliste est d’assurer la reproduction de l’ordre social capitaliste en se différenciant des capitaux individuels – ce qui sur le plan international implique un État impérial prenant ses distances avec les intérêts particuliers de l’ensemble des capitaux américains – il n’y a aucune raison théorique pour expliquer la persistance de la pluralité d’États (que Panitch et Gindin ne nient justement pas) ; celle-ci ne relève que d’un constat empirique. Les auteurs reconnaissent que l’administration fédérale se préoccupe des intérêts nationaux américains, mais pour que cela soit en accord avec leur théorie, on devrait supposer que ce n’est qu’un reliquat de l’époque précédente qui devrait tendre à disparaître avec le temps. La conséquence en termes d’analyse empirique dans l’ouvrage est une sous-estimation des rivalités interétatiques, y compris militaires.
Les faiblesses de l’analyse de l’ouvrage34
Un premier travers qui découle des défauts décrits plus haut est la sous-estimation du rôle autonome des puissances secondaires dans le développement du système. Même si Panitch et Gindin admettent en passant, par exemple, que Jean Monnet avait ses propres motivations politiques35, ils n’en attribuent pas moins à l’administration fédérale le rôle de moteur principal dans le lancement du processus d’unification européenne dans les années cinquante. Ainsi, ils passent à côté du fait que l’unification européenne obéit à une logique de développement endogène et que si l’administration fédérale a pu exercer une influence importante à un certain (et très bref) moment historique, elle a rapidement perdu cette capacité36.
Ils répètent ainsi une erreur assez courante dans les débats entre marxistes concernant les deux guerres « mondiales » de la première moitié du vingtième siècle : celles-ci seraient le résultat de l’instabilité du système capitaliste générée par ses crises et la concurrence impérialiste pour des colonies (attribuable souvent et en partie dans cet ouvrage à des logiques pré-capitalistes de pouvoir), et non pas des tentatives allemandes, dans le cadre d’une longue guerre civile européenne, d’imposer par la force l’unification du continent afin de permettre à travers la constitution d’un marché domestique de taille continentale l’émergence de grandes firmes européennes exploitant pleinement les technologies de la seconde révolution industrielle – ce qui était déjà possible aux États-Unis grâce en partie à la victoire nordiste durant la guerre de sécession.
Tout autant, la partie asiatique de la Seconde Guerre mondiale découla de la tentative du Japon impérial d’élargir le marché domestique auquel ses industries auraient un accès exclusif37. De même, les auteurs ne prêtent guère attention au développement de « capacités étatiques » européennes qui permettent de transformer en pouvoir politique la puissance économique européenne, ce qui sans doute provient du refus d’envisager la possibilité de constitution de pôles alternatifs de pouvoir à Washington. Or, le processus de centralisation politique européenne est l’un des développements les plus importants affectant le système interétatique depuis quelques décennies, comme des membres éminents des élites américaines sont prêts à admettre38.
Par exemple, lorsqu’en janvier 2013, Philip Gordon, le secrétaire assistant aux affaires européennes du département d’État a prévenu le gouvernement britannique qu’il devait rester membre de l’UE, il a utilisé l’argument suivant : « Nous avons une relation croissante avec l’UE en tant qu’institution, qui a de plus en plus d’influence dans le monde, et nous voulons voir une influence britannique forte dans cette UE »39. Déjà dans les années soixante, Henry Kissinger, le célèbre secrétaire d’État « réaliste » de Nixon, contribuait à la réorientation de la politique américaine à l’égard de l’unification européenne en faisant observer que « nous avons cherché à combiner une Europe supranationale avec une Communauté Atlantique étroitement intégrée sous leadership américain. Ces objectifs s’avéreront probablement incompatibles […] Une Europe politiquement unie était davantage susceptible d’articuler ses propres conceptions en d’autres domaines [que les domaines monétaire et commercial] aussi »40.
Cette brève remarque à propos de l’Europe amène directement à la principale critique qui découle des considérations précédentes concernant le libre-échange, le protectionnisme et les modalités de la concurrence internationale. L’image générale qui se dégage de la lecture de The Making of Global Capitalism est celle d’une « mondialisation » triomphante ayant abattu toutes les barrières à la circulation des marchandises et des capitaux. Ainsi, « au tournant du millénaire, le ‘but ultime’ du libre-échange universel … était largement atteint »41. De même, il est très régulièrement question des « réseaux globaux de production intégrés »42 et des mouvements internationaux de capitaux traversant le globe sans contraintes ou concentrations géographiques. Cela, grâce à l’entremise impériale de l’administration fédérale qui aurait agi dans le but d’étendre les rapports sociaux capitalistes partout dans le monde. Or, la réalité concrète de la géographie économique contemporaine ne correspond pas à cette image et la raison en est que les moteurs de son développement ne se limitent pas, loin s’en faut, à l’entremise impériale américaine.
L’Europe est précisément l’exemple le plus visible à la fois du processus de régionalisation économique et de son pendant institutionnel, à savoir ce que l’on décrit en économie politique internationale institutionnaliste comme le « régionalisme ouvert »43. En effet, à la fois les échanges commerciaux, les réseaux intégrés de production et les transactions financières reproduisent un motif géographique de polarisation régionale dans le cadre de trois grands pôles de l’économie internationale : l’Amérique du Nord, l’Europe et l’Asie de l’Est. Cela se reflète dans la distribution géographique des opérations des firmes multinationales, que le spécialiste canadien de gestion internationale Alan Rugman dénomme les « multinationales régionales »44. De même, les réseaux de production opérés par ces firmes multinationales ne sont pas (sauf quelques cas exceptionnels comme celui de l’électronique grand public – précisément l’exemple choisi par les auteurs pour illustrer leur thèse45) intégrés à l’échelle globale mais à l’échelle régionale46.
Cette régionalisation économique s’appuie très souvent sur diverses formes d’institutions établies au niveau régional : l’UE et l’Espace Économique Européen en Europe, l’ALENA en Amérique du Nord et l’ASEAN ainsi que les divers accords bilatéraux autour du Japon en Asie de l’Est. Au sein de ces espaces, les obstacles (tarifaires ou pas) aux échanges et à l’investissement sont qualitativement bien moins importants qu’entre eux. Et depuis l’abandon par les États-Unis au début des années quatre-vingt du multilatéralisme comme principe devant régir la libéralisation des échanges (que Panitch et Gindin ne mentionnent pas)47, la libéralisation internationale des échanges et des investissements obéit à une dynamique désignée par le terme de « libéralisation compétitive »48 où les principales puissances économiques (les États-Unis et l’UE principalement, puis le Japon et de plus en plus la Chine) rivalisent pour obtenir l’accès à des marchés tiers à travers des accords bilatéraux de libre-échange et d’investissement, dans lesquels elles font miroiter l’accès à leur propre marché domestique de vaste taille aux petits États avec lesquels ils négocient. Récemment, cette dynamique a conduit les États-Unis à transposer cette stratégie dans leurs relations avec les autres grandes puissances commerciales : en menant simultanément des négociations bilatérales avec l’UE d’une part, les pays de l’APEC (Asia Pacific Economic Cooperation, dont la Chine est exclue) d’autre part, l’administration fédérale s’est fixée comme objectif clé de placer le capitalisme américain au point nodal du marché mondial en donnant libre accès aux multinationales américaines aux trois grandes régions économiques, alors que leurs concurrentes ne pourraient bénéficier que d’un accès similaire à deux de ces trois régions.
Ce processus ressemble à en crever l’œil à la politique de l’« Open Door », poursuivie officiellement par l’administration fédérale jusqu’aux années trente. Cette politique consistait à obtenir l’accès pour les grandes firmes américaines aux marchés étrangers, en troquant l’accès au vaste marché domestique américain ou en utilisant tout autre moyen diplomatique à la disposition de l’administration fédérale. Cette politique avait remplacé celle du protectionnisme tarifaire visant à soutenir le développement des « industries naissantes » américaines. Tout se passe aujourd’hui comme si les principales puissances économiques poursuivaient chacune de son côté sa propre politique de la « porte ouverte ». C’est l’interaction entre ces politiques distinctes, et motivées par la concurrence entre les puissances qui les poursuivent, qui pourrait un jour conduire au « but ultime du libre-échange universel »49.
La politique de la porte « ouverte » a inspiré dans les années soixante les travaux d’un célèbre historien critique de la politique étrangère américaine – William Appleman Williams – et dont les travaux ont récemment été redécouverts par des auteurs conservateurs mais critiques50. Panitch et Gindin rejettent la pertinence des travaux de cette école de pensée pour la période d’après Bretton Woods, justement parce que celle-ci voit dans la politique économique étrangère de l’administration fédérale la poursuite des intérêts des grandes firmes américaines en dehors de toute considération concernant la reproduction d’ensemble du système.
Si l’évolution du système économique international est déterminée par la dynamique de la « libéralisation compétitive » – à laquelle les États-Unis participent pleinement – c’est que le processus de régionalisation a éliminé l’avantage qualitatif dont disposait le capitalisme américain durant les années trente à soixante-dix, précisément la période durant laquelle le multilatéralisme était le principe central de la politique économique étrangère américaine. En permettant aux concurrents des États-Unis de disposer de marchés domestiques de taille équivalente au marché domestique américain, auxquels ils avaient un accès préférentiel, la régionalisation a permis la constitution de grandes firmes européennes, japonaises, asiatiques et récemment chinoises capables d’exploiter pleinement les économies d’échelle associées aux technologies de la seconde et, dans une moindre mesure, de la troisième révolution industrielles, et, par conséquent, de rattraper les grandes firmes américaines51.
C’est à partir du moment où ce rattrapage a commencé à se faire sentir durant les années soixante-dix que les États-Unis, ne craignant plus d’alimenter une dynamique (le régionalisme) qu’auparavant ils percevaient comme excluant leurs firmes de nombreux marchés tiers, ont changé de stratégie, non seulement sur le plan commercial, mais également sur le plan des politiques industrielles domestiques. Tout au long des années quatre-vingt, les partisans d’une politique industrielle volontariste visant à créer ou à renforcer des avantages comparatifs pour les grandes firmes américaines dans les industries de haute technologie de la troisième révolution industrielle se sont mobilisés, en mettant en avant entre autre le fait que les autres puissances avaient recours à de telles pratiques52.
La guerre commerciale opposant Boeing à Airbus est l’une des illustrations de ce sursaut mercantiliste américain. Au fil du temps, un « État développemental dissimulé »53 a été mis en place aux États-Unis, dont le point focal a été le budget militaire américain54 et d’autres projets publics de recherche. Le rôle du Pentagone n’est pas anodin : il indique l’influence de la concurrence militaro-stratégique sur les politiques économiques américaines et l’interdépendance entre ce type de concurrence et la concurrence économique entre grandes puissances.
La dynamique concurrentielle se décline dans d’autres domaines également. Sur le plan réglementaire, l’UE est devenue une puissance égale aux États-Unis55, notamment à travers le jeu de la centralisation politique sur Bruxelles. L’UE exerce ce pouvoir en grande partie à travers sa politique de la concurrence : les cas plus anciens de l’amende infligée à Microsoft par la Commission en 2003 ou de l’interdiction de la fusion entre General Electric et Honeywell en 2000 et celui en cours de la campagne contre Google56 en sont des illustrations significatives. Dans le cas des services financiers, Elliot Posner a montré comment la centralisation politico-réglementaire en Europe survenue dans le cadre du Plan d’Action pour les Services Financiers de 1999 a conduit à un rééquilibrage entre Washington et Bruxelles en matière de réglementation financière, allant jusqu’à l’imposition par l’UE en 2007 de ses préférences dans le cas des normes comptables internationales57.
Les différends avec l’Europe ne se limitent pas au domaine réglementaire ; dans celui des politiques macroéconomiques, un conflit entre les États-Unis et l’Allemagne (qui détient l’influence déterminante dans la formulation des politiques macroéconomiques dans la zone euro) dure depuis les années soixante-dix. L’administration fédérale reproche à l’Europe le biais déflationniste de ses politiques macroéconomiques (ce qui, essentiellement, est une attaque contre le mercantilisme allemand) alors que les gouvernements européens reprochent à l’administration fédérale de pratiquer régulièrement une politique du dollar faible pour éviter d’imposer un ajustement économique à la population américaine qui permettrait de résorber les déficits jumeaux américains, exploitant ainsi de façon « égoïste » le statut de principale monnaie de réserve internationale du dollar en exportant de l’inflation, ce qui oblige les gouvernements étrangers d’accumuler des réserves officielles libellées en dollars et les rend, ainsi, dépendants de la bonne tenue du cours du dollar.
En d’autres termes, le « pouvoir structurel » de la finance américaine et du dollar est une pomme de discorde importante. Les grands patrons européens qui se sont mobilisés durant les années quatre-vingt-dix en faveur de l’euro ont par ailleurs explicitement envisagé la création de celui-ci comme un instrument qui permettrait de rééquilibrer le rapport de force en matière macroéconomique. En mars 1991, Jean-René Fourtou, le PDG de Rhône-Poulenc de l’époque et membre du conseil d’administration de l’Association pour l’Union Monétaire en Europe (le lobby des grandes firmes européennes favorables à l’euro) expliquait par exemple que « la création de l'[euro] facilitera une plus grande convergence vers la stabilité monétaire internationale. Cela est dû au fait que la monnaie unique […] deviendra un concurrent attractif et puissant au dollar et au yen japonais. L’Europe parlera avec une voix unique en matière monétaire. Le rééquilibrage dans le système monétaire international qui en découlera nécessitera une plus grande coordination des politiques »58.
Tout récemment, une autre démonstration du caractère foncièrement antagonique des relations économiques interétatiques a été fournie par ce que le Financial Times a appelé « le défi lancé par Peking au monde de Bretton Woods »59. Le gouvernement chinois s’est en effet lancé dans la construction d’institutions financières internationales alternatives à celles créées à Bretton Woods, après avoir tenté en vain d’augmenter son influence au sein de celles-ci par une multiplication des droits de vote de ses représentants dans les conseils d’administration de ces institutions (ce qui est bloqué depuis 2010 par le refus du Sénat américain de ratifier une modeste augmentation des droits de vote chinois au sein du FMI).
Celles-ci comprennent une Nouvelle Banque du Développement (ou « banque des BRICs ») et un fonds de mutualisation des réserves officielles (en effet, des alternatives à la Banque Mondiale et au FMI), un Fonds de la Route de la Soie pour financer des projets d’infrastructure communs avec les pays du centre asiatique et une Banque Asiatique d’Investissement en Infrastructures (une alternative à la Banque Asiatique de Développement dominée par le Japon et les États-Unis). Cette stratégie permettrait au gouvernement chinois de commencer à exploiter ses réserves en dollars sans attendre que le statut du dollar de principale monnaie de réserve internationale soit remis en cause. Elle constitue une généralisation de l’approche poursuivie en Afrique depuis 2006 où Peking utilise ses vastes réserves pour s’assurer un accès privilégié et sécurisé à des matières premières, acheter de l’influence politique et détourner les États locaux des États-Unis et des anciennes puissances coloniales européennes. Surtout, il s’agit de la première tentative systématique de transformation de la puissance économique croissante de la Chine en pouvoir effectif au détriment des États-Unis, qui plus est en dehors du cadre institutionnel mis en place par ceux-ci.
Tout cela n’indique pas que l’Europe ou la Chine sont sur le point de lancer un défi global à l’ordre établi à la fin de la Seconde Guerre mondiale par les États-Unis. Sur ce point, l’analyse de Panitch et Gindin est correcte. Mais les auteurs ont tendance à assimiler les « rivalités inter-impérialistes » précisément à ce type de défi, alors que des relations antagoniques interétatiques peuvent exister sans y mener directement. Après tout, la transition de la Pax Britannica à la Pax Americana s’est faite durant une période d’un demi-siècle et, en dépit d’un nombre considérable de différends, ne donna lieu à aucun conflit ouvert entre les deux puissances. Justement, la stratégie de l’administration fédérale pour supplanter l’hégémonie britannique a reposé sur l’entrée tardive des États-Unis en guerre et l’alliance avec la Grande Bretagne (la puissance déclinante) contre l’Allemagne (l’autre puissance ascendante du moment), que les États-Unis ont utilisée pour accélérer le déclin britannique60.
En revanche, on peut déceler dans les relations interétatiques la persistance de rivalités entre grandes puissances et une tendance de fond vers l’affaiblissement de la position relative des États-Unis, à mesure que le processus d’unification européenne et celui de l’émergence chinoise (et dans une moindre mesure indienne, brésilienne et ainsi de suite) s’approfondissent. Pour que la puissance économique de l’Europe et de la Chine continue à se transformer en pouvoir effectif au détriment des États-Unis, une série de transformations institutionnelles doivent se matérialiser. La construction de « capacités étatiques » européennes, par exemple, a encore beaucoup de chemin à parcourir avant d’atteindre le même niveau d’efficacité et de centralisation qu’aux États-Unis.
Une analyse juste du développement du système interétatique tenterait de déchiffrer quelle est la répartition de la puissance économique entre les quelques pôles qui structurent le système et comment elle tend à évoluer, ainsi que comment cette répartition se matérialise en pouvoir effectif sur le système à travers la cristallisation institutionnelle de « capacités étatiques » (allant de la création de Trésors et de Banques Centrales à celle d’appareils militaires), et sur cette base déterminer quelle dynamique d’ensemble s’en dégage. L’ouvrage de Panitch et Gindin y contribue en faisant la démonstration de la valeur heuristique d’un travail fondé sur un tel biais institutionnaliste et en éclairant la partie du puzzle qui concerne la principale des puissances capitalistes de la période historique dans laquelle nous vivons. Mais dans le même temps, le cadre théorique adopté par les auteurs les conduit à proposer une analyse du fonctionnement du système en grande partie dénuée de ses fondements toujours composés de relations concurrentielles entre capitaux et de la manière dont ces relations nourrissent les relations toujours antagoniques entre États.
*
Nos contenus sont placés sous la licence Creative Commons (CC BY-NC-ND 3.0 FR). Toute parution peut être librement reprise et partagée à des fins non commerciales, à la condition de ne pas la modifier et de mentionner auteur·e(s) et URL d’origine activée.
Image en bandeau : bars and stripes (daliophoto)
à voir aussi
références
| ⇧1 | Michael Hardt and Antonio Negri Empire, Cambridge MA, Harvard University Press, 2000. |
|---|---|
| ⇧2 | David Harvey The New Imperialism, Oxford, Oxford University Press, 2003. Traduction française sous le titre Le Nouvel Impérialisme, Paris, Les Prairies Ordinaires, 2010. |
| ⇧3 | Kees van der Pijl Global Rivalries. From the Cold War to Iraq, London, Pluto Press, 2006. L’œuvre de van der Pijl est malheureusement inconnue en France, faute de traduction notamment. L’auteur est, pourtant, une référence incontournable parmi les spécialistes marxistes anglophones des relations internationales et de l’économie politique internationale ainsi que la figure centrale de l’école dite néogramscienne d’Amsterdam. |
| ⇧4 | Giovanni Arrighi Adam Smith in Beijing. Lineages of the Twenty-First Century, London, Verso, 2007. Traduction française sous le titre Adam Smith à Peking. Les promesses de la voie chinoise, Paris, Max Milo, 2009. |
| ⇧5 | Alex Callinicos Imperialism and Global Political Economy, Cambridge, Polity Press, 2009. J’en ai fait une recension pour Contretemps.web en 2010. https://www.contretemps.eu/interventions/etat-geopolitique-capitalisme-entamer-debat-sur-imperialisme-en-france |
| ⇧6 | http://socialistregister.com/index.php/srv/index#.VQ6VyI4YG24 |
| ⇧7 | Un entretien filmé avec les deux lauréats : http://www.deutscherprize.org.uk/wp/interviews-with-deutscher-prize-winners/ Je remercie Sam Gindin de m’avoir donné accès au texte écrit de la conférence prononcée par les deux lauréats pour le Deutscher Memorial Prize Lecture lors de la conférence annuelle organisée à Londres par la revue Historical Materialism en novembre 2014. |
| ⇧8 | The Making, p. 3. |
| ⇧9 | Deutscher Memorial Prize Lecture, p. 2. |
| ⇧10 | Cette tradition plonge ses racines dans le courant philosophique du pragmatisme. Pour une présentation de l’institutionnalisme en économie politique, voir Kees van der Pijl ‘Pragmatism and Institutionalism’, in A Survey of Global Political Economy, https://www.sussex.ac.uk/webteam/gateway/file.php?name=5institutionalism09&site=12. |
| ⇧11 | Ils retracent, par exemple, les différends ainsi que l’évolution de l’influence relative des différents départements de l’administration fédérale, notamment l’ascendant du Trésor dans les années trente (p. 71) et quatre-vingt-dix (p. 256). |
| ⇧12 | La « théorie de la stabilité hégémonique » considère que la stabilité du système interétatique nécessite pour être assurée l’existence d’une puissance hégémonique. Les États-Unis auraient échoué à jouer ce rôle dans l’entre-deux-guerres en raison de l’opposition des courants isolationnistes. Charles P. Kindleberger The World in Depression, 1929-1939, Los Angeles, University of California Press, 1973, est l’ouvrage de référence. |
| ⇧13 | The Making, pp. 178-179 notamment. |
| ⇧14 | Chris Harman « Theorising Neoliberalism », International Socialism Journal 117, http://isj.org.uk/www.isj.org.uk/index85de.html?id=399&issue=117 |
| ⇧15 | Panitch et Gindin tirent cette théorie de leur lecture croisée de Nicos Poulantzas et de Ralph Miliband. Plus que la généalogie de leur théorie cependant, l’élément à relever est sa proximité avec celles d’Alex Callinicos et de David Harvey. |
| ⇧16 | Pour des versions sociologiques de cet argument, cf. Leslie Sklair The Transnational Capitalist Class, Oxford, Wiley-Blackwell, 2001; Robinson, William I. and Jerry Harris ‘Towards a global ruling class ? Globalization and the transnational capitalist class’, Science and Society, 64/1, Spring 2000. |
| ⇧17 | Alex Callinicos est le représentant le plus affirmé de cette position dans le monde anglophone. Claude Serfati a défendu une position similaire en français (cf. Impérialisme et militarisme : Actualité du XXIème siècle, Lausanne, Page Deux, 2004). |
| ⇧18 | Leo Panitch affirme ceci explicitement dans l’entretien accordé à Alex Callinicos dans le cadre du Deutscher Prize (voir note 7, à partir de 8:30 de la vidéo). Cela l’amène à rejeter le concept même de « déclin relatif », puisque l’émergence de la Chine, par exemple, ne signifie pas automatiquement le déclin des États-Unis. Je reviens à cette question plus loin. |
| ⇧19 | The Making, pp.7-8. |
| ⇧20 | The Making, pp. 15. |
| ⇧21 | Cette spécificité institutionnelle de la finance américaine s’explique par le poids important des courants populistes jeffersoniens dans l’histoire américaine, notamment durant le dix-neuvième siècle. Ces courants s’opposaient aux grandes concentrations de capital et à la centralisation politique centrée sur Washington (le « big government »), et donc, à fortiori, à la communauté financière de New York. Leur poids politique explique le caractère tardif de la création d’une banque centrale américaine (le Federal Reserve System n’est créé qu’en 1913) mais aussi la faiblesse des banques commerciales américaines. Cela eut pour conséquence de détourner une grande partie de l’épargne vers les marchés de titres et la Bourse de New York et de renforcer la position relative des grandes banques d’investissement new-yorkaises, mais également d’accentuer la volatilité des marchés financiers américains et de les rendre plus propices à des mouvements de panique. Cf. Michael Lind Land of Promise. An Economic History of the United States, New York, Harper, 2013. |
| ⇧22 | The Making, p. 267. |
| ⇧23 | A gauche, le « déclinisme » a notamment été défendu par Giovanni Arrighi qui voyait dans ces déficits le signe que les États-Unis sont entrés depuis la fin des années soixante-dix dans l’étape de décadence qui suivrait l’étape de l’apogée de leur puissance, un cycle qui caractériserait toutes les puissances dominantes depuis le quinzième siècle. A droite, l’ouvrage ayant fondé l’école « décliniste » est Paul Kennedy The Rise and Fall of the Great Powers : Economic Change and Military Conflict from 1500 to 2000, New York, Random House, 1987. Kennedy a inspiré de nombreux auteurs « réalistes » pour lesquels le système interétatique repose sur des relations par définition antagoniques. Panitch et Gindin rejettent totalement les analyses de cette école, alors que Callinicos voit certaines convergences entre son analyse et le réalisme. |
| ⇧24 | The Making, p. 292. |
| ⇧25 | The Making, p. 302. |
| ⇧26 | The Making, p. 326. |
| ⇧27 | The Making, p. 192. |
| ⇧28 | A ce propos, voir également l’ouvrage d’Ellen Meiksins Wood L’empire du capital, Montréal, Lux éditeur, 2011 ; Wood a longtemps été la collègue des deux auteurs à York. |
| ⇧29 | Les théoriciens « réalistes » désignent ce comportement par le terme « bandwagoning ». |
| ⇧30 | Que la source de ce pouvoir effectif est la puissance économique va de soi, ce qui est un autre point commun entre matérialisme historique et « réalisme ». D’où une tendance chez les auteurs à minimiser l’accroissement de la puissance économique des puissances concurrentes des États-Unis. |
| ⇧31 | L’école « libérale » en relations internationales est en réalité un sous-produit de l’idéologie universaliste des élites new-yorkaises – ce n’est pas une coïncidence si l’analyse de l’ouvrage est centrée sur la prééminence de la finance américaine et qu’elle reproduise en même temps cet argument particulier de l’école « libérale ». |
| ⇧32 | Que les principales lignes de faille dans le système se situent à l’intérieur des États plutôt qu’entre eux est la conclusion stratégique la plus importante à laquelle arrivent les deux auteurs. |
| ⇧33 | Panitch et Gindin essentiellement soutiennent, à juste titre, que le capitalisme américain s’est restructuré en se spécialisant de façon croissante dans les activités à haute valeur ajoutée, que ce soit l’industrie financière, les services aux entreprises ou les industries de haute-technologie. |
| ⇧34 | Comme l’ouvrage ne traite pas des dimensions militaires, je laisse aussi de côté cet aspect des choses dans ce qui suit. |
| ⇧35 | The Making, p. 100. |
| ⇧36 | Cf. de façon générale Jean-Christophe Defraigne De l’intégration nationale à l’intégration continentale : Analyse de la dynamique d’intégration supranationale européenne des origines à nos jours, Paris, L’Harmattan, 2004 ; plus particulièrement sur l’épuisement de l’influence américaine à partir de p. 167. |
| ⇧37 | Cf. Kerry Chase Trading Blocs : States, Firmes, and Regions in the World Economy, Ann Arbor, University of Michigan Press, 2005, chapitre 3. De ce point de vue, la politique nazie, la politique impériale japonaise et la politique impériale britannique à partir de 1932 et les accords d’Ottawa (instituant la préférence impériale au sein du Commonwealth britannique) avaient le même objectif ; nul hasard si l’administration fédérale combattit avec force toutes les trois. L’anticolonialisme impérial américain avait un objectif précis, à savoir empêcher que l’accès aux marchés coloniaux britanniques, français et japonais ainsi qu’au marché européen ne soit refusé aux grandes firmes américaines. |
| ⇧38 | Voir notamment Charles Kupchan The End of the American Era : U.S. Foreign Policy and the Geopolitics of the Twenty-First Century, New York, Vintage, 2003, pp. 119-159 et »The Travails of Union : The American Experience and Its Implications for Europe », Survival, 46/4, winter 2004/5 où Kupchan rapproche le processus de centralisation politique européenne de celui décrit par Panitch et Gindin à propos du développement des « capacités étatiques » américaines durant les années 1900-1945. Kupchan n’est pas n’importe quel auteur ; il a été membre du National Security Council sous Clinton ainsi que le directeur du programme Europe du Council on Foreign Relations, le principalthink-tank de politique étrangère à Washington. Bizarrement, Panitch et Gindin font référence à cet ouvrage (The Making, p. 203, note 42) seulement en passant et pour congédier son analyse. |
| ⇧39 | Cité dans »Stay at heart of Europe, U.S. tells Britain », Financial Times, January 10, 2013. |
| ⇧40 | Cité dans Geir Lundestad »Empire » by Integration : The United States and European Integration, 1945-1997, Oxford, Oxford University Press, 1997, p. 102. Kissinger admettait volontiers que « l’avenir d’une Europe unie dépend davantage de développements à Londres, Paris et Bonn que des constrictions de Washington », p. 101. La réorientation dont il est question dans le corps du texte est progressivement intervenue durant les années soixante, l’administration fédérale abandonnant le soutien activiste et inconditionnel en faveur de l’unification européenne au profit d’une attitude davantage soucieuse des intérêts économiques américains. A part Lundestad, voir aussi Andreas Dür Protection for Exporters: Power and Discrimination in Transatlantic Trade Relations, 1930-2010, Ithaca, Cornell University Press, 2010, chapitres 4 et 5. |
| ⇧41 | The Making, pp. 244-245. |
| ⇧42 | The Making, p. 287. |
| ⇧43 | »The new wave of regionalism », Edward Mansfield and Helen Milner, International Organization, 53/3, 1999. |
| ⇧44 | Alan Rugman The Regional Multinationals, Cambridge, Cambridge University Press, 2005. |
| ⇧45 | The Making, p. 288. |
| ⇧46 | Peter Dicken Global Shift : Mapping the Changing Contours of the World Economy, London, Sage, 2011, pp. 158-166 et 241-426. Pour une étude de l’industrie automobile, Timothy Sturgeon, Olga Memedovic, Johannes van Biesebroeck and Gary Gereffi »Globalisation of the automotive industry : main features and trends », International Journal of Technological Learning, Innovation and Development, 2/1-2, 2009. |
| ⇧47 | Dür Protection for Exporters, chapitres 6 et 7 ; Christian Deblock et Gérald Cadet »La politique commerciale des États-Unis et les nouvelles dynamiques régionales », in Christian Deblock et Sylvain Turcotte Suivre les Etats-Unis ou prendre une autre voie ? Diplomatie commerciale et dynamiques régionales au temps de la mondialisation, Bruxelles, Bruylant, 2003 ; Chase, chapitre 6. Jusqu’aux années quatre-vingt, l’administration fédérale s’est abstenue de poursuivre des accords bilatéraux ou régionaux de libéralisation des échanges et de l’investissement afin de ne pas compromettre le principe de la libéralisation multilatérale, incarnée par le GATT. Cela change durant les années quatre-vingt et à partir de l’accord de libre échange avec le Canada de 1988, l’administration fédérale poursuit une politique contournant le GATT. L’essoufflement du multilatéralisme a d’autres causes également, notamment l’émergence d’autres puissances commerciales (la Chine, l’Inde, le Brésil, etc.) et la difficulté d’arriver à un accord multilatéral faisant la synthèse des priorités de l’ensemble des puissances commerciales. |
| ⇧48 | Ce terme a été inventé par l’un de ces intellectuels organiques de la bourgeoisie américaine qui occupent une place éminente dans le récit de Panitch et Gindin, à savoir C. Fred Bergsten ( »Competitive Liberalization and Global Free Trade : A Vision for the Early 21st Century », Peterson Institute for International Economics Working Papers, 1996), secrétaire assistant aux affaires internationales au Trésor (le poste qu’ils considèrent comme le plus influent au sein du Trésor) sous Carter puis fondateur en 1981 et directeur jusqu’en 2012 du Peterson Institute for International Economics, le think-tank de politique économique internationale le plus influent à Washington. |
| ⇧49 | Une formalisation de cet argument est dans Richard Baldwin »Multilateralising Regionalism : Spaghetti Bowls as Building Blocs on the Path to Global Free Trade », The World Economy, 29/11, 2006. |
| ⇧50 | William Appleman Williams The Tragedy of American Diplomacy, New York, Delta Books, 1962 ; Andrew Bacevich American Empire : The Realities and Consequences of U.S. Diplomacy, Cambridge MA, Harvard University Press, 2002 et Christopher Layne The Peace of Illusions : American Grand Strategy from 1940 to the Present, Ithaca, Cornell University Press, 2006. |
| ⇧51 | Ce rattrapage est visible dans l’évolution des classements internationaux des grandes firmes comme le Fortune Global 500. Sur la dialectique entre régionalisme, exploitation des économies d’échelle et dynamique du système commercial international, cf. l’excellent ouvrage de Kerry Chase cité plus haut. |
| ⇧52 | L’ouvrage le plus significatif à cet égard est Laura d’Andrea Tyson Who’s bashing Whom ? Trade Conflict in High-Technology Industries, Washington D.C., Institute for International Economics, 1992. L’auteure a servi dans l’administration Clinton, d’abord en tant que présidente du Council of Economic Advisers du président entre 1993 et 1995 puis en tant que directrice du National Economic Council, en plus d’être membre du Council on Foreign Relations et membre des conseils d’administration de Morgan Stanley, AT&T et d’autres grandes firmes américaines. |
| ⇧53 | Fred Block »Swimming Against the Current : The Rise of a Hidden Developmental State in the United States », Politics and Society, 36/2, 2008. |
| ⇧54 | Linda Weiss America Inc. ? Innovation and Entreprise in the National Security State, Ithaca, Cornell University Press, 2014.A mon sens, Panitch et Gindin surestiment le rôle de l’industrie financière, notamment du capital-risque, dans le développement de la Silicon Valley et sous-estiment celui du Pentagone. |
| ⇧55 | Daniel Drezner All Politics is Global : Explaining International Regulatory Regimes, Princeton NJ, Princeton University Press, 2007. |
| ⇧56 | Christakis Georgiou »L’Europe contre Google », SolidaritéS, n. 260, 18 décembre 2014 http://www.solidarites.ch/journal/d/article/6733 |
| ⇧57 | Elliot Posner »Making Rules for Global Finance : Transatlantic Regulatory Cooperation at the Turn of the Millenium », International Organization, 63, 2009. |
| ⇧58 | Cité dans Stefan Collignon and Andrea Schwarzer Private Sector Involvement in the Euro : The Power of Ideas, London, Routledge, 2003, p. 112. |
| ⇧59 | »Beijing’s challenge to the world of Bretton Woods », Financial Times, October 30, 2014. |
| ⇧60 | Layne, chapitre 2. |