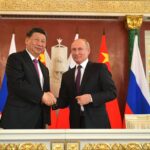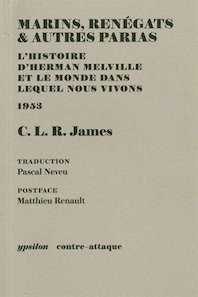
À lire : un extrait de « Marins, renégats et autres parias » de C. L. R. James
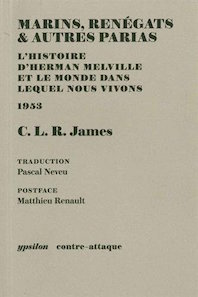
C. L. R. James, Marins, renégats et autres parias. L’histoire d’Herman Melville et le monde dans lequel nous vivons, Paris, Ypsilon Editeur, 2016, 19 euros.
En 1952, en plein maccarthysme, les Services d’immigration et de naturalisation américains arrêtent et emprisonnent C.L.R. James à Ellis Island. C’est là que James débute la rédaction de Marins, renégats & autre parias /L’histoire d’Herman Melville et le monde dans lequel nous vivons. Avec l’aimable autorisation de l’éditeur, Ypsilon, nous reproduisons ici un extrait du 1er chapitre traduit de l’anglais par Pascal Neveu, suivi de la postface de Matthieu Renault, maître de conférences en philosophie à l’Université Paris 8 Vincennes-Saint-Denis, et notamment auteur deC.L.R. James : La vie révolutionnaire d’un « Platon noir » (La Découverte, 2016).
Chapitre 1 : LE CAPITAINE ET L’ÉQUIPAGE
Un soir, il y a plus de cent ans, un baleinier américain prend la mer, en route vers ses lieux de pêche, lorsque soudain son capitaine unijambiste, Achab, ordonne à Starbuck, son second, « d’appeler à un rassemblement général à l’arrière ». Il y déclare à l’équipage que le but réel du voyage est de chasser une Baleine blanche, renommée parmi les pêcheurs de baleine pour sa couleur particulière, sa taille et sa férocité. C’est la baleine, dit-il, qui a arraché sa jambe, et il la pourchassera « au-delà des flammes de l’enfer ». Sa passion et son habileté tactique rallient tout l’équipage à sa cause dans un même élan enthousiaste.
Selon Starbuck, le second, les hommes chassent la baleine pour gagner de l’argent et toute autre raison n’est que folie. Il proteste violemment : pour l’argent, je serais capable de tout faire, « capitaine Achab, et même affronter les mâchoires de la malemort si la chose doit se produire au cours de notre campagne de pêche ; mais je suis ici pour chasser des baleines, non pour exercer la vengeance de mon commandant. Combien de barriques d’huile tireras-tu de ta vengeance ? Elle ne te rapportera pas grand-chose sur le marché de Nantucket. »
Achab prononce alors des mots qui portent atteinte aux fondements mêmes de la civilisation américaine. Au diable les affaires et l’argent, voilà ce qu’il dit.
Le marché de Nantucket ! Pouah ! […] Si l’argent doit être l’aune — et les comptables qui tiennent les comptes de l’univers ont calculé, en ceinturant la planète de guinées, qu’une pièce mesure trois quarts de pouce de diamètre –, alors laisse-moi te dire, mon brave, que ma vengeance produira de gros bénéfices ici !
Et il se frappe la poitrine.
La libre entreprise doit produire des biens à vendre ; en gagnant par le travail autant d’argent que possible, les hommes prospèrent et font de leur nation une grande nation ; c’est là le devoir de tout homme : tels étaient les fondements incontestés de la civilisation américaine en 1851 et tels en sont encore aujourd’hui les doctrines officielles. Mais voilà qu’un homme piétine ces principes sacrés, les raille, et leur oppose ses propres sentiments d’être humain.
Et le capitaine éprouve un mépris aussi profond envers les autres piliers de l’américanisme.
Un jour, l’huile fuit sur le navire et Achab, tout entier à sa poursuite de Moby Dick, refuse de s’arrêter pour réparer la fuite. Starbuck, comme à son habitude, proteste : « Que vont dire les armateurs, monsieur ? »
Pour Achab, les droits des armateurs peuvent bien aller à perte.
Qu’ils restent plantés sur la grève de Nantucket et couvrent de leurs cris les hurlements des typhons. Qu’importe à Achab ? Les armateurs… les armateurs ? Tu passes ton temps à me débiter des niaiseries sur ces grigous, comme si les propriétaires étaient ma conscience. Mais écoute ceci : seul possède vraiment quelque chose celui qui en a le commandement.
Il est évident que Moby Dick, quoi qu’il en soit, n’est pas une simple aventure. Ou ne l’est plus. Si le capitaine Achab exprimait telles opinions aujourd’hui, il ne serait pas seulement renvoyé de son emploi par n’importe quel employeur du pays, mais il ferait aussi l’objet d’une rigoureuse enquête du F.B.I.
Qui est cet extraordinaire personnage ? Nous pouvons aujourd’hui, par notre expérience de ces vingt dernières années, reconstituer sa biographie et le comprendre beaucoup mieux que ceux pour qui le livre avait été écrit.
Ses ancêtres se comptent parmi les fondateurs des États-Unis. Il est né aux environs de 1790, en Nouvelle-Angleterre. Il a donc vécu une période de liberté en pleine expansion, à l’issue de la guerre d’Indépendance. L’Amérique était alors le pays le plus libre au monde, en termes d’opportunités surtout.
Enfant, Achab avait déjà choisi la pêche à la baleine pour métier. À dix-huit ans, il frappait sa première baleine. Nantucket, son lieu de naissance, était l’un des grands centres baleiniers de l’époque, et la chasse à la baleine était sur le point de devenir l’une des plus grandes industries aux États-Unis. Achab a connu cette pleine croissance du progrès matériel, du commerce et de la finance. Par son énergie, ses compétences et son dévouement au travail, il est devenu capitaine de son propre navire comme d’autres jeunes hommes doués et énergiques. En fait, il est un maître dans son exigeante profession.
Une fois capitaine, Achab s’est par la suite continuellement trouvé en révolte contre son travail, sa vie personnelle et son entourage. Ce n’est pas un homme de personnalité particulière, mais la vie a fait de lui ce qu’il est.
Sa façon de mener les repas fait partie des choses à dire de lui. Achab mange dans sa cabine avec ses officiers. Mais pour un homme aux commandes d’un navire, cela consiste davantage qu’à un simple repas. Cela fait partie des moyens par lesquels le capitaine maintient la discipline sur ses hommes. Sur mer, le capitaine préside à la table comme un Tsar. Puis, le second, le premier lieutenant et le second lieutenant entrent dans cet ordre, sont servis dans cet ordre, et repartent dans l’ordre inverse. Flask, le second lieutenant, doit entrer en dernier, être servi en dernier et repartir lorsque Starbuck, le second, se lève. Flask s’en plaint car, de ce fait, il n’a jamais assez à manger et se sent affamé depuis qu’il est officier. Les repas dans la cabine « se déroul[ent] dans un silence [si] impressionnant », que c’est un soulagement « quand un rat [fait] soudain du tapage dans la cale ».
Le repas est un symbole illustrant à quel point Achab est isolé des hommes sous ses ordres, un isolement que lui impose sa position de commandant. Personne ne reste dans cette cabine une minute de plus que nécessaire. « Il n’exist[e] aucune camaraderie dans la cabine. La fonction d’Achab la rend inaccessible ; bien qu’il [soit] compté au nombre des habitants du monde chrétien, il y demeur[e] étranger. Il [vit] sur terre comme le dernier grizzli vécut dans le Missouri colonisé. » Achab lui-même le supporte mal. « On a l’impression de descendre dans sa tombe, se murmurait-il à lui-même, » en descendant l’écoutille vers son cercueil. Et souvent, « lorsque les quarts de nuit sont établis », il quitte sa « couchette [solitaire] pour monter inspecter le pont enveloppé de nuit ».
L’évangile de l’Amérique est, avant tout, celui du dévouement au travail. Achab, un homme d’éducation Quaker, l’a respecté. Sur quarante ans de vie, il en a passé trois à terre. Son travail l’a contraint à se marier tardivement, puis l’a séparé de sa femme et de son fils. Ainsi pouvons-nous comprendre son cri du cœur lorsque, à la fin de sa longue quête de la Baleine blanche, il fait le bilan de sa vie. Il a fait ce que devait faire un homme, et cela s’est changé en cendres et poussière dans sa bouche. « Oh ! Starbuck ! Quelle douceur dans cette brise… quelle douceur dans ce ciel. C’est par un jour tout semblable — presque aussi suave que celui-ci — que j’ai piqué ma première baleine… J’étais un jeune harponneur de dix-huit ans ! Il y a quarante ans… quarante… quarante ans de cela ! Quarante ans de pêche de la baleine sans discontinuer ! Quarante ans de privations, de périls, de tempêtes ! Quarante ans sur la mer impitoyable ! Pendant quarante ans, Achab a déserté la terre paisible pour guerroyer contre les horreurs de l’abîme ! Quarante ans, Starbuck… oui… quarante, sur lesquels je n’en ai pas passé trois à terre… »
Il reconnaît là ce que l’isolement du commandement a fait de lui.
Quand je songe à cette vie que j’ai menée, à la solitude qui a été la mienne, à l’existence recluse d’un capitaine, pareille à une ville fortifiée dont la maçonnerie n’admet que rarement la sympathie de la campagne verdoyante alentour… oh ! la lassitude… le poids de ce fardeau… la servitude du commandement solitaire, digne de l’esclavage africain ! Quand je songe à tout cela, que je ne faisais qu’entrevoir et que je ressens aujourd’hui seulement avec cette acuité particulière… à ces quarante années pendant lesquelles je me suis nourri d’aliments secs et salés — symbole approprié de la nourriture aride de mon âme –, tandis que le plus pauvre des terriens avait chaque jour des fruits frais à portée de main, et rompait le pain frais du monde quand je brisais mes croûtes moisies… séparé par des océans de cette jeune femme-enfant dont j’ai fait mon épouse passée la cinquantaine, mettant à la voile dès le lendemain pour le cap Horn et ne laissant que l’empreinte de ma tête sur l’oreiller de mes noces… mon épouse ?… une épouse ? Plutôt la veuve d’un mari toujours en vie ! Oui, Starbuck, j’ai rendu veuve cette pauvre fille en l’épousant ! Puis… la folie, la fureur, le sang qui bout, le front qui fume quand le vieux chasseur met mille fois la chaloupe à la mer, et rageusement, l’écume aux lèvres, poursuit sa proie… Un homme ? Plutôt un démon !… Ah ! l’insensé ! Oui, Achab, a été un épouvantable vieil insensé pendant quarante ans. Pourquoi ce corps à corps de la chasse ? Pourquoi se briser le bras de fatigue à l’aviron, au fer, à la lance ? Achab en est-il aujourd’hui plus riche ou meilleur ?
Tels mots, à cette place1, figurent parmi les plus étranges du livre.
« Ah ! l’insensé ! Oui, Achab, a été un épouvantable vieil insensé pendant quarante ans. » Puis il ajoute : « Je me sens faible à mourir, voûté, bossu, comme si j’étais Adam titubant sous le poids des siècles entassés depuis le temps du paradis. »
L’ouvrier américain moyen d’aujourd’hui ne voit pas le management de cette façon. L’industrie a changé, et l’homme qui supporte désormais cette charge est le contremaître. Mais Melville traite ici de l’essentiel et, bien que la forme ait changé, le type de base reste le même. Achab sait ce qui est mauvais mais il n’y peut rien. L’habitude, la nécessité, la discipline, tout lui donne le droit de ne rien faire, en tant que capitaine. Il peut rester dans sa cabine pendant des jours — le travail à bord se poursuivra. La chasse aux baleines, la conversion du bateau en usine pour tirer le lard, l’incessante activité dans toute sa variété, il n’y participe pas. Sur deux cents pages, nous verrons les hommes au travail et Achab n’apparaît pas, ou, s’il le fait, seuls lui importent les aléas de sa propre vie et sa vengeance monomaniaque.
Arrêtons-nous un instant et, grâce à l’immense savoir accumulé ces vingt dernières années, plaçons Achab en perspective. Il est le type social le plus destructeur et dangereux qui soit jamais apparu dans la civilisation occidentale.
Pendant des générations, les gens ont cru que les hommes opposés aux droits de la propriété, à la production du marché, à la domination de l’argent, etc., étaient des socialistes, des communistes, ou des radicaux de toutes sortes, unis par le seul fait de penser la société en termes de réorganisation par les ouvriers, par la grande majorité des opprimés, des exploités, des déshérités. Certains, bien sûr, pensaient que l’expérience, si elle était menée, conduirait inévitablement à la tyrannie. Mais personne n’avait imaginé que les directeurs, surintendants, cadres et gérants éprouveraient autant de répugnance et d’amertume envers la société de la libre entreprise, le marché et la démocratie, ni qu’ils essaieraient de la réorganiser selon leurs vœux tout en risquant de détruire la civilisation dans ce processus. De nombreux écrivains, surtout Allemands, ont montré qu’ils avaient plus ou moins compris ce type. Mais aucun chef d’État, ministre des affaires étrangères, député ni membre du parlement n’a, en dépit des préparations à la guerre contre le nazisme hier et contre l’impérialisme soviétique aujourd’hui, montré le moindre signe de compréhension de l’ennemi contre lequel ils se préparent. C’est l’unique et solitaire grandeur de Melville d’avoir vu et compris dans toute sa mesure ce type et ses relations avec tous les autres types sociaux. Comment en fut-il capable cent ans auparavant, c’est ce que nous allons montrer, mais il nous faut d’abord comprendre ce qu’est le type totalitaire lui-même.
Achab n’est pas un homme ordinaire. Il a l’esprit affûté et une bonne éducation. C’est un homme au physique splendide, de grand courage, et d’un tempérament sincère et passionné. C’est un quaker qui, à ses débuts, haïssait tant l’Église Catholique qu’il avait craché dans le récipient sacré d’une cathédrale. Bref, c’est un homme qui veut vivre en plein accord avec ses convictions. Et cela, précisément, causera sa perte.
Il a, entre-temps, renoncé au quakerisme. Sa religion principale depuis quelques années est la religion de son époque — le progrès matériel. Le symbole en est, dans Moby Dick, comme à toute époque, le culte du feu. Melville revient là sur un symbolisme aussi vieux que le monde. Le mot ancien en sanscrit pour « porteur de feu » est pramantha. Prométhée est le nom que les Grecs ont donné au dieu qui apporta le feu au monde. Pour avoir offert ce savoir aux hommes, Prométhée fut exclu du paradis, cloué à un rocher et torturé pendant trois cents ans. Mais il refusa de demander grâce. Son histoire est peut-être la plus fameuse de toutes les légendes grecques. Tout réel progrès dans les arts et les sciences entraîne une crise. Et la crise d’Achab est celle d’une civilisation qui se sait en voie d’acquérir une complète maîtrise des arts et des sciences.
Achab, véritable fils de l’Amérique du dix-neuvième siècle, vénère le feu mais il en a été frappé (par un éclair, probablement) et en fut marqué de la tête aux pieds.
Vivant sa vie loin de toute civilisation, chassant des baleines dans les mers les plus lointaines, observant les étoiles la nuit, et développant ses propres idées, il s’était mis progressivement à écarter les opinions de son temps et à penser indépendamment. Il en est à ce stade.
Le feu, lié au pouvoir et à la civilisation du progrès matériel, est une puissante force de création. Mais sa créativité est mécanique. Mécanique est un mot dont Achab usera plusieurs fois. C’est cela qui détruit sa vie en tant qu’être humain, et qu’il combattra. Ainsi s’en explique-t-il un soir, alors que les éclairs et le tonnerre d’un effroyable orage éclatent tout autour du navire et que des lueurs magnétiques embrasent les mâts :
Au milieu de l’impersonnel par toi personnifié se tient une personne. Rien qu’un point, mais d’où que je vienne et où que j’aille, tant que je vivrai ici-bas, cette personne royale vivra en moi, consciente de ses droits souverains. Mais la guerre est souffrance, et la haine torture. Viens sous la plus humble forme de l’amour, et je m’agenouillerai pour te baiser ; mais parais sous ton apparence la plus altière, simple puissance surnaturelle, et bien que tu lances des flottes entières de mondes lourdement chargés, quelque chose au fond de moi demeure indifférent. Ô clair esprit, de ton feu je suis le fils, et ce vrai fils du feu souffle en retour sur toi sa flamme.
Derrière cette puissante force impersonnelle se trouve donc quelque chose de réellement créatif, au sens humain du terme. Achab ne rejette pas le feu, qu’il soit pouvoir ou créativité mécanique. Mais il ne sait pas ce qu’il en est. Il sait qu’il a fait de lui ce qu’il est. Et s’en réjouit. Mais aussi longtemps que cela impliquera une existence aussi inhumaine que celle qu’il a vécue jusqu’alors, il le défiera.
Il en est au point désormais où il appréhende le problème philosophiquement, comme un problème de civilisation mondiale. Comment concilier les avantages indubitables de la civilisation industrielle et ce que cette même civilisation a fait de lui en tant qu’être humain. Achab formulait là une question que ses compatriotes commenceront à poser seulement quelques années plus tard. Mais son malheur et son défi cachaient un vice fatal. Pas une seule fois l’idée ne lui traverse l’esprit de s’interroger sur la nature de ses relations avec les personnes sous ses ordres. Il accepte telles relations. Sa personnalité souffre. Il défiera son bourreau. Il trouvera une solution. Individualiste formé à l’école de l’individualisme, il le restera jusqu’à la fin.
Jusque-là, des dizaines de millions d’Américains peuvent comprendre Achab. Ils ont travaillé sous les ordres d’hommes comme lui. Un plus petit nombre, significatif, d’hommes a même vécu son expérience. Le moteur Diesel et maintenant l’énergie atomique confrontent l’immense majorité des hommes au même problème que lui : l’évidente et effrayante puissance mécanique d’une civilisation industrielle qui avance désormais à grands pas et apporte dans le même temps la mécanisation et la destruction de la personnalité humaine.
Les hommes qui pensent ainsi, les classes d’une nation qui forment de telles pensées, se sont fermement préparés à une action désespérée. Si, dorénavant, une violente catastrophe s’abat sur eux, les ruine et les convainc que leur vie est intolérable, si les graves doutes qui les tourmentaient auparavant se justifient, alors ils n’hésiteront à écarter aucune des contraintes traditionnelles de la civilisation. Ils chercheront un nouveau modèle de société et un programme d’action et, sur la base de ce modèle et de ce programme, ils agiront. C’est ce qu’a vécu Achab lorsqu’une baleine lui a arraché la jambe. Et cette baleine est Moby Dick.
Afin de bien appréhender l’effet d’une telle catastrophe, nous devons comprendre non seulement l’histoire d’Achab mais aussi celle de Moby Dick. Moby Dick est une baleine extraordinairement grande et puissante. Ce qui frappe à son propos est qu’elle ne fuit pas les baleiniers, au contraire, elle les chasse et les combat. Elle se bat avec tant de férocité et de fourberie qu’elle en est devenue une terreur des mers. À la longue, la fourberie de ses attaques apparaît aux yeux des marins superstitieux comme étant le résultat de quelque impénétrable et malveillante intelligence. Tout cela fait de la Baleine blanche une baleine exceptionnelle, mais en aucun cas unique. De telles baleines sont connues dans le monde de l’industrie baleinière, certaines même ont un nom. Et d’audacieux capitaines sont partis en mer dans le seul but de traquer ces monstres en délaissant leur pêche. C’est pourquoi la poursuite de Moby Dick par Achab, même un peu étrange, ne surprend personne. Cela est arrivé déjà et arrivera encore.
Mais Achab est l’homme que nous connaissons. La perte de sa jambe fut pour lui la preuve définitive d’un monde absolument déraisonnable. Et lors des longues heures de souffrance et de douleur qui ont suivi, les doutes, problèmes et frustrations d’Achab quant à ce monde dans lequel il vit, ont mûri. En Moby Dick, décide-t-il, se trouve la solution à ses problèmes. S’il tue Moby Dick, il mettra fin à ses tourments.
La Baleine blanche qui fendait les eaux devant elle était comme l’incarnation monomaniaque de ces forces maléfiques que certains êtres profonds sentent les dévorer, les laissant survivre avec la moitié d’un cœur et d’un poumon. […] Tout ce qui affole et torture le plus exquisément, tout ce qui remue la lie des choses, la vérité mêlée de malice, ce qui vous brise les nerfs et vous encroûte le cerveau, toutes les démoniaques machinations de la vie et de la pensée — le mal sous toutes ses formes, pour cet insensé [d’Achab], s’incarnait de manière visible en Moby Dick et pouvait donc être concrètement attaqué. Il avait amassé sur la bosse blanche de la baleine la somme totale de rage et de haine éprouvées par l’espèce humaine tout entière depuis Adam et, comme si sa poitrine eût été un mortier, il en faisait désormais la cible de cet obus qu’était devenu son cœur brûlant.
Fou, il l’est sans aucun doute désormais, mais ce qui était folie dans un livre cent ans plus tôt, est aujourd’hui la folie même de l’époque dans laquelle nous vivons. Elle a coûté à notre civilisation contemporaine beaucoup de sang et d’inestimables richesses. Nous devons la vaincre ou elle nous détruira. Avant d’aller plus loin avec Achab, portons un regard sur nous-mêmes.
En 1933, le régime d’Hitler surgissait du sein même de la civilisation occidentale, comme maître de l’Allemagne. À ce jour, les gens résistent en acceptant l’essentiel des faits à propos des nazis. Les nazis disaient que la civilisation mondiale se désintégrait et qu’ils avaient une solution — la création d’une race supérieure. C’était leur programme. Il impliquait non seulement l’antisémitisme, mais aussi la destruction de dizaines de millions de Polonais, de Slaves et d’autres races qu’ils jugeaient inférieures. Ils disaient que c’était la solution aux problèmes de l’Europe. Ils mèneraient ce programme à terme ou, s’ils échouaient, mettraient l’Europe en ruines. Et tout ce qu’ils ont fait, jusqu’à l’ultime tentative de détruire l’Allemagne, était subordonné à ce programme. Aujourd’hui, les gens parlent encore d’impérialisme nazi, de dictature, de soif de pouvoir, d’espace vital, etc. Ils ne peuvent croire que ce n’étaient là que de simples outils pour la réalisation de ce projet. Hier, ils n’ont donc pu faire face à Hitler avec l’esprit clair et une bonne conscience (comme ils ne peuvent aujourd’hui faire face à Staline), car cette folie est née dans les profondeurs de la civilisation occidentale et s’en nourrit.
L’organisation politique de l’Europe moderne est basée sur la création et la consolidation d’États nationaux. L’État national, tout État national, avait et a toujours une idéologie raciale. Cette idéologie proclame que la race nationale, la souche nationale ou le sang national sont supérieurs à toute autre race nationale, souche nationale ou sang national. Cette idéologie fut parfois ouvertement déclarée, plus souvent dissimulée, mais elle était là et est toujours là, et elle est même devenue plus forte ces vingt dernières années à travers le monde. Qui en doute n’a qu’à lire la loi McCarran2 de 1952, qui est imprégnée de cette idéologie de supériorité raciale.
L’Europe de l’ouest en 1914-1918 s’est elle-même donnée les coups dont elle ne se relèverait jamais. Blessé et frappé plus que les autres, l’État national d’Allemagne chercha un modèle de société et un programme. Parmi les ruines, on peut en voir aujourd’hui les fondations, cette théorie de supériorité de la race nationale. Les nazis s’en étaient saisis et, écartant toute semi-vérité, avaient décidé de la porter à sa conclusion logique. L’État national était le dieu unique, sans plus d’hypocrisie ni de feinte. La race nationale était la race supérieure. Par cela, ils résoudraient tout ou ruineraient définitivement l’Europe, et c’est ce qu’ils ont fait. Ils n’ont rien résolu, mais ont laissé derrière eux une Europe irrémédiablement détruite.
Voici donc comment les masses d’hommes se comportent tôt ou tard, et c’est ce que montre Melville dès 1851. En tant qu’artiste, il voyait cela en termes de personnalités et de relations humaines, et par conséquent pouvait seulement le présenter de cette façon. La maison dans laquelle Achab a grandi, la civilisation américaine du dix-neuvième siècle, cette maison-là tombait en ruines sous ses yeux. Cherchant alors désespérément quelque dessein ou programme, il l’a trouvé en ce qui a toujours été implicite dans l’industrie baleinière et qu’il expose désormais au grand jour : la poursuite des baleines, dans son cas symbolisé par une seule baleine, indépendamment de toutes considérations de civilisation, d’humanité, de religion ou de quoi que ce soit.
Tout est dans la relation intime, proche et logique, de la folie avec ce que le monde a jusqu’ici accepté comme étant sain et raisonnable, les valeurs par lesquelles tous les hommes bons ont vécu. En même temps qu’il écrit Moby Dick, Melville publie un article3 dans lequel, traitant du Roi Lear, un autre personnage littéraire fameux devenu fou lui aussi, il déclare : « Tourmenté jusqu’au désespoir, Lear, le roi frénétique, arrache le masque et énonce la sage folie de la vérité vitale. »
Hitler à peine éliminé, Staline menaçait d’écraser non seulement l’Europe mais le monde entier. Le type est le même. Si la base politique de l’État national est la supériorité raciale de la souche nationale, sa base strictement économique en est le développement des ressources de la Nation. Dès 1928, dans une Russie épuisée et désespérée par la révolution, ne voyant dans le monde alentour aucune lueur d’espoir, se levait le même type social que chez les Nazis — administrateurs, cadres, gestionnaires, leaders ouvriers, intellectuels. Leur but premier n’était pas la révolution mondiale. Ils souhaitaient construire des usines et des centrales électriques plus grandes que toutes celles qui avaient été construites. Leur but était de raccorder des fleuves, déplacer des montagnes, semer depuis les airs ; et pour atteindre ce but, ils dilapideraient des ressources humaines et matérielles sur une échelle sans précédent. Leur intention première n’était pas la guerre. Ce n’était pas la dictature. C’était le Plan. En quête de ce qu’ils nomment la planification de l’économie, ils ont dépeuplé la Russie de ses dizaines de millions d’ouvriers, de paysans et de fonctionnaires, à tel point que la peste a semblé balayer périodiquement le pays. En quête de leur plan, ils ont enfermé, des millions d’hommes dans des camps de concentration, et comptent les y garder.
Leur dessein est celui de planifier. Et ils mèneront leur plan à terme ou, comme les nazis, se laisseront eux-mêmes enfouir sous les ruines de l’Europe. Mais cela encore, en soi, n’aurait pas déclenché de crise internationale. Ce qui la déclenche, c’est le fait que dans toutes sortes de pays, du plus développé au plus arriéré, se sont levées des dizaines de milliers d’hommes instruits, administrateurs, gestionnaires, intellectuels, leaders ouvriers, leaders nationalistes, prêts à faire dans leur pays exactement ce que les communistes font en Russie et qui voient la Russie comme leur patrie. Le problème est là. Et il n’est débat plus futile que celui qui oppose Démocrates et Républicains se rejetant la responsabilité politique de la Chine devenue communiste. Personne n’aurait rien pu faire pour empêcher cela. La folie se déploie irrésistiblement.
Simplement, tout comme la théorie de la race supérieure et le développement de l’économie nationale sont deux aspects inséparables de l’État national, ainsi le nazisme et le communisme sont d’inséparables aspects de la dégénérescence de l’Europe. Bien qu’ils soient d’origine différente, les communistes russes appliquent aujourd’hui dans leurs états satellites d’Europe l’idéologie nazie de race supérieure sous un fin déguisement. Si Hitler avait vaincu et survécu, il aurait fini par adopter une forme du plan communiste.
Nous pouvons maintenant voir Achab, incarnation du type totalitaire, dans toute son envergure. Son dessein clairement sous les yeux, seules deux choses le concernent désormais : 1/ la science, ou la gestion des choses ; et 2/ la politique, ou la gestion des hommes.
Dans un magnifique chapitre intitulé « La Carte », Melville nous montre Achab, l’homme résolu, au travail. Il a sous son seul commandement un baleinier qui se trouve être technologiquement un des plus développés de l’époque. Il a catalogué dans son esprit tout le savoir scientifique de la navigation accumulé à travers les siècles.
C’est pourquoi il est une menace si sérieuse. Son dessein peut bien être fou, les armes qu’il utilise pour l’atteindre sont parmi les réalisations les plus avancées du monde civilisé, et tel dessein donne à sa grande intelligence une maîtrise sur eux et une puissance jamais obtenues auparavant. La nuit, il s’assied seul devant ses cartes. Il connaît « la direction des courants et des marées », « les déplacements de la nourriture du cachalot ». Il a de vieux livres de bord qui lui disent où Moby Dick a été vu par de précédents voyageurs. Alors, de son crayon, il trace des lignes sur ses cartes. Et pendant qu’il écrit sur le papier, de même apparaissent des lignes de souci et de concentration sur son front.
C’est trop pour un seul homme ou un seul corps d’hommes. Parfois, tard dans la nuit, la folie d’Achab semble le terrasser. Il se lève et se rue hors de sa cabine. Mais ce n’est pas une folie que pourrait guérir un médecin. Ce qui se rue alors, selon Melville, c’est son humanité ordinaire fuyant le monstre qui l’a dominée. Achab est ainsi « une chose vide, un être informe, somnambule, un rai de lumière vive, certes, mais qui n’[a] nul objet à colorer, et donc un néant. » Sans plus d’humanité, seules resteraient l’intelligence abstraite, la science abstraite, la technologie abstraite, vives mais vides, au service non plus d’un dessein humain mais simplement d’un même dessein abstrait.
Achab doit gérer les choses, et il doit gérer les hommes. « Pour parvenir à ses fins, Achab [a] besoin d’outils ; et de tous les outils dont on use dans notre monde sublunaire, les plus sujets au dérèglement sont les hommes. »
Melville poursuit son analyse d’Achab avec la méthode établie au début. Il est par nature une personnalité dictatoriale. Mais cela ne fait pas de lui un dictateur. C’est le fait qu’il ait été aux commandes si longtemps, qu’il ait appris les usages du commandement en mer, qui le pousse à créer une dictature. Donnez-lui maintenant un dessein, et ses éminentes compétences, et vous avez la base de ce que Melville appelle la « formidable concentration » du pouvoir.
Telle analyse a pu être écrite hier, mais le problème d’Achab est incroyablement contemporain. Il est clairement dit que, à partir du moment où Achab a déclaré un objectif de voyage différent de celui pour lequel ils ont signé, les hommes ont légalement le droit de se révolter et prendre eux-mêmes possession du navire. Mais plus importante encore est sa propre conception des hommes, et cela, comme tout ce qui le concerne, est le résultat de plusieurs années de commandement. L’équipage n’est pas composé d’êtres humains mais de choses, comme il dit, des « hommes manufacturés »4. Selon lui, leur « condition permanente […] est la sordidité ». Temporairement, il les arrache à eux-mêmes, en campagne pour l’accomplissement de son dessein. Même alors, il les soudoie d’un doublon (destiné à l’homme qui verra le premier la Baleine blanche), de grog et de rituel. Mais il sent ensuite qu’il doit encore dissimuler son dessein. Et il se replie à nouveau sur la mission du Pequod comme étant strictement commerciale. Nous verrons plus tard les autres méthodes utilisées pour dominer. Pour l’instant, il se concentre sur leur sordidité, leur incapacité à répondre à autre chose qu’aux plus basses motivations. Son grand dessein est en réalité pour lui seul, non pour eux. De même, si nous lisons avec attention la propagande d’Hitler et de Staline, nous verrons un dessein façonné pour s’adapter aux hommes manufacturés. La race supérieure et l’économie planifiée y deviennent affaire d’espace vital, de défense contre des ennemis belliqueux, de sang pur, de sexe, de niveau de vie sur le plan de l’estomac. Là encore, tous deux ont seulement fait remonter à la surface ce qui, pendant des siècles, a été l’attitude d’individus instruits envers les masses avec lesquelles ils vivaient.
Voilà qui est Achab — jusque-là. Évidemment, personne comme lui n’a jamais existé. Il est, comme Hamlet, Don Quichotte ou le Satan du Paradis perdu de Milton, une création de l’esprit de son auteur, basée sur des observations de la vie ; mais l’histoire a montré qu’un tel personnage nous est plus réel que quiconque parmi nos connaissances. Nul doute que, les Européens ou les Asiatiques d’aujourd’hui, qui auront lu Moby Dick, le reconnaîtront et ne l’oublieront plus. Nous montrerons plus tard comment il fut possible pour un écrivain américain de faire, dès 1851, le portrait du type totalitaire.
La question qui se pose alors d’elle-même au lecteur aujourd’hui est la suivante : si Melville a clairement vu les cadres, les directeurs, les administrateurs, les leaders populaires, dans leur évolution vers le type totalitaire, comment, en 1851, a-t-il vu le peuple ordinaire que ces monstres jettent aux chaînes, exploitent, corrompent et ruinent définitivement ? La réponse est double.
Melville est d’abord aussi clair que le jour sur cette question, beaucoup plus clair qu’il ne l’est sur Achab.
Mais il sent par la suite que là précisément se trouve son problème. Il doutait beaucoup d’être compris. Et ne s’est certainement épargné aucun effort pour se rendre clair dès le début.
Avant même qu’il ne commence à nous dire ce que le capitaine Achab représente, il décrit les officiers et l’équipage du Pequod en deux chapitres, portant le même titre, « Chevaliers et écuyers. »
Le premier chapitre commence par Starbuck. Comme Achab, il vient de la Nouvelle-Angleterre. C’est un homme de principes, de hautes qualités morales, brave et compétent. Mais dans le même temps, Melville montre comment cet homme moralement lâche est certain d’échouer face à la force de caractère d’Achab et à son puissant dessein. Melville s’attriste de la perte de dignité d’un être humain, ce qui sera le destin de Starbuck. Puis, brusquement, il se lance dans un panégyrique totalement inattendu du travailleur « qui manie la pioche et enfonce le clou. » Il semble un instant avoir oublié Starbuck et se hâte de décrire le rôle que l’ouvrier, c’est-à-dire l’équipage, jouera dans son livre.
Dès lors, si je pare les plus misérables marins, les renégats et autres [parias], des plus hautes vertus, fussent-elles d’un sombre éclat ; si je les revêts de grâces tragiques ; si le plus triste d’entre eux, qui pourrait bien être le plus vil, s’élève parfois jusqu’aux plus sublimes hauteurs ; si je fais tomber sur le bras de cet ouvrier un rayon de lumière céleste, et déploie un arc-en-ciel dans le crépuscule de son désastre — alors soutiens-moi dans mon entreprise contre la critique des hommes, Esprit de l’Égalité, Toi le juste, qui as étendu un royal manteau d’humanité, un seul, sur tous mes semblables !
Il prend John Bunyan, auteur du Voyage du pèlerin, et Cervantès, auteur de Don Quichotte, comme exemples d’hommes ordinaires qui ont été choisis pour leur grandeur par le Dieu de la Démocratie et de l’Égalité. Puis, il place Andrew Jackson5 au sommet. « Toi qui as ramassé Andrew Jackson au bord d’un chemin pour le jeter sur un cheval de guerre et l’élever, dans un fracas de tonnerre, sur un trône plus haut que tous les trônes ; Toi qui, au cours de Tes puissants passages sur terre, choisis invariablement l’élite de Tes champions parmi la plèbe royale — ô Dieu, soutiens-moi dans mon entreprise ! »
Le lecteur ne peut s’empêcher de trouver ce passage maladroit. Melville a clairement l’intention de faire des hommes de l’équipage les véritables héros de son livre, mais il craint la critique. Le chapitre suivant, lequel, assez curieusement, porte le même titre que celui que nous venons d’examiner, nous éclairera davantage.
Melville délaisse les misérables marins, renégats et autres parias, et retourne vers les officiers. Il décrit maintenant Stubb, le premier lieutenant. C’est un homme qui rit de tout. Puis vient Flask, le second lieutenant, qui n’a d’ailleurs aucun caractère. Mais, comme Starbuck, ce sont des hommes de la Nouvelle-Angleterre et des hommes de grand courage, de grande compétence et de grande sobriété.
Puis, nous sont présentés (de façon systématique) les trois harponneurs. Il y a d’abord un cannibale des mers du Sud, Quiqueg de son nom ; le second, Tashtego, un Indien de Gay-Head dans le Massachusetts ; et le troisième est Daggou, un nègre gigantesque des côtes africaines. Ce sont tous des hommes au physique magnifique, à l’éblouissante habileté et à la saisissante personnalité. Il est vrai que les harponneurs d’origine sauvage n’étaient pas inconnus dans la pêche à la baleine à cette époque, mais il est certainement peu commun de compter trois harponneurs sauvages sur un même bateau, chacun d’eux représentant une race primitive.
L’équipage est la preuve définitive que Melville compose un échantillon strictement logique. Ils forment une bande de loqueteux recueillis par hasard aux quatre coins de la terre. Il nous dit qu’en 1851, alors que les officiers blancs américains fournissent les cerveaux, moins d’un sur deux parmi les milliers d’hommes dans la pêcherie, l’armée, la marine et les forces d’ingénierie employées à la construction des canaux et des routes américaines, sont des Américains. Ils viennent du monde entier, d’îles comme les Açores ou les Shetland. Presque tous les hommes du navire d’Achab sont des insulaires, et de fait, presque toutes les nations du globe y sont représentées. Melville les appelle des Isolés6, refusant toute appartenance au continent de la communauté humaine, chaque Isolé vivant à l’écart des autres, sur son propre continent.
Mais à présent, fédérés par le bois d’une quille unique, quel ensemble formaient ces Isolés ! Une délégation digne de celle d’Anacharsis Cloots7, venue de toutes les îles de la mer et de tous les confins de la terre présenter aux côtés du vieil Achab, à bord du Pequod, les doléances du monde devant ce tribunal d’où bien peu reviennent.
Puis, conclusion étonnante d’un étonnant chapitre, Melville nous signifie par ce rapide exposé que celui qui est au plus bas de l’échelle s’élèvera de lui-même jusqu’au plus haut rang. Au plus bas de l’équipage à bord se trouve Pip, un petit nègre de l’Alabama, le dernier des derniers dans l’Amérique de 1851. C’est Pip qui, à la fin, sera salué comme le plus grand héros de tous.
Jusqu’à aujourd’hui, les gens ont lu ces chapitres sans les comprendre. Mais dès lors qu’ils seront lus et acceptés, alors très vite le livre lui-même sera considéré pour ce qu’il est, c’est-à-dire pour la plus grande œuvre jamais conçue qui peigne le monde moderne, notre monde, tel qu’il est, et ce qui l’attend. Le voyage du Pequod est le voyage de la civilisation moderne à la recherche de sa destinée.
Postface pour une révolution : C.L.R. James lecteur de Melville
Dans Nkrumah and the Ghana Revolution, ouvrage publié en 1977 à Londres, mais dont la plus grande partie fut rédigée en 1958, au lendemain de l’indépendance du Ghana, l’historien et théoricien marxiste trinidadien C.L.R. James cite Jules Michelet dans la préface à son Histoire de la Révolution française :
Une autre chose que cette histoire mettra en grande lumière, et qui est vraie de tout parti, c’est que le peuple vaut généralement beaucoup mieux que ses meneurs. Plus j’ai creusé, plus j’ai trouvé que le meilleur était dessous, dans les profondeurs obscures. J’ai vu aussi que ces parleurs brillants, puissants qui ont exprimé la pensée des masses, passent à tort pour les seuls acteurs. Ils ont reçu l’impulsion bien plus qu’ils ne l’ont donnée. L’acteur principal est le peuple. Pour le retrouver, celui-ci, le replacer dans son rôle, j’ai dû ramener à leurs proportions les ambitieuses marionnettes dont il a tiré les fils, et dans lesquelles, jusqu’ici, on croyait voir, on cherchait le jeu secret de l’histoire8.
On ne saurait formuler meilleure introduction à la théorie de la révolution élaborée par James lui-même et qui acquit sa forme presque définitive au terme de son expérience états-unienne (1938-1953) au cours de laquelle, en rupture progressive avec le mouvement trotskiste américain, il se livra à une critique radicale du « parti d’avant-garde » pour (re)mettre au premier plan les processus d’auto-émancipation des masses. S’il n’eut de cesse d’interroger le rôle des « grands individus » dans l’histoire, ce dont témoigne la place centrale occupée par l’écriture biographique dans sa pratique-méthode historiographique9, James forgea peu à peu l’idée que le véritable mérite des grands dirigeants révolutionnaires, au premier rang desquels à ses yeux Lénine, était d’être parvenus à se faire eux-mêmes pure chambre de résonance des aspirations les plus profondes des masses, vecteur du mouvement révolutionnaire qu’elles-mêmes s’étaient données.
Dans la bibliographie adjointe aux rééditions successives de sa fameuse histoire de la révolution haïtienne, Les Jacobins noirs : Toussaint Louverture et la révolution de Saint-Domingue10 (1938), James fait l’éloge de « l’école française d’histoire de la Révolution », qui a su combiner un « haut niveau universitaire avec l’esprit et le goût national ». Il conseille à son lecteur les ouvrages de Jean Jaurès, Albert Mathiez et Georges Lefebvre — l’« inventeur » de la notion d’histoire par le bas — dont La Révolution française « représente le couronnement de cette œuvre de près d’un siècle ». Mais le meilleur est pour James aux commencements : « [l]e plus grand de tous ces historiens est Michelet, qui conçut son œuvre il y a plus de cent ans. […] Il ne traite guère de la question coloniale, mais je suis convaincu que bien des pages de Michelet forment la meilleure introduction possible à la compréhension de ce qui s’est vraiment passé à Saint-Domingue »11.
En marge de cet héritage revendiqué, il existe une relation plus secrète entre James et l’auteur de l’Histoire de la Révolution française. En effet, en 1861, Michelet avait publié un singulier essai d’histoire naturelle, aujourd’hui méconnu, intitulé La Mer, dans lequel, esquissant une réécriture de l’histoire des grandes découvertes, la « conquête de la mer », il déclarait : « Qui a ouvert aux hommes la grande navigation ? qui révéla la mer, en marqua les zones et les voies ? enfin qui découvrit le globe ? La baleine et le baleinier. Tout cela bien avant Colomb et les fameux chercheurs d’or, qui eurent toute la gloire, retrouvant à grand bruit ce qu’avaient trouvé les pêcheurs ». Les grands explorateurs ne sont pas ceux que l’on croit : ce sont, de concert, ce géant marin qu’est la baleine, à laquelle il consacre un chapitre entier, et les téméraires peuples de pêcheurs anonymes : « Scandinaves », « Basques », « Bretons », « Normands ». Pour Michelet, qui parle depuis le milieu du XIXe siècle, cet âge d’or de la pêche à la baleine est malheureusement révolu : « Noble guerre, grande école de courage. Cette pêche n’était pas comme aujourd’hui un carnage facile qui se fait prudemment de loin avec une machine : on frappait de sa main, on risquait vie pour vie. On tuait peu de baleines, mais on gagnait infiniment en habileté maritime, en patience, en sagacité, en intrépidité. On rapportait moins d’huile et plus de gloire »12.
Cependant, qu’aurait dit Michelet, demande Carl Schmitt dans son essai Terre et mer (1954), s’il avait assisté à l’extrême industrialisation de l’extraction d’huile de baleine après la Première guerre mondiale ? À partir de cette date, dit Schmitt, la chasse à la baleine se transforma en pur jeu de massacre, recouvrant d’un épais voile la glorieuse époque où elle était encore un combat d’égal à égal, fait de complicité et d’hostilité entremêlées, une dangereuse confrontation entre deux créatures, humaine et animale, partageant un même élément, la mer. Or, pour Schmitt, le grand poète de cette relation quasi personnelle, disparue à jamais, entre l’homme, armé de son seul harpon, et le Léviathan, demeure Herman Melville, dont le Moby Dick13 avait été publié un siècle plus tôt, en 1851, dix ans avant La Mer de Michelet : Melville, affirme Schmitt, était au monde des océans ce qu’Homère avait été à la Méditerranée orientale14.
Schmitt ignorait à coup sûr qu’un peu avant la publication de Terre et mer, en 1952, un intellectuel caribéen du nom de C.L.R. James, lui aussi grand admirateur de Melville, avait rédigé depuis la prison d’Ellis Island aux États-Unis un livre consacré à l’auteur de Moby Dick, distribué de manière confidentielle l’année suivante sous le titre Marins, renégats & autres parias : L’histoire d’Herman Melville et le monde dans lequel nous vivons15, et qu’on peut concevoir, a posteriori, comme une radicale alternative au point de vue schmittien sur l’« histoire mondiale », à sa mythologie politique fondée sur la lutte immémoriale entre puissances terrestres et puissances maritimes. Car loin de voir en Melville l’illustre représentant d’un âge héroïque, passé, où la chasse à la baleine était encore étrangère à l’emprise de la rationalité technique et scientifique, James fait au contraire de lui « le poète de la civilisation industrielle » par excellence. Dans Moby Dick, Melville donne à voir « la conversion du navire en usine » : « Le baleinier est aussi une usine […]. C’est véritablement une industrie moderne » (p. 7916). En effet, Melville a compris, dit James, que cette société flottante renfermait, en miniature, toutes les tensions et contradictions de la « civilisation mondiale », qu’elle préfigurait les mutations des relations de production à l’échelle mondiale, sur mer et sur terre. Il a vu le terrifiant devenir de cette civilisation, son inexorable futur, lequel n’est rien d’autre que « le monde dans lequel nous vivons », celui-là même qui constitue selon Schmitt l’antithèse du monde de Moby Dick : « Le voyage du Pequod, écrit James, est le voyage de la civilisation moderne à la recherche de sa destinée » (p. 39). Mais pénétrer plus avant la signification politique, historique et littéraire fondamentale que James confère à l’œuvre de Melville, exige d’en revenir aux origines même de son interprétation, c’est-à-dire à sa découverte de l’Amérique.
—
En 1938, James embarque pour les États-Unis depuis l’Angleterre où il vient de passer six années (il avait quitté Trinidad en 1932) d’une rare intensité. Il y a fait ses classes en matière de théorie marxiste, est devenu une figure de premier plan du mouvement trotskiste britannique et a signé un ouvrage remarqué : World Revolution : The Rise and Fall of the Third International17. Parallèlement et à la suite de l’invasion de l’Abyssinie (Éthiopie) par Mussolini, il a été l’un des tout principaux acteurs du mouvement panafricaniste londonien — aux côtés de son ami d’enfance Georges Padmore qui venait de rompre avec le Kominterm —, il a composé une pièce de théâtre sur le dirigeant révolutionnaire haïtien Toussaint Louverture18, suivie de la rédaction des Jacobins noirs ainsi que d’un petit livre intitulé Histoire des révoltes panafricaines19.
Invité aux États-Unis par le Socialist Workers Party, James fait une tournée de conférences à travers le pays avant de rendre visite à Trotsky à Mexico où les deux hommes s’entretiennent longuement de la « question noire » américaine. De retour aux États-Unis, il s’impose comme le représentant majeur de ce qui allait plus tard être baptisé du nom de Black Marxism, tout en s’engageant dans les débats qui traversent, et scindent littéralement, le mouvement trotskiste américain, en premier lieu la question de la nature de l’Union soviétique — James opposant bientôt à la thèse trotskiste « orthodoxe » de l’État ouvrier (bureaucratiquement) dégénéré l’idée que règne en URSS un capitalisme d’État. S’efforçant de clarifier les conditions et les méthodes de construction d’une organisation révolutionnaire marxiste aux États-Unis, James insiste sur l’impérieuse nécessité, pour « bolcheviser l’Amérique », d’« américaniser le bolchevisme », autrement dit, dans ses termes, de le traduire pour les masses américaines, comme Lénine avait su le faire en Russie, une telle nationalisation du marxisme n’étant nullement une négation de l’universalité de ses lois, mais, au contraire et en accord avec une dialectique que James n’allait cesser d’explorer, la condition de possibilité d’un internationalisme digne de ce nom20.
Cette exigence de traduction, aux implications non seulement pratiques-stratégiques mais aussi proprement théoriques, est étroitement liée à l’importance capitale que revêtent aux yeux de James les « luttes indépendantes » des Noirs des États-Unis dans la perspective de la révolution socialiste. Elle n’est pas non plus étrangère à la position d’outsider qui est alors la sienne aux États-Unis — c’est aussi le cas de ses deux principales collaboratrices au sein de la Johnson-Forest Tendency : Raya Dunayevskaya, émigrée russe, et Grace Lee Boggs, Américaine d’origine chinoise21 — et plus précisément, comme il allait l’avouer, à sa condition de sujet de l’Empire britannique, de colonisé : « Depuis le premier jour de mon séjour aux États-Unis jusqu’au dernier, je n’ai jamais fait l’erreur que de nombreux Européens, intelligents par ailleurs, ont faite en essayant de faire correspondre ce pays aux standards européens. Pour une raison peut-être — à cause de mon expérience coloniale — je l’ai toujours vu pour ce qu’il était et non pour ce que je pensais qu’il devrait être »22.
Américaniser le bolchevisme requerrait de plonger ce dernier dans l’histoire américaine, de refaire en somme sur l’autre rive de l’Atlantique le travail monumental qu’avaient réalisé Marx et Engels à partir de l’histoire de l’Europe. Il s’agissait de confronter les « principes » du marxisme aux grands épisodes de l’histoire américaine, au premier rang desquels selon James la guerre civile et la lutte pour l’abolition de l’esclavage, dans lesquels les Noirs avaient occupé, en tant que sujets, une place centrale. Américaniser le bolchevisme signifiait plus largement se consacrer à une étude approfondie de la civilisation américaine en tant que création originale, irréductible au destin de l’Europe. C’est à ces tâches que James, en marge, sinon en dehors, de ses activités au sein des organisations révolutionnaires, se consacre pendant ses années américaines. L’aboutissement, provisoire, de ce colossal effort est un long manuscrit rédigé en quelques mois entre 1949 et 1950, intitulé Notes on American Civilization — publié pour la première fois en 1993 sous le titre American Civilization — dans lequel James, en écho à la Déclaration d’indépendance américaine, institue la « lutte pour le bonheur » (struggle for happiness) — « bonheur » étant pour lui synonyme d’intégration mutuelle de l’individu et de la société — en telos de la nation américaine.
Cette lutte, telle qu’elle se déroule au XXe siècle, ne se manifeste nulle part plus intensément, selon James qu’au sein des arts populaires : cinéma, soap operas, comic strips, romans de détective, jazz, etc. Loin de n’être que le médium de la (re)production de mécanismes d’assujettissement des masses, perçues comme fondamentalement passives à leur égard, ces arts en expriment activement, quoique non sans ambivalence et sans limitation, les désirs et les frustrations les plus profonds. Ils le font bien mieux que les œuvres des grands écrivains contemporains (Hemingway, Faulkner, T.S. Eliot, etc.) que James soumet à une critique qui atteint son paroxysme dans une lettre adressée à un certain Bell en 1953, dans laquelle il fustige les intellectuels américains qui se font les défenseurs de la culture européenne contre les masses américaines : « Aujourd’hui en 1953, la culture européenne, comme la civilisation européenne et de fait la civilisation occidentale tout entière, est arrivée à une impasse. Elle n’a plus rien à dire. Et les écrivains et artistes américains, comme leurs alter ego à l’étranger, n’ont rien à dire »23.
Dans American Civilization, James avait localisé la source de cette aliénation des intellectuels à l’égard des masses dans la littérature du siècle passé, allant jusqu’à déclarer que « l’art américain, depuis ses débuts jusqu’aujourd’hui, [est] resté séparé de tout courant significatif dans la vie moderne ». Pourtant, reconnaît-il, les intellectuels américains du XIXe siècle ont bel et bien dit quelque chose d’essentiel à propos de la civilisation américaine dans la mesure où ils ont affronté un problème dont l’entière signification s’est révélée à partir des années 1930, le problème des relations entre individualisme et démocratie : « Les questions et les problèmes posés par Whitman, Melville et Poe trouvent leur réponse non chez T.S. Eliot et Hemingway mais dans les arts populaires du peuple américain »24. Du Moby Dick de Melville — qu’il nomme, nous comprendrons bientôt pourquoi, le « prophète de la destruction » — James dit qu’« il s’impose comme un produit de la civilisation américaine qui ne pouvait être produit qu’en Amérique et qui demeure inégalé dans toute la littérature du XIXe siècle »25. On comprend alors la raison pour laquelle, dans les dernières pages de Marins, renégats & autres parias, il allait pouvoir résumer le projet intellectuel et politique dans lequel s’inscrit son interprétation de Melville, en ces termes : « mon intention finale, et mon livre sur Melville en est simplement le prélude, était d’écrire une étude de la civilisation américaine » (p. 263).
Mais la genèse de Marins, renégats & autres parias est également étroitement liée à la trajectoire personnelle de James. Migrant illégal aux États-Unis depuis de nombreuses années, qui plus est engagé dans des activités politiques « subversives », James reçoit en 1948 un ordre d’expulsion des services d’immigration et de naturalisation (Immigration and Naturalization Service). En 1952, en plein maccarthysme, il est arrêté sur la base du McCarran Immigration Bill et transféré à la prison d’Ellis Island. C’est pendant les quatre mois de son séjour carcéral qu’il rédige la plus grande partie de son livre sur Melville, dans l’introduction duquel il confie l’influence capitale qu’a eue l’expérience de sa détention sur sa « compréhension de Melville » (p. 14). L’écriture de l’ouvrage participe en outre très directement de la « stratégie de défense » de son auteur : il s’agit pour James de démontrer à ceux qui l’ont condamné sa maîtrise d’une œuvre considérée comme fondatrice de la littérature nationale américaine. Dès la rédaction du manuscrit achevée, James — dont on peut se demander quels réels espoirs il entretenait réellement en agissant de la sorte — en fait parvenir des copies aux membres du Congrès des États-Unis, ainsi qu’à d’autres personnes susceptibles d’intercéder en sa faveur. C’est un échec : son appel est rejeté et il est expulsé du pays en 1953.
La facture éminemment personnelle et politique de l’interprétation jamesienne de Melville ne signifie nullement que celle-ci soit purement idiosyncratique. C’est bien plutôt le contraire qui est vrai. La conception de Marins, renégats & autres parias doit en effet être resituée dans le cadre de la « renaissance » de Melville au xxe siècle, un engouement — pour Moby Dick par-dessus tout, l’heure de gloire de Bartelby le scribe viendra bien plus tard — qui, sur le plan académique tout du moins, atteint son apogée au lendemain de la Seconde Guerre Mondiale. James a lu les grands interprètes de Melville de l’époque. À la fin de Marins, renégats & autres parias, il recommande la lecture de The Melville Log : A Documentary Life of Herman Melville de Jay Leyda (1951), du Herman Melville de Leon Howard (1952) ainsi que de Melville’s Quarrel with God de Lawrance R. Thompson (1952). Il connaît également les travaux de Henry A. Murray dont nous allons reparler, ainsi que l’important livre de Francis Otto Matthiessen, American Renaissance (1941), dont le troisième chapitre était consacré à Melville et qu’il évoque brièvement dans American Civilization en le décrivant comme « une étude très fine et d’esprit libéral de la littérature américaine au xixe siècle »26. James se révèle particulièrement soucieux de s’établir, fût-ce à contre-courant, dans le champ de la théorie littéraire, ainsi que le prouve sa correspondance, en particulier une lettre, datée du 7 mars 1953, adressée à Jay Leyda et qui débute par ces questions : « Que pensez-vous exactement de mon livre ? Vous le louez pour son feu et sa force ; mais vous ajoutez que le feu ne doit pas chasser la logique. Vous vous arrêtez là. Où se situe la faiblesse de ma logique ? »27.
Dans cette même lettre, James se montre pour le moins virulent à l’égard des « écoles critiques dominantes, et en particulier des melvilliens », et n’hésite pas à déclarer que si son interprétation de Melville est juste, c’est qu’« il y a quelque chose de terriblement erroné chez les autres »28. Il prend explicitement pour cible les lectures inspirées par la « critique sociale communiste » et la psychanalyse, mais il se révèle de fait bien plus avenant lorsqu’il aborde une autre interprétation, celle proposée par Murray dans son introduction à l’édition américaine de 1949 de Pierre, ou les ambiguïtés. Murray, dans un passage cité par James, affirmait que Moby Dick constituait « la plus superbe prophétie de l’essence du fascisme que la littérature ait produite », le capitaine Achab représentant les forces qui, « rendues barbares du fait de leur répression, étaient tapies dans le cœur de l’homme occidental, attendant l’heure de leur éruption »29. Le seul reproche, mais on verra qu’il est de taille, que James adresse alors à Murray est d’avoir donné l’impression qu’Achab était une figure générique, un « représentant de la nature humaine universelle » plutôt qu’une créature située très précisément d’un point de vue historique.
Ce que ne dit pas James, c’est que Murray s’inscrivait de facto dans une autre « école », même si elle ne s’affichait pas comme telle, au sein de laquelle s’était développée une interprétation de Moby Dick devenue canonique au lendemain de la Seconde Guerre Mondiale et qui opposait au désir totalitaire du capitaine Achab, produit d’un individualisme poussé jusqu’à ses plus extrêmes limites, le pluralisme démocratique, et spécifiquement américain, du narrateur Ismaël, son antithèse incarnée. Ainsi que l’écrit Donald Pease dans sa préface à Marins, renégats & autres parias : « les chercheurs américanistes du rang de F. O. Matthiessen et Richard Chase ont élevé Moby Dick au statut de fiction fondatrice de la situation de Guerre Froide. Chase et Matthiessen ont encouragé une compréhension allégorique de Moby Dick faisant de la monomanie de Achab le symbole de l’Autre totalitaire en opposition auquel était définie, élaborée et défendue l’américanité d’Ismaël »30.Qu’elles se soient réclamées du libéralisme ou du conservatisme, ces interprétations de Moby Dick répondaient aux impératifs idéologiques de la situation de Guerre Froide. Comment James allait-il se positionner par rapport à cette approche critique lui qui était une victime très concrète de l’hystérie anticommuniste qui s’était emparée des États-Unis ?
à voir aussi
références
| ⇧1 | Cette tirade est située dans le livre juste avant les trois derniers chapitres du roman, ceux de la confrontation avec Moby Dick. |
|---|---|
| ⇧2 | La loi de McCarran-Walter, appelée aussi loi sur l’immigration et la nationalité, est une loi de 1952 qui posa de lourdes restrictions à l’entrée des immigrés aux États-Unis ; des quotas étant institués selon le pays d’arrivée. D’autre part, la loi a servi à exclure de nombreux individus pour des raisons idéologiques, tels que, à l’instar de C.L.R. James, Julio Cortázar, Mahmoud Darwish, Dario Fo, Gabriel García Márquez, Pablo Neruda, Graham Greene, Doris Lessing, Michel Foucault, Kobo Abe, Carlos Fuentes et d’autres… |
| ⇧3 | Il s’agit de l’essai Hawthorne et ses « Mousses ». |
| ⇧4 | Notre traduction pour « manufactured man », dans la phrase suivante de Melville : « The permanent constitutional condition of the manufactured man, thought Ahab, is sordidness. » |
| ⇧5 | Andrew Jackson (1767-1845) : héros national qui gagna la bataille de la Nouvelle-Orléans contre les Anglais en 1815, puis qui devint le septième Président des États-Unis en 1829. Il dirigea alors le pays de façon autocratique. |
| ⇧6 | « Isolés » traduit « Isolatoes » qui, en anglais, fait aussi référence à l’insularité, en écho au passage célèbre du poète John Donne : « No man is an island » (« Nul homme n’est une île ») Selon les notes de l’édition de la Pléiade, la traduction de Isolatoes par Isolés est empruntée à Victor Hugo, qui utilise ce mot dans Les Travailleurs de la mer. |
| ⇧7 | Jean-Baptiste Cloots dit Anacharsis, baron de Cloots (1755-1794) : enthousiasmé par les idées de la Révolution française, le baron de Cloots, d’origine prussienne, se présenta devant l’Assemblée constituante le 19 juin 1790 à la tête d’une délégation formée d’hommes de toutes nationalités qu’il avait rassemblés dans les rues de Paris. Accusé par Robespierre d’être un espion étranger, Cloots fut arrêté, condamné à mort et guillotiné. |
| ⇧8 | Jules Michelet, Histoire de la Révolution française, Robert Laffont, Paris, 1979, « Préface de 1847 », p. 37. Voir C.L.R. James, Nkrumah and the Ghana Revolution, Allison and Busby, Londres, 1977, pp. 105-106. |
| ⇧9 | Pour se limiter à un seul exemple, la première œuvre politique de James, écrite avant son départ de Trinidad pour l’Angleterre en 1932, fut une biographie du leader de la Trinidad Workingmen’s Association, le Capitaine Cipriani, à travers laquelle il s’agissait de plaider pour l’autonomie (self-government) des Antilles britanniques (C.L.R. James, The Life of Captain Cipriani: An Account of British Government in the West Indies, Duke University Press, Durham, 2014). |
| ⇧10 | C.L.R. James, The Black Jacobins: Toussaint Louverture and the San Domingo Revolution, Secker & Warburg, Londres, 1938. La première traduction française, réalisée par Pierre Naville, a été publiée en 1949 aux éditions Gallimard. Pour les nouvelles éditions voir note 39 p. 254. |
| ⇧11 | C.L.R. James, « Bibliographie établie par C.L.R. James », dans Les Jacobins noirs : Toussaint Louverture et la révolution de Saint-Domingue, Éditions Amsterdam, Paris, 2008, pp. 391-392. |
| ⇧12 | C.L.R. James, « Bibliographie établie par C.L.R. James », dans Les Jacobins noirs : Toussaint Louverture et la révolution de Saint-Domingue, Éditions Amsterdam, Paris, 2008, pp. 391-392. |
| ⇧13 | La première traduction française par Lucien Jacques, Joan Smith et Jean Giono paraît chez Gallimard en 1941. |
| ⇧14 | Carl Schmitt, Terre et mer : Un point de vue sur l’histoire mondiale, Paris, Éditions du Labyrinthe, Paris, 1985. |
| ⇧15 | C.L.R. James, Mariners, Renegades and Castaways. The Story of Herman Melville and the World We Live In, privately printed, New York, 1953. Rééditions à Londres par Allison & Busby en 1984, à Hanover et Londres par University Press of New England en 2001. |
| ⇧16 | Toutes les références de pages dans le corps de l’article renvoient à la présente édition de Marins, renégats & autres parias de C.L.R. James. Sur le navire de Moby Dick en tant que symbole de l’industrie américaine, voir également Ronald Mason, The Spirit Above the Dust: A Study of Herman Melville, J. Lehman, Londres, 1951. |
| ⇧17 | C.L.R. James, World Revolution: The Rise and Fall of the Third International, 1917-1936, Secker & Warburg, Londres, 1937. Nouvelle édition chez Humanities Press, New Jersey, 1993. |
| ⇧18 | C.L.R. James, Toussaint Louverture: The Story of the Only Successful Slave Revolt in History, Duke University Press, Durham, 2013. La première représentation de la pièce a eu lieu en 1936 au Westminster Theatre de Londres avec dans le rôle de Toussaint Louverture l’acteur africain-américain Paul Robeson. |
| ⇧19 | C. L. R. James, A History of Negro Revolt, Fact monograph n. 18, London, 1938. Nouvelle édition revue et corrigée sous le titre A History of Pan-African Revolt, Drum and Spear Press, Washington, 1969. Traduction française à paraître en 2016 aux éditions Les Prairies ordinaires. Ici notre traduction. |
| ⇧20 | C.L.R. James, « The Americanization of Bolshevism » [1944] in Marxism for Our Times: C. L. R. James on Revolutionary Organization (éd. Martin Glaberman), University Press of Mississipi, Jackson, 1999. |
| ⇧21 | Dans ses conférences et écrits des années 1960-1970 et en relation étroite avec le problème de la formation d’une culture nationale dans la Caraïbe, James allait à maintes reprises insister sur le rôle fondamental joué par les outsiders dans le développement des littératures « nationales » : ainsi par exemple d’Alexandre Dumas et de Jean-Jacques Rousseau pour la littérature française ou de Jonathan Swift, Joseph Conrad et, au présent, des écrivains caribéens (George Lamming, V.S. Naipaul, Wilson Harris) pour la littérature « anglaise » : « Les principaux écrivains sont des étrangers » (C.L.R. James, « A National Purpose for Caribbean Peoples » [1964] in At the Rendezvous of Victory: Selected Writings, Allison and Busby, Londres, 1984, p. 148). |
| ⇧22 | C.L.R. James. American Civilization (éd. Anna Grimshaw et Keith Hart), Blackwell Publishers, Cambridge et Oxford, 1993, p. 13. |
| ⇧23 | C.L.R. James, lettre à Daniel Bell (juin 1953) in « Letters to Literary Critics » in The C.L.R. James Reader (éd. Anna Grimshaw), Blackwell Publishers, Cambridge et Oxford, 1992, pp. 220-231. |
| ⇧24 | C.L.R. James. American Civilization, op. cit., pp. 35, 37. Il est à cet égard significatif que James mette en relation le Moby Dick de Melville avec les arts populaires du xxe siècle : « Je suis convaincu […] que Moby Dick est par essence un scénario de film » (ibid., p. 129) ; ou encore, à propos d’un passage du roman : « Presque chaque phrase peut être le sujet d’un comic strip » (p. 21). |
| ⇧25 | C.L.R. James. American Civilization, op. cit., p. 35. |
| ⇧26 | C.L.R. James. American Civilization, op. cit., p. 258. |
| ⇧27 | C.L.R. James, lettre à Jay Leyda (7 mars 1953) in « Letters to Literary Critics », op. cit., p. 231. |
| ⇧28 | Ibid., p. 234. |
| ⇧29 | Henry A. Murray, « Introduction » in Herman Melville, Pierre, or the Ambiguities, Hendricks House, 1949, New York. |
| ⇧30 | Donald Pease, « C.L.R. James’s Mariners, Renegades and Castaways and the World We Live In » in C.L.R. James, Mariners, Renegades, Castaways, op. cit., p. xiii. |