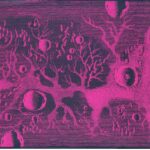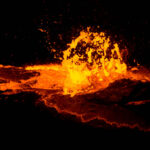« Un conflit de mondes plutôt qu’un conflit de forces ». Entretien avec Jacques Rancière
Le présent entretien a été réalisé au début de l’année 2023, plus de trois mois après le déclenchement d’un soulèvement populaire sans précédent en Iran. Aujourd’hui, nous ne voyons quasiment plus de manifestations de rue, même si les actes de résistance ont lieu dès que la moindre occasion s’ouvre ; la répression continue et plusieurs personnes arrêtées lors de cette révolte, sont menacés d’être exécutées. Pourtant, ce soulèvement semble avoir conduit le régime à un point de non-retour ; la situation politique en Iran est loin d’être « normalisée ». On parle de moins en moins de la suite de ce soulèvement à l’étranger, mais il reste toujours d’actualité en Iran.
Les questions abordées dans cet entretien ne portent pas directement ou exclusivement sur la situation politique en Iran, mais elles sont le résultat d’une réflexion à ce sujet. Nous avons cherché à confronter certaines notions et idées développées dans les travaux de Jacques Rancière à nos observations sur les évènements en Iran. Notre objectif n’était pas d’analyser la situation politique ni de demander le point de vue de Rancière sur les problèmes précis concernant celle-ci. Rancière, lui-même, tout en exprimant sa solidarité avec les luttes en Iran, nous a humblement indiqué dès le départ qu’il n’avait pas l’intention d’intervenir à distance à propos d’une situation dont il ne connaît pas les détails.
Nous le remercions d’avoir accepté cet entretien et pour l’attention et le soin qu’il a apportés en répondant à nos questions. Nous remercions Contretemps pour la publication de cet entretien.
*
Arash Behboodi et Alireza Banisadr – Lorsque l’on cherche à situer la place de la notion d’ennemi dans vos travaux, on trouve avant tout la notion de police et l’affrontement entre la politique et la police. Cet affrontement entre la politique et la police s’effectue sous forme du traitement d’un tort (La mésentente[1], Aux bords du politique[2]). La question est celle de savoir si la notion d’ennemi peut s’insérer, d’une manière ou d’une autre, dans votre conception de la politique en tant que processus d’émancipation, au-delà de la notion de police abordée dans le cadre du traitement d’un tort. Par exemple, une certaine pensée anti-impérialiste, qui existe aussi en France, estime que les choix politiques doivent être prioritairement adoptés en fonction du positionnement envers l’impérialisme[3].
Jacques Rancière – La façon dont est posé le rapport politique/police dans La Mésentente est peut-être un peu trop mécanique. Le tort n’est pas le combat de la politique contre la police. Il est la rupture de l’ordre policier qui institue la politique comme champ conflictuel. Mais une chose est essentielle dans mon approche : l’idée que la politique est un conflit de mondes plutôt qu’un conflit de forces. L’émancipation est d’abord un phénomène affirmatif, l’affirmation d’une manière de faire monde contre une autre. De ce point de vue, ce qui compte n’est pas d’abord d’identifier un ennemi, mais d’identifier dans une situation donnée la figure majeure de l’intolérable : telle ou telle intrication des forces de domination (économique, étatique, religieuse, militaire ou autre). Cette figure dominante n’est pas la même partout et elle est combattue à partir de sa configuration singulière, locale. C’est à partir de là que l’ennemi prend figure, comme l’incarnation de la combinaison spécifique où s’unifie la force oppressive qui est l’intolérable de cette situation.
Évidemment, cela laisse peu d’espace pour penser et pratiquer à un niveau global la communauté des combats contre l’intolérable. Comment penser ensemble l’oppression du peuple iranien par le pouvoir islamique et l’oppression des musulmans de Chine ou de Birmanie ? On aimerait définir une scène commune où les combats se croisent. Or l’impérialisme s’offre à jouer ce rôle de l’ennemi commun vers lesquelles tous les combats convergent. Mais on ne peut lui faire jouer ce rôle qu’à méconnaître la réalité d’aujourd’hui qui est celle de la multiplicité des impérialismes en concurrence. Le pouvoir iranien se présente comme la force qui lutte contre l’impérialisme américain. Les dictatures militaires africaines se justifient par la lutte contre l’impérialisme français mais accueillent les milices russes et croulent sous leur dette à l’égard de l’impérialisme commercial chinois, etc. Et les anti-impérialistes français qui ont des restes de tendresse envers la défunte URSS justifient les agressions de Poutine comme riposte à l’impérialisme américain et européen. Donc soumettre les combats contre les formes de domination particulière à une prétendue convergence contre un ennemi impérialiste commun est une imposture. L’ennemi reste singulier, ce qui veut dire aussi que ce qui compte d’abord est l’opposition singulière entre deux manières de faire monde, selon l’égalité ou l’inégalité.
Arash Behboodi et Alireza Banisadr – Pendant ces 13 dernières années, nous avons connu, de la Grèce jusqu’au Soudan, des soulèvements populaires plus ou moins importants, qui ont parfois réussi à faire tomber des régimes comme celui de Ben Ali en Tunisie, celui de Moubarak en Egypte, ou plus récemment, celui de Omar el-Bachir au Soudan. Certains font le constat selon lequel ces mouvements ont réussi à dégager les dictateurs mais, étant donné leur caractère principalement négatif et non affirmatif, ont échoué à créer un cadre organisationnel permettant de prendre le pouvoir politique et de le conserver pour rendre possibles des changements structurels. Partagez-vous ce constat ? Dans ce genre de situations, nous pouvons également repérer des forces politiques qui se préparent à occuper l’espace rendu vacant par la chute du régime, le moment venu et redistribuer différemment les identités, les places et les fonctions dans le cadre d’une nouvelle « police ». La confrontation avec ce vide implique-t-elle l’existence d’un cadre organisationnel particulier ? Comment doit-on réagir à la question de la « prise du pouvoir » ?
Jacques Rancière – Une précision tout d’abord : police et politique sont deux découpages du monde commun qu’on ne peut pas réduire à une opposition entre pouvoir d’État institué et révolte contre ce pouvoir. A partir du moment où un pouvoir étatique doit symboliser son exercice comme pouvoir du peuple, il inscrit son action dans un espace politique. Et un mouvement politique qui s’empare de l’appareil d’État ne devient pas de ce fait simple police. Il utilise les structures institutionnelles pour créer une autre sorte de peuple.
Venons-en maintenant au cœur du problème. Il me semble qu’il y a une ambigüité dans la question de savoir si un mouvement est affirmatif ou négatif. Il y a plusieurs éléments en jeu : ses objectifs, ses résultats mais aussi sa forme même. Marx disait que la principale réalisation « sociale » de la Commune de Paris était son existence même. Dans tous les mouvements dont vous parlez, il y a quand même eu un élément affirmatif : la constitution d’une puissance commune dont l’existence était interdite, rendue impossible par le pouvoir en place. Et le problème est que cette puissance collective surprend ceux-là même qui l’ont déployée lorsqu’il leur faut déclarer un objectif et des moyens de l’atteindre. C’est que j’ai souvent dit : les révoltes ont une logique plutôt que des raisons. Le peuple tunisien ne s’est pas soulevé avec l’objectif que Ben Ali dégage. Il s’est d’abord affirmé en lui-même comme réaction collective à un intolérable et il a dû ensuite désigner un objectif.
Par ailleurs le problème n’est pas que, une fois l’objectif atteint, on se trouve devant le vide. Le problème est que, pour abattre ces régimes autoritaires, il faut la complicité effective ou tacite des seules puissances qui, dans ces régimes, conservent une puissance d’action relativement autonome, à savoir l’armée et/ou la religion. Là où une sphère politique démocratique n’a pas pu se constituer sur le long terme, ce sont de fait les seules puissances constituées qui subsistent et qui prennent tout naturellement le relais des autocrates. Bien sûr, il y a, à cette situation, la réponse toujours prête : ce qu’il faut, c’est le parti révolutionnaire déjà formé pour mener la lutte jusqu’au bout, s’emparer du pouvoir d’État et l’exercer. Mais dans les conditions d’un pouvoir autoritaire qui ne laisse pas se développer une sphère publique autonome de discussion et de manifestation, le genre de parti révolutionnaire qui se crée est une organisation autoritaire fermée, peu prête à animer un mouvement de masse et à créer une forme de puissance collective égalitaire. Il n’y a d’avant-gardes réelles que celles qui se manifestent sur le terrain et, dans les grands mouvements auxquels nous avons assisté depuis le Printemps arabe, il y a toujours une course de vitesse pour permettre aux mouvements effectifs de se structurer comme une force de combat appelée à durer, et d’ imaginer, dans ce long combat, des étapes propres à obtenir des victoires effectives, même si elles sont limitées, et à renforcer la capacité subjective de la force égalitaire. Le premier objectif, c’est l’accroissement d’une puissance collective des égaux dans tous les domaines. Sans cela l’objectif de la prise du pouvoir reste enfermé dans les vieux schémas qui ont fait faillite. On ne peut pas ignorer l’écart que les mouvements récents ont rendu plus manifeste entre une logique de l’affirmation égalitaire qui est sa propre fin et une logique instrumentale de la lutte pour une prise de pouvoir destinée à créer les conditions d’une égalité future. « Démocratie réelle maintenant », c’est-à-dire accroissement ici et maintenant de la puissance de l’égalité, définit, qu’on le veuille ou non, le mot d’ordre de notre moment.
Arash Behboodi et Alireza Banisadr – La notion de propagande, souvent comprise comme processus de manipulation des masses à travers les médias, est corrélée à la notion d’individu malléable et manipulable. Une stratégie propagandiste se fonde également sur le présupposé d’une continuité entre le message, la technique de diffusion, son appréciation et son effet final.
Une pensée critique ayant pour but de déchiffrer ces stratégies propagandistes risque d’assumer une position de maître abrutisseur expliquant aux masses spectatrices pourquoi les choses ne sont pas comme elles apparaissent : « voici la réalité que vous ne savez pas voir !» (Le spectateur émancipé, p. 35[4]) Vous critiquez à plusieurs reprises cette logique de l’abrutissement à partir de la conception de l’égalité des intelligences développée dans Le maître ignorant[5].
Vous abordez par ailleurs la question de la propagande dans votre article « Sept règles pour aider à la diffusion des idées racistes en France ». Cet article s’inscrit en quelque sorte dans la pensée critique des médias. Mais il utilise, dans un style volontairement choisi, un agencement fictionnel adoptant la voix du propagandiste qui donne des conseils pour renforcer le racisme. Il occupe donc la position de l’abrutisseur et non pas celle de la pensée critique.
Comment une politique fondée sur le principe de l’égalité peut-elle tenir compte de l’effectivité potentielle de la propagande sans tomber dans les mésaventures des pensées critiques ? Est-il possible de développer un discours politique anti-propagande qui s’inscrive dans un processus d’émancipation plutôt que d’occuper la position du maître abrutisseur ?
Jacques Rancière – En dehors de toute question de justification personnelle, je ne serais pas d’accord pour dire que j’occupais dans les Sept règles la position du maître abrutisseur. Je ne cherchais pas à répondre à la propagande raciste et je n’enseignais pas ce qu’il fallait penser ou savoir. J’introduisais un brouillage des positions propre à inquiéter la bonne conscience de ceux qui pensaient être du bon côté, du côté de ceux qui luttaient contre le racisme alors qu’en fait ils le renforçaient. Il s’agissait d’une opération poétique plutôt que critique et je crois que ce genre d’opération est important pour développer des passions joyeuses et non les passions tristes de la critique qui sont finalement de même tonalité que celles que suscite la propagande raciste. J’insiste sur cette question des passions. La position « critique » pense la propagande dans la catégorie du mensonge qui cherche à tromper les esprits trop faibles ou trop ignorants pour exercer la discrimination à l’égard des messages reçus. En cela elle reproduit la présupposition de l’inégalité des intelligences et la fait fonctionner sans autre effet que sa propre reproduction.
Les succès des propagandes les plus grossières, comme celles de Trump, à une époque où les moyens de vérification abondent et où tous les médias pratiquent la lecture « critique » qui « décrypte » tout événement, nous rappellent qu’il s’agit d’autre chose : la propagande agit d’abord en suscitant des passions et principalement des passions de haine et de ressentiment, ces passions qui naissent de l’impuissance. On invoque toujours le rôle des fake news, mais ceux qui y adhèrent ne le font pas par ignorance ; ils ne le font pas, comme on le dit toujours, parce qu’ils sont des pauvres types perdus et sans repères ; ils le font parce ça leur fait plaisir de les entendre, parce qu’ils ont envie que ce qu’elles disent soit vrai et qu’ils partagent en les accréditant le sentiment d’appartenir, si misérables soient-ils, à une communauté supérieure.
On ne lutte contre cette sorte de plaisir triste qu’en lui opposant d’autres formes de plaisir plus joyeuses qui se moquent de la propagande et mettent en évidence sa faiblesse au lieu de dénoncer sa force. L’émancipation passe aussi par la capacité de mettre à distance ce qui vous affecte, de le déréaliser, d’en rire. La dérision s’accorde mieux que la dénonciation critique au courage qu’elle requiert.
Arash Behboodi et Alireza Banisadr – Depuis l’émergence des réseaux sociaux, la représentation des événements ne se limite pas aux grands médias. De nombreuses personnes tâchent quotidiennement de redistribuer les paroles et les images prises dans différentes situations sur les réseaux sociaux. De même, au cours des soulèvements populaires, cette activité se fait souvent au nom de la transmission de « la voix du peuple en lutte ». Les images partagées comportent parfois des scènes d’horreur et visent à dénoncer la répression et la cruauté d’un régime politique. Mise à part son efficacité, on peut interroger le mode de visibilité que cette redistribution met en œuvre.
Dans votre article « La feinte douleur »[6] et le livre Le spectateur émancipé (dans le chapitre « L’image intolérable »), vous traitez le problème de la banalisation de l’horreur et la représentation de l’intolérable. Vous dites dans « La feinte douleur » qu’« il n’y a de vérité de la douleur que par une démonstration qui lui donne une parole, un argument, disons-le, en termes aristotéliciens : une fable ». Dans « Le spectateur émancipé » (p. 112), vous indiquez que « le problème est de construire d’autres formes de sens commun » et que « cette création, c’est le travail de la fiction ». La redistribution mentionnée plus haut vise à représenter une situation, à être la voix d’un groupe de personnes. Elle rencontre donc la contrainte d’être représentative.
Y-a-t-il une tension entre cette tâche de représentation et la construction d’autres formes de sens commun ? Peut-on envisager également une fable ou fiction, au sens évoqué plus haut, au sein de cette tâche de redistribution ?
Jacques Rancière – La notion de représentation couvre peut-être des formes de transmission des affects qui sont différentes et fonctionnent différemment selon les contextes d’ensemble. Les textes auxquels vous vous référez se situaient dans le contexte « humanitaire » de l’époque de la guerre en Yougoslavie, prolongée par la seconde guerre du Golfe.
C’était le moment où le paradigme de la lutte mondiale contre l’impérialisme ne fonctionnait plus : on ne représentait plus des fiers combattants dressés contre l’impérialisme mais des agresseurs et des victimes comme tels, avec le risque de saturation, surtout en Occident où le culte des martyrs n’est plus guère à l’honneur. On commençait à en avoir assez des victimes, et les polémiques sur l’irreprésentable ou les dénonciations des mises en scène comme celle de Timisoara faisaient, à leur façon, écho à cette saturation. En définitive la représentation des victimes a surtout servi, à l’époque, comme appel à l’ennemi impérialiste d’hier requalifié en défenseur des droits de l’homme victime.
C’est une autre séquence qui s’est ouverte avec les manifestations contre Ahmadinejad en 2009 puis les soulèvements du printemps arabe. Je me souviens du choc ressenti à l’époque à voir circuler ces images de manifestations postées par les manifestants eux-mêmes qui n’avaient pas peur de se montrer ainsi à découvert. Depuis ce temps les images d’affirmation collective ont pris le pas sur les images d’atrocités exercées par les pouvoirs. Aujourd’hui encore, la vidéo de la lycéenne iranienne enlevant son voile et disant pourquoi elle le fait a eu beaucoup plus d’impact que les images de répression.
Cela dit, le problème est effectivement d’élargir le spectre des émotions en jeu, de faire appel à la curiosité, à l’amusement, à la fabulation. Il existe dans ce domaine pas mal d’exemples intéressants. Je pense aux films du collectif syrien Abounadarra qui n’ont cessé de mêler des témoignages documentaires, des situations fictionnelles et des sketchs parodiques. On peut aussi penser, bien sûr, aux films d’Elia Suleiman qui rendent compte sur un mode souvent burlesque, parfois fantastique, de l’occupation israélienne et de la résistance palestinienne.
Évidemment, ces fictions restent souvent enfermées dans l’univers de la cinéphilie, mais il y a dans ces pays assez de talents artistiques et de goût pour la fiction pour imaginer des formes d’imagination à la fois plus militantes et plus ancrées dans les pratiques de circulation des images, des mots et des histoires qui passent par les réseaux sociaux.
Arash Behboodi et Alireza Banisadr – Dans l’article « La cause de l’autre », vous discutez de la mobilisation politique en France contre la guerre d’Algérie et les subjectivations politiques qu’elle implique. On peut considérer ce texte comme une conception de la solidarité en tant qu’« inclusion politique de l’autre qui n’est pas celle de la morale » (p. 202).
Or, il y avait deux spécificités dans cette mobilisation, lesquelles ont rendu possible le processus de subjectivation et « un discours de l’autre » (p. 212) (au triple sens de désidentification, de démonstration qui s’adresse à un autre ou la construction d’un lieu pour une vérification polémique de l’égalité et d’identification impossible). Premièrement, la France était directement impliquée dans une guerre faite au nom des Français. Deuxièmement, la mobilisation et les manifestations étaient organisées en France. Le lieu de l’acte politique se situait alors sur la terre du colonisateur. En revanche, il y a des immigré-e-s (réfugié-e-s politiques ou non) en France, celles et ceux qui s’efforcent de poursuivre leur combat politique loin de leur pays. Par exemple, nous voyons souvent à Paris des manifestations ou des rencontres organisées en soutien des luttes menées dans différents pays du monde. Mais il y a une différence significative entre une lutte menée contre le régime à l’intérieur du pays et celle menée à l’étranger, où on ne vit pas sous le contrôle de celui-ci.
Est-il possible d’envisager une politique en exil (ou une politique d’exilé-e-s) ? La construction d’un lieu pour la vérification polémique de l’égalité n’impose-t-elle pas une contrainte spatiale au domaine de l’acte politique ?
Jacques Rancière – Effectivement je me référais au contexte de la guerre coloniale qui était menée par l’État français et vis-à-vis de laquelle il était possible de mener un combat de désidentification, ce qui a aussi été le cas des États-Unis au moment de la guerre du Vietnam. On retrouve ici la question qu’on a vue plus haut à propos de la pluralité des impérialismes. Impossible d’appeler par exemple à soutenir la révolte iranienne au nom de la lutte contre l’impérialisme. Et la lutte des exilés a du mal à être plus qu’une lutte de soutien à distance.
Dans le contexte actuel de la multiplicité des formes de domination, la contrainte spatiale est effectivement très forte. Mais, même sur le terrain « local », cette multiplicité implique des formes de subjectivation, c’est-à-dire de désidentification à l’égard des formes de domination auxquelles on participe comme hommes, comme blancs, comme membres de l’ethnie majoritaire, etc. Il est vrai que c’est souvent difficile à cause de la pression identitaire.
Cela est valable dans l’Iran d’aujourd’hui où la lutte contre un pouvoir qui concentre toutes les formes de domination implique que l’on inclue la cause de plusieurs autres. Cela l’est aussi dans les pays occidentaux même si cette inclusion doit se frayer un chemin étroit entre l’identitarisme, éventuellement requalifié en multiculturalisme, et un rapport à l’autre qui est plutôt celui du soutien aux victimes.
Arash Behboodi et Alireza Banisadr – Depuis le début du soulèvement en Iran (déclenché à la suite de l’assassinat de Jîna (Mahsa) Amini le 16 septembre 2022), en France, on entend parler de cet événement, à gauche, comme à droite. Contrairement au mouvement contre la guerre d’Algérie, ici, la pensée de l’inclusion de l’autre est absente.
D’une part, on peut parler de l’assimilation de l’autre. Cela veut dire l’intégration de l’autre, dénué de son altérité, dans le discours local et placé dans la distribution hiérarchique des places et des fonctions. C’est cet autre, la figure de la femme iranienne, qui est instrumentalisée à droite dans les discours racistes ; discours qui dissimulent la subjectivation politique des femmes iraniennes.
D’autre part, on peut parler de l’exclusion de l’autre, une disqualification, une incompatibilité qui rend impossible l’intégration de l’autre dans un discours. Chez une certaine gauche qui se veut anti-impérialiste, on regarde les événements, pour ainsi dire, avec méfiance : puisque le soulèvement n’est pas suffisamment anti-impérialiste, cet autre n’est pas à la hauteur du sujet politique tel qu’il devrait être.
Que pensez-vous de l’effet que pourrait avoir un tel événement dans un pays comme la France, à la fois sur les débats internes et sur l’émergence d’une solidarité internationale à un mouvement populaire ? Quelle forme de solidarité, une cause de l’autre, peut-on imaginer au-delà de ce couple de l’exclusion et de l’assimilation ?
Jacques Rancière – Il est clair que la révolte iranienne trouble la distribution des positions notamment en France à cause de l’instrumentalisation qui a été faite chez nous de la question du foulard. L’idéologie dite républicaine a pris argument de la répression des femmes dans les pays soumis à un régime islamique pour imposer des formes de stigmatisation et d’exclusion à l’égard des femmes musulmanes ici. Aujourd’hui elle peut donc applaudir ce qui se passe en Iran mais à condition de tout ramener à la question du voile, de ne pas voir le soulèvement d’un peuple contre l’autocratie. Et, de son côté, la gauche dite anti-impérialiste qui a soutenu le droit des femmes à porter ici le foulard se trouve embarrassée par l’opération qui rabat la révolte sur le droit des femmes à ne pas le porter là-bas.
La solidarité passe d’abord par la reconnaissance de ce qu’il y a d’universel dans un mouvement de révolte comme celui-ci. Et, bien sûr, la difficulté est que cette universalité du combat doit être clairement distinguée de la règle commune que l’on brandit ici pour imposer un modèle culturel contre un autre. Mais aussi il y a le fait qu’elle ne peut plus s’identifier au combat de tous contre un même ennemi. Même si nous vivons tous dans un monde organisé par le profit capitaliste, celui-ci a si bien su se fondre dans le paysage et s’accommoder des formes de domination les plus diverses que les combats n’y sont plus structurés par un antagonisme central. Nous sommes dans un monde de combats locaux qui ont lieu ici ou là, parfois à fronts renversés. Cela fait effectivement un certain isolement. Et c’est seulement de l’imagination des combattants d’aujourd’hui que l’on peut attendre la naissance de solidarités nouvelles.
*
Photo d’illustration : Hengameh Golestan.
Notes
[1] Jacques Rancière, La mésentente, Paris, Galilée, 1995.
[2] Jacques Rancière, Aux bords du politique, Paris, La Fabrique, 1998.
[3] Nous tenons à préciser un point afin d’éviter toute confusion. Dans les questions posées au cours de cet entretien, nous utilisons des termes tels que « certains anti-impérialistes » ou « un certain anti-impérialisme ». Notre but n’est évidemment pas de discréditer les combats anti-impérialistes menés en France ou ailleurs mais simplement de mettre en question une position particulière (que nous aurions pu qualifier de « campiste ») qui, en ignorant les combats des peuples opprimés, prend le parti des États prétendument anti-impérialistes et vide ainsi le mot « anti-impérialisme » de son sens.
[4] Jacques Rancière, Le spectateur émancipé, Paris, La Fabrique, 2008.
[5] Jacques Rancière, Le maitre ignorant. Cinq leçons sur l’émancipation intellectuelle, Paris, 10/18, 2004.
[6] Publié dans Moments politiques – Interventions 1977-2009, Paris, La Fabrique, 2009.