
Chili 1970-1973 : sous les décombres du néolibéralisme, une expérience révolutionnaire
Dans ce texte, à la fois réflexion politique et compte-rendu de lecture, le sociologue chilien Sebastián Pérez Sepúlveda revient sur l’ouvrage de Franck Gaudichaud : Découvrir la révolution chilienne (1970-1973), publié aux Editions Sociales fin 2023 dans le cadre des commémorations autour des 50 ans du coup d’Etat mené par le général Augusto Pinochet, le 11 septembre 1973.
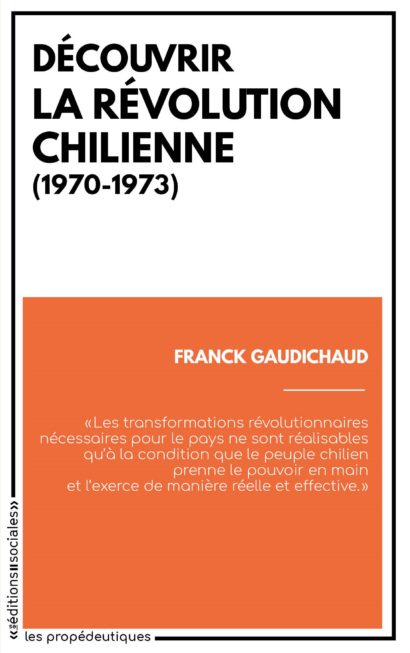
Le dernier ouvrage de Franck Gaudichaud, chercheur spécialiste de l’histoire sociopolitique contemporaine du Chili et de l’Amérique latine, est un petit volume de la collection « Les propédeutiques » des Éditions Sociales, consacré à la (re)découverte de la brève expérience historique du Chili sous l’Unité Populaire.
Au pouvoir entre 1970 et 1973, l’Unité Populaire regroupait les principales forces politiques du camp de gauche, notamment le Parti Communiste et le Parti Socialiste, mais incluait d’autres mouvements et partis aux courants marxistes et chrétiens et comptait sur le « soutien critique » du MIR, Mouvement de la gauche révolutionnaire, souvent analysé comme l’expression chilienne de la portée politique de la révolution cubaine en Amérique latine dans les années 1960[1]. Le contexte historique où s’inscrit l’expérience de l’Unité Populaire est déterminé par les contradictions du modèle de développement initié trois décennies plus tôt et les disputes sociales, politiques et intellectuelles autour de ces contradictions qui élargissaient le conflit de classes dans ce capitalisme périphérique aux dimensions de modernisation et de construction nationale face à l’impérialisme[2].
Après l’échec des réformes de la « révolution en liberté » prônée par la Démocratie Chrétienne (1964-1970), l’élection populaire de Salvador Allende à la Présidence de la République en 1970 marquait l’arrivée au pouvoir de l’Unité Populaire et le début d’une série de profondes transformations structurelles qui traduisaient le projet de construire le socialisme dans le cadre du régime politique en vigueur, en ouvrant ainsi une voie à la fois démocratique et révolutionnaire. Affrontant la déstabilisation orchestrée par la réaction interne et l’intervention – bien documentée – du gouvernement des États-Unis, la « voie chilienne vers le socialisme » et, avec elle, la progression politique des classes populaires, fut brutalement interrompue. Le bombardement de La Moneda, le palais présidentiel, le 11 septembre 1973, séquence iconique de la violence du coup d’État militaire, ne faisait qu’anticiper la répression systématique que déploieraient les appareils d’Etat pendant les longues années de dictature.
L’outillage d’une (re)découverte
Parcourant les mille jours de l’Unité Populaire dans un peu moins de 200 pages, le livre de Franck Gaudichaud est une introduction et surtout, comme le précise l’auteur lui-même, une invitation à aller plus loin. Dans ce périmètre, il y a trois dimensions du livre intéressantes à soulever. La première dimension concerne le positionnement à la fois politique et épistémologique de l’auteur. Fruit des années de recherche sur l’histoire récente du Chili, Gaudichaud nous offre le portrait d’une expérience entravée qui ne se réduit ni à l’intervention étrangère, véritable « cauchemar pour les anticomplotistes »[3], ni aux querelles partisanes dans les salons de la politique instituée. S’intéressant à la dynamique concrète des conflits, mais sans négliger les affrontements entre les forces politiques et la déstabilisation mise en œuvre par la réaction interne et la CIA, le positionnement analytique de l’auteur met en lumière des formes de politisation qui ont inondé la vie collective, de l’économie aux organisations sociales, passant par l’art et la culture :
« Le fleuve populaire qui déborde de toute part durant ces mille jours a le sourire des ouvrières de l’usine textile Yarur qui occupent leur usine, il a la bande-son des chants d’un peuple en liesse qui acclame le « camarade-président » sur la place de la Constitution, il dessine les contours d’un pouvoir populaire qui affronte le grand patronat et le sabotage de l’extrême droite, il possède la radicalité des Mapuche qui font sauter les barbelés pour récupérer des terres usurpées à leur peuple par la colonisation » (p. 10).
Au-delà du débat stratégique autour de « l’échec » ou « la défaite » de l’Unité Populaire, engagé par la gauche chilienne après le coup d’Etat[4] en préambule de la « rénovation socialiste » entreprise dans les années 1980, le livre de Franck Gaudichaud met en lumière le caractère révolutionnaire de la « voie chilienne vers le socialisme », moins par ses aboutissements finalement tronqués que par son déploiement au prisme des bouleversements des vieilles structures de domination et des subjectivations politiques à l’œuvre.
Partant de ce positionnement analytique, la deuxième dimension à souligner est la construction même de l’ouvrage et les diverses facettes de la « révolution chilienne » qu’elle donne à voir. Dans une vingtaine de pages, l’introduction décrit le contexte plus large où se situe le Chili de l’Unité Populaire, les liens de continuité et de rupture avec les changements que la société chilienne vivait à l’époque, sans perdre de vue ce qui viendra avec le coup d’Etat : l’installation de la dictature et l’imposition ultérieure du néolibéralisme. Treize chapitres d’une dizaine de pages chacun suivent l’introduction, dont l’organisation à la fois chronologique et thématique permet de tenir ensemble un récit de l’enchaînement des évènements et leurs divers visages sociaux. À part les chapitres abordant les lignes rouges de la trajectoire de l’Unité Populaire, dont la caractérisation du projet révolutionnaire (chapitre 1), les forces politiques en dispute (chapitres 3, 6, 8, 10), l’interventionnisme, la déstabilisation et la préparation et la mise en œuvre du coup d’Etat (chapitres 2, 9, 11 et 13), l’ouvrage en inclut d’autres permettant de capter l’ampleur des transformations en dispute.
Le chapitre consacré à la « bataille culturelle » (chapitre 4) attribue une place centrale à la Nouvelle Chanson chilienne avec les figures éternelles de Violeta Parra et de Victor Jara, les groupes Quilapayún, Inti-Illimani et les compositions, entre autres, de Sergio Ortega (Venceremos, El pueblo unido jamás será vencido), sans négliger quelques référence à la « brigade muraliste Ramona Parra » et l’énorme travail de diffusion littéraire de la maison d’édition Quimantú, née à la suite de la nationalisation de l’entreprise Zig-Zag. L’historique nationalisation des mines de cuivre, ratifiée le 11 juillet 1971, jour de la « dignité nationale » dans les mots de Salvador Allende, est matière du chapitre 5, ce qui est mis en lien avec la dimension à la fois anti-impérialiste et non-alignée que l’Unité Populaire cherche à défendre face à l’embargo commercial et l’interventionnisme des Etats-Unis dans le contexte international des années 1970. Les « cordons industriels », ces formes d’auto-organisation ouvrière et populaire au niveau territorial, sont abordés dans le chapitre 12, mettant en lumière leur naissance au cœur de la « bataille de 1972 » (la grève du patronat, traitée dans le chapitre 9), leurs difficultés et les tensions que cette « révolution par en bas » représente au sein de la gauche. Les enjeux de l’approfondissement de la Réforme agraire engagée par l’Unité Populaire reçoivent une attention particulière (chapitre 7), où les débordements populaires à la campagne sont présentés au prisme à la fois de la lutte des femmes et des mapuche dans le Sud du pays. Malgré la limite des pages, l’ouvrage réussit à exposer de façon condensée les diverses lignes de tension qui traversent le Chili de l’Unité Populaire.
En lien avec le point antérieur, la troisième dimension à soulever concerne la construction « formelle » des chapitres. Introductif, le livre est destiné à un public francophone qui trouvera non seulement une description fluide des diverses composantes de cette expérience historique, mais aussi une sélection variée d’extraits de sources documentaires traduits au français par Mila Ivanovic, placés au début de chaque chapitre. On y trouve, par exemple, le programme de l’Unité Populaire, le Procès-verbal de la réunion du « Comité 40 » du 8 septembre 1970 attestant de l’interventionnismes de Etats-Unis, entretiens et reportages de l’époque parus dans des publications telles que Chile Hoy et Punto Final, un morceau de la chanson « Venceremos », la célèbre lettre des cordons industriels adressée au « camarade président » quelques jours avant le coup d’Etat, ainsi que des documents de débat stratégique des principales forces politiques, tout comme deux discours de Salvador Allende, le « Discours à l’Assemblée générale des Nations Unies » de 1972 et son immortel « Dernier discours » émis le matin du 11 septembre 1973. Présentées et discutées au long des chapitres, chaque source documentaire sert à illustrer de première main les textures de cette expérience révolutionnaire. De plus, chaque chapitre propose à la fin quelques pistes bibliographiques et documentaires disponibles notamment en français, où les trois volets du film documentaire « La bataille du Chili » du réalisateur chilien Patricio Guzman, probablement l’une des sources documentaires principales de l’époque, sont incontournables.
Ces trois dimensions – positionnement analytique, construction de l’ouvrage et des chapitres – contribuent à la (re)découverte d’une expérience historique enclavée au cœur du XX siècle, mais dont la portée ne cesse d’interpeler notre présent. Comme le dit Franck Gaudichaud, « revenir sur les luttes révolutionnaires chiliennes n’est donc pas un acte de nostalgie militante ni un simple exercice historiographique » (p. 12), car « le passé obstiné de ces quelques mois incandescents ne passe pas » (p. 11). L’auteur inscrit ce travail dans le champ des « mémoires en bataille », dont l’incandescence et l’obstination habitent dans les fractures d’un ordre néolibéral construit à plus d’un titre contre la « voie chilienne vers le socialisme ».
L’ordre néolibéral contre l’Unité Populaire
Le Chili contemporain est le résultat du re-fondement néolibéral de l’ordre socio-institutionnel, opéré dans les conditions autoritaires assurées par la dictature civil-militaire (1973-1990). Un véritable modèle de société s’est imposé, étant organisé autour de la place croissante des dynamiques marchandes au cœur de la vie sociale et d’un État subsidiaire qui n’a cessé de créer des marchés mal régulés et de distribuer de la misère pour le plus grand nombre. Malgré l’introduction d’une politique sociale ciblant les plus pauvres, le retour au régime démocratique en 1990 n’a fait que consolider les piliers structuraux du modèle. Inégalitaire et précarisant pour la plupart, ce modèle de société est depuis plus d’une décennie en crise. La massive révolte populaire de 2019 a couronné une série de luttes sociales déployées autour fractures du modèle, en ouvrant une brèche qui reste ouverte[5].
Ce que nous fait découvrir Franck Gaudichaud est donc le portrait d’un Chili qui n’existe plus, mais qui garde un lien interne et souterrain avec l’ordre néolibéral. De la même façon qu’on ne peut pas dissocier les violations systématiques des Droits Humains pendant la dictature et le coup d’État qui en est à l’origine – comme insiste de manière persistante l’imagination conservatrice chilienne – on ne peut pas dissocier la construction politique de l’ordre néolibéral et l’expérience antérieure face à laquelle, dans une large mesure, celui-ci a été érigé. On a souvent tendance à observer le Chili comme le « laboratoire » d’un néolibéralisme qui deviendra globalement hégémonique une décennie plus tard. Certes, mais son installation autoritaire constitue, d’abord et avant tout, la réponse des élites économiques, militaires et conservatrices à « l’échec » du modèle national-populaire et l’industrialisation protégée (1930-1973), dont l’Unité Populaire serait le paroxysme avec le débordement populaire et la « surpolitisation » de la vie collective qu’elle a déclenchée.
Hégémoniques au sein du bloque militaire et civil au pouvoir depuis 1975, les prémisses néolibérales se consolident dans un projet conservateur et autoritaire via la Constitution imposée en 1980. Face à l’industrialisation dirigée par l’Etat, jugée volontariste et artificielle, l’ordre néolibéral a ouvert la voie à la privatisation sans précédentes des capacités de l’Etat, à la marchandisation continue de la vie quotidienne et à l’exploitation intensive des ressources naturelles. Ce sont les voies de l’accumulation capitaliste politiquement assistée, dont a bénéficié le grand patronat, porté en « héros de la modernisation économique » dans les années 1980-1990[6]. Face au débordement populaire et la « surpolitisation », l’ordre néolibéral a assuré la dépolitisation de la société à travers un double mouvement. D’une part, le positionnement du marché au centre de la coordination sociale, en déplaçant l’Etat de la gestion – et de la cible – des demandes sociales et, de l’autre, via la fragmentation sociale, économique et institutionnelle des mondes du travail, en limitant leur articulation collective. À distance de cette société fragmentée, le modèle politico-institutionnel a limité la participation et le débat démocratique.
Les élites politiques de la transition se sont pliées à cette configuration. Pas seulement la droite héritière de la dictature, mais aussi la « Concertation », coalition socialiste et démocrate-chrétienne au pouvoir entre 1990 et 2010. Si les « enclaves autoritaires » assurées par la Constitution de 1980 ont, certes, amplifié le pouvoir de veto de la droite et limité le jeu politique, il ne faut pas oublier que la Concertation s’est formée sur la base d’une conceptualisation élitiste de la démocratie[7], cohérente avec la critique à la « surpolitisation » et qui s’est facilement adaptée à l’ordre néolibéral, au nom de la « nécessaire » autonomie du système politique, gage de « stabilité institutionnelle ».
Cette configuration a terminé d’éclater en 2019. Depuis, la distanciation du système politique par rapport au monde social ne garantit plus la stabilité institutionnelle, mais semble plutôt favoriser l’émergence de solutions populistes ou carrément fascistes à la précarisation des conditions de vie de la population, entraînée par la marchandisation extrême de la vie quotidienne[8]. Aux décombres de l’ordre néolibéral, toujours vivant, la dispute politique se joue entre la gestion de la crise, l’horizon de plus en plus lointain de sortie du néolibéralisme et la menace de la restauration conservatrice, si ce n’est le basculement vers l’ordre rêvé par l’extrême droite, incarné dans le nouveau projet de constitution que sera voté en décembre prochain.
50 ans après l’Unité Populaire, une redécouverte nécessaire
Le livre de Franck Gaudichaud nous plonge, cinq décennies après, dans une expérience qui hante toujours le présent, mais dont la mémoire reste en dispute, travaillée par les conditions politiques du présent. La commémoration des 50 ans du coup d’Etat s’est déroulée dans une conjoncture marquée par les effets du refus du premier projet de constitution en septembre 2022. Refus capitalisé par la droite traditionnelle et l’extrême droite, leur permettant de renforcer le blocage des réformes gouvernementales et d’imposer leur vision du monde dans le nouveau projet de constitution. Composé par le « socialisme démocratique » héritier de la « Concertation », le Parti Communiste et la « nouvelle gauche » du Front Large, le gouvernement n’a pas réussi à installer une narrative claire sur la commémoration, malgré les références récurrentes à la figure de Salvador Allende. Le discours du gouvernement a plutôt réagi aux prises de position des droites qui ont, encore une fois, justifié le coup d’État, comme étant « inévitable » face à la « crise provoquée par l’Unité Populaire ». Rhétorique connue, mais fallacieuse qui cherche à dissocier « l’intervention militaire » des « excès commis » pendant la dictature.
Si les gauches au pouvoir ont contesté et démonté cette rhétorique réactionnaire, en réaffirmant leur engagement vis-à-vis des Droits Humains, elles sont néanmoins restées renfermées dans cet espace discursif. La condamnation morale et politique du coup d’Etat et de la répression brutale inséparable à laquelle celui-ci a donné lieu est nécessaire, mais en restant là, la puissance politique de l’Unité Populaire se dilue. Cette dernière n’a pas seulement été un gouvernement qu’il faut défendre en tant que démocratique, mais, répétons-le, l’Unité Populaire a été la dernière expérience concrète de transformation structurelle qui a mis au centre la dignité des classes populaires au Chili, une expérience révolutionnaire qui reposait, entre autres facteurs, sur une articulation non exempte de tensions entre forces politiques et sociales, tributaires d’un long travail de construction. Contre cette configuration s’est érigé l’ordre néolibéral aujourd’hui en crise.
Redécouvrir l’expérience de l’Unité Populaire est à la fois pertinente et nécessaire, car malgré la portée des réformes défendues par le gouvernement en cours, visant à démonter quelques pièces clés de l’ordre néolibéral, sa pratique politique s’est avérée très limitée. Minoritaire au Parlement et en l’absence patente de liens organiques avec le monde social, les réformes phares restent bloquées. À la lumière de l’expérience de l’Unité Populaire, la construction d’une sortie démocratique aux décombres du néolibéralisme ne saurait pas faire l’impasse de la nécessaire réarticulation entre société et politique.
Notes
[1] Palieraki, Eugénia, Naissance d’une révolution. Histoire critique du MIR chilien, Paris : La Découverte, 2023.
[2] Fondé sur l’industrialisation par substitution aux importations (ISI) promue par la CEPAL, ce modèle de développement stagnait depuis la fin des années 1950 et montrait de fortes disparités entre les secteurs d’activités. Le petit marché interne chilien était insuffisant pour soutenir le développement industriel qui, après une première phase, dépendait de l’importation de biens de capital. L’industrialisation était fortement assistée par l’État qui devait répondre aux demandes sociales venant de l’intégration progressive des secteurs populaires aux processus de modernisation. Or, malgré le développement industriel, le pilier de l’économie restait l’enclave minier du cuivre aux mains de firmes nord-américaines et le secteur agricole était dominé par les grandes propriétés foncières et des relations « traditionnelles » d’emploi. Pour aller plus loin, voir l’ouvrage classique de l’économiste chilien, Anibal Pinto, Chile, un caso de desarrollo frustrado, Santiago, Ed. Universitaria, 1959, voir aussi Touraine, Alain, Les sociétés dépendantes. Essais sur l’Amérique latine, Paris, Editions Duculot, 1976 et Fernando H. Cardoso et Enzo Faletto, Dépendance et développement en Amérique latine, Paris, PUF, 1978.
[3] Frédéric Lordon, « Chili 73 », Le Monde Diplomatique, 10 septembre 2020. Disponible sur : https://blog.mondediplo.net/chili-73
[4] Manuel A. Garretón et Tomás Moulian, La Unidad Popular y el conflicto político en Chile, Santiago, CESOC et LOM Ediciones, 1993 [1983].
[5] La révolte populaire de 2019 a donné lieu à un itinéraire de changement de la Constitution de 1980, encore en vigueur. Le premier processus a été porté par une « convention » élue à majorité progressiste et indépendante aux partis politiques traditionnels, dont le projet de constitution fut largement refusé en septembre 2022, ce qui a signifié une défaite importante aux camps progressiste et de gauche. Le second processus a été piloté par une « commission experte », composée à l’image de la corrélation des forces politiques représentées au Parlement, suivi d’un « conseil » composé par une majorité élue d’extrême droite et de la droite traditionnelle. Ce nouveau projet de constitution doit passer par un référendum le 17 décembre 2023.
[6] Montero, Cecilia, Les nouveaux entrepreneurs : le cas du Chili, Paris, L’Harmattan, 1997.
[7] Ruiz S., Carlos, « Concepciones de la democracia en la transición chilena », dans Seis ensayos sobre Teoría de la Democracia, Santiago, Universidad Nacional Andrés Bello, 1993.
[8] Il ne faut pas oublier que l’arrivée au pouvoir de Gabriel Boric et le Front Large en décembre 2021 doit beaucoup à la mobilisation électorale contre la candidature de l’extrême droite qui était pourtant arrivée en tête du premier tour des élections présidentielles une mois plus tôt. Mobilisation électorale qui s’est largement diluée depuis, malgré le charisme que conserve le Président auprès de la population.
![Chili 73 : un coup d’État qui permit la contre-révolution néolibérale [Podcast]](https://www.contretemps.eu/wp-content/uploads/golpe-chile-1973-150x150.jpg)


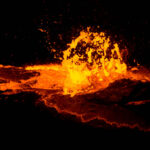




![Pourquoi la gauche et les mouvements populaires ont-ils subi un coup d’arrêt au Chili ? [Podcast]](https://www.contretemps.eu/wp-content/uploads/1KpJBvyPs4RmjBJXZ5Bc5jg-150x150.jpg)