
L’éducation démocratique, la culture technique et l’apport de Gramsci
Nous publions ici un extrait du livre de Christian Laval et Francis Vergne : Éducation démocratique. La révolution scolaire à venir, paru en septembre 2021 aux éditions La Découverte.
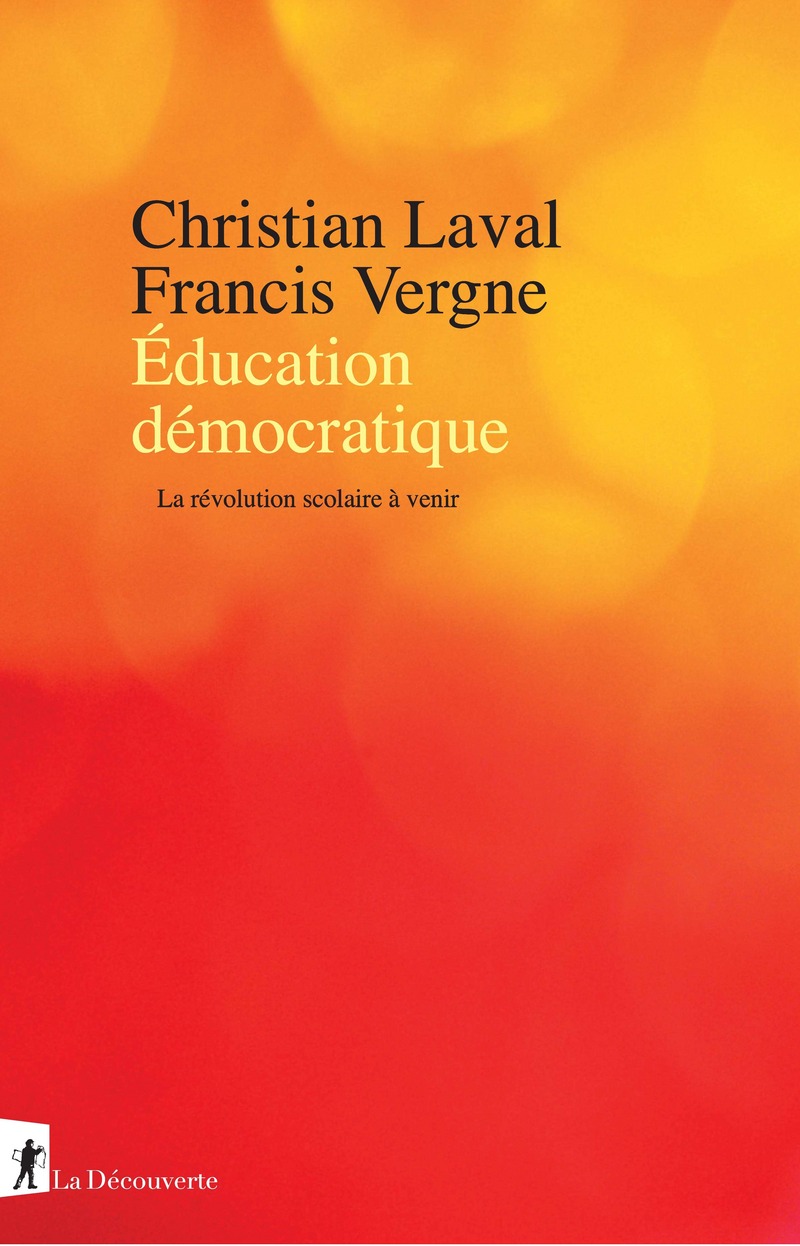
Déhiérarchiser les savoirs
L’éducation scolaire actuelle connaît un autre travers lié aux catégories qui structurent ses divisions disciplinaires, ses filières et ses établissements. Ces catégories sont autant d’inerties historiques et d’obstacles sociaux à l’égalisation réelle des apprentissages. Leur étanchéité, si elle dépend de l’organisation historique des partages entre disciplines savantes, tient aussi à la division du travail entre groupes sociaux et entre sexes. Les clivages les plus « évidents » et donc les plus idéologiques se situent entre les matières dites concrètes et les matières dites abstraites, ou entre les disciplines techniques et les disciplines générales, ou entre les disciplines spécialisées et la culture générale. Que ces clivages soient en réalité dépassés par l’évolution des systèmes techniques qui font appel massivement à la codification et à la symbolisation importe peu dans une école de classes. En réalité, ils permettent d’ « opérationnaliser » le tri scolaire.
Le problème n’est pas aujourd’hui d’insuffler de la « culture générale » dans la formation des scientifiques et des techniciens, il est de surmonter l’opposition entre les formes de culture et de faire en sorte que l’esprit scientifique ne soit pas considéré comme une spécialité, pas plus d’ailleurs que la connaissance des œuvres majeures du patrimoine littéraire et esthétique ou que l’invention des objets techniques ne devraient en être une. La notion de culture commune permet justement de dépasser l’opposition des savoirs littéraires, scientifiques, techniques et corporels qui structure encore largement les cursus et engendre des formes de « naturalisation » des distinctions entre filières et entre élèves.
L’opposition entre cultures littéraire et scientifique est au principe d’une séparation entre les sexes qui fonctionne jusqu’à présent assez bien dans les établissements scolaires. Par un étrange et complexe renversement des valeurs, ce quidistinguait les classes dominantes, et que la vulgate marxiste avait appelé « culture bourgeoise » faite de bon goût pourles arts en général et la littérature en particulier, est devenu un ensemble de savoirs et de disciplines scolairementminorés, du fait de leur faible rendement professionnel sur le marché du travail, même s’ils conservent en réalité uneprime symbolique implicite.
La culture commune démocratique doit surmonter cette sorte de division sexuelle de laculture, non pas seulement en incitant les filles à faire des études scientifiques, mais en faisant que les deux sexes partagent la culture commune, à la fois scientifique, technique et littéraire. Il ne faut pas reproduire l’erreur des «modernisateurs » des années 1960 qui croyaient que, en redonnant à la science sa centra lité dans la culture scolaire, on briserait les affinités électives entre culture scolaire et milieux favorisés. La grande leçon des années 1970 et 1980, à un moment où les matières et séries à forts coefficients scientifiques et mathématiques devenaient le quasi-monopole des enfants issus des classes dominantes, est que les atouts de l’origine sociale ne se limitent pas à la culture littéraire et esthétique mais s’étendent aux matières les plus abstraites et les plus éloignées de la « culture de salon »[1].
La culture commune doit inclure la culture technique dès le début de la scolarité. L’indépendance pratique et la réflexion qu’elle permet, les connaissances de toutes natures sur lesquelles elle ouvre, le lien systématique entre la pensée et l’activité auquel elle peut conduire, du moins quand l’enseignement n’est pas répétition routinière mais raisonnement de la pratique, en font une composante essentielle de la culture démocratique. De la même façon, le fossé entre la culture technique dite « pratique » et la culture scientifique dite « théorique » doit être comblé. Rien ne justifie la discontinuité entre les artefacts de la technique et la connaissance des principes qui guident leur réalisation, sinon les dimensions sociales de cette séparation entre les « opérateurs » et les élites scientifiques et administratives du privé et du public.
L’un des plus grands obstacles à la constitution d’une société démocratique est la division du travail entre « travail intellectuel » et « travail manuel », entre « fonctions de conception » et « fonctions d’exécution », division qui se reproduit à travers les générations. Cette opposition sociale, que l’école ne peut seule abolir, pourrait en partie être surmontée par des enseignements qui fournissent aux élèves la maîtrise raisonnée des principes des techniques et des contextes dans lesquels elles s’inscrivent. Mais il y a trois autres raisons tout aussi fondamentales pour ne plus reléguer la culture technique dans les classes les plus populaires, marquant par là l’infériorité symbolique où l’institution la tient.
La première est que la culture technique est précisément le domaine qui témoigne le mieux des capacités créatrices de l’être humain relativement à son milieu, ce qui, notamment par l’histoire de la technologie, peut nourrir la réflexion anthropologique. La deuxième est que les univers dans lesquels on vit, les moyens par lesquels on échange, les loisirs qui sont les nôtres ont tous pour médiation des outils techniques qui doivent être connus pour ne pas s’imposer tyranniquement à nous[2]. Enfin la troisième raison, bien formulée par Guillaume Le Blanc, est que la culture technique n’est jamais que le soubassement de toute culture :
« C’est toute la culture qui est technique puisqu’il n’y a pas d’œuvre qui ne soit liée à des opérations techniques de quelque nature qu’elles soient »[3].
Il en va aussi de ce que Mauss appelait les « techniques du corps », composantes intégrales d’une conception émancipatrice de la culture commune. Cette dernière doit ainsi inclure le domaine trop souvent ignoré ou relégué au second plan de la culture du corps au travers de laquelle l’humanité s’est construite en inventant des jeux et des défis physiques, et, avec eux, des règles communes. Deux écueils menacent aujourd’hui l’éducation physique et sportive : celui, traditionnel, du mépris envers les activités physiques au nom de la supériorité de l’esprit, et celui, plus contemporain, de l’alignement sur le sport business, son productivisme et sa marchandisation.
Une culture sportive démocratique doit développer des pratiques et des techniques du corps qui mêlent le plaisir et les émotions de la rivalité pacifique, de la coopération, de l’entraide et du respect de l’autre. C’est aussi le cas des danses, du mime, des arts du cirque qui invitent les êtres humains à surmonter des obstacles de façon gratuite et désintéressée. Les habitudes acquises dans ces exercices ne sont pas sans effet sur la capacité d’adaptation aux circonstances ni sur les facultés d’intuition, d’invention et d’anticipation qui participent de la construction de la personnalité.
L’expérience de la solidarité dans l’épreuve, la canalisation et la régulation de la violence, la reconnaissance acquise dans l’activité collective, l’acceptation raisonnée des règles communes et leur mise en œuvre sont autant de savoirs pratiques dont la portée tient à la fois de l’anthropologie, d’une éthique et sans doute aussi d’une esthétique de vie. Michel Serres ne s’y est pas trompé qui tenait à dire sa reconnaissance envers les « profs de gym » qui apprennent à penser[4]. On retrouve l’idée chez Philippe Descola lorsque, dans la lignée de l’analyse critique qu’il a menée sur le dualisme nature-culture, il réfléchit à la place qu’aurait le sport dans l’ « universel de la relation » auquel il aspire[5].
Le système scolaire de l’avenir doit veiller à ce qu’aucune série ou aucune discipline n’en viennent à détenir le monopole de l’excellence et à procurer le plus grand prestige social, comme, à différentes époques, ont pu l’être les humanités classiques, puis les mathématiques, reléguant ainsi les autres disciplines à un rang symboliquement et socialement inférieur. Une école démocratique doit instaurer la déhiérarchisation des savoirs et réduire les écarts de valeur symboliqueet sociale entre les types de capacités intellec tuelles. Ce que Bourdieu, l’un des principaux rédacteurs des propositions du Collège de France de 1985, avait très bien saisi :
« Pour des raisons inséparablement scientifiques et sociales, il faudrait combattre toutes les formes, même les plus subtiles, de hiérarchisation des pratiques et des savoirs – notamment celles qui s’éta blissent entre le « pur » et ! »‘appliqué », entre le « théorique » et le « pratique » ou le « technique », et qui revêtent une force particulière dans la tradition scolaire française – en même temps qu’imposer la reconnaissance sociale d’une multiplicité de hiérarchies de compétence distinctes et irréductibles »[6].
L’une des limites, d’ailleurs assumée, de ce rapport tient à ce qu’aucune condition sociopolitique à cette « révocation des hiérarchies » n’ait été posée, comme si l’école avait le pouvoir d’égaliser les valeurs sociales accordées aux différents typesde savoirs sans qu’il y ait à l’extérieur de l’école une politique volontariste qui modifie la hiérarchie entre les formes de travail dans l’entreprise – alors même que Bourdieu, toujours dans ce même rapport, pouvait écrire lucidement que,
« si le système scolaire n’a pas la maîtrise complète de la hiérarchie des compétences qu’il garantit, puisque la valeur des différentes formations dépend fortement de la valeur des postes auxquels elles ouvrent, il reste que l’effet de consécration qu’il exerce n’est pas négligeable : travailler à affaiblir ou à abolir les hiérarchies entre les différentes formes d’aptitude, cela tant dans le fonctionnement institutionnel (les coefficients, par exemple) que dans l’esprit des maîtres et des élèves, serait un des moyens les plus efficaces (dans les limites du système d’enseignement) de contribuer à l’affaiblissement des hiérarchies purement sociales »[7].
N’était-ce pas là pécher par « scolarisme » que de surestimer la possibilité d’une déhiérarchisation réelle en la séparant d’une politique d’ensemble affectant les structures sociales et la distribution du pouvoir dans la société[8] ? L’ « égale dignité » des savoirs et des filières aujourd’hui est plus un vœu pieux qu’une réalité, comme on le voit à l’hypocrisie scolaire qui prétend qu’il n’y a pas de hiérarchie entre les différents types de bac, ou que l’école assure la « réussite de tous » grâce à la pluralisation des formes de cette réussite.
L’« école unitaire » selon Gramsci
Ce qui doit dès maintenant guider la définition d’une culture commune tient au devenir du travail dans les sociétés occidentales. S’il faut évidemment préparer les individus de demain à faire reconnaître socialement leurs capacités professionnelles individuelles, il faut aussi leur donner les moyens d’être autre chose que des travailleurs subordonnés dans la relation salariale. Pour le dire autrement, il s’agit de repenser la formation intellectuelle en vue de l’autogouvernement populaire, qui supposera non pas moins de culture, mais beaucoup plus, et tout ensemble technique, scientifique, physique, littéraire, historique et philosophique.
Dans cette direction, nous ne partons pas de rien. Certains théoriciens du socialisme révolutionnaire ont posé les bases de cette réflexion. Dans les années 1920, Gramsci a exposé dans des textes aussi brefs que denses un projet d’ « école unitaire» (scuola unitaria) en lieu et place de la vieille école italienne en crise, mais également dirigé contre la solution alternative des écoles professionnelles, lesquelles, d’après lui, ne feraient qu’entériner et perpétuer la division sociale. Gramsci constate, dans un article consacré à l’ « organisation de l’école et de la culture », que l’école traditionnelle fondée sur l’idéal partagé de la civilisation humaniste est en crise, du fait de la poussée industrielle et de la spécialisation des activités et des sciences, au point que, selon lui, chaque activité conduit à créer une école différente.
La spécialisation et la différenciation des écoles, de même que la tendance parallèle de chaque science et discipline à se développer selon sa propre particularité sont des processus qui mettent en question l’école humaniste désintéressée destinée à former une individualité capable de penser par elle-même et de se diriger dans la vie de façon autonome selon les principes de l’humanisme et des Lumières. Il s’agit donc pour Gramsci non de reproduire ce qui n’a plus lieu d’être, mais d’inventer une nouvelle forme d’unité de la culture pour une société future dirigée par les travailleurs.
Selon Gramsci, on ne peut pas établir de rapport direct entre un contenu d’enseignement et le caractère de classe d’une école. Contre ceux qui, à son époque, pensaient que la multiplication des écoles professionnelles en fonction des spécialisations et des niveaux de responsabilité dans la division du travail permettrait de remplacer l’ancienne formation jésuitico-humaniste, considérée comme intrinsèquement oligarchique, était gage de démocratisation, Gramsci défend une autre idée de la véritable école démocratique.
Une école de classe, à ses yeux, c’est une école de la séparation, lorsque « chaque groupe social a un type propre d’école, destiné à perpétuer dans ces strates une fonction traditionnelle, dirigeante ou instrumentale »[9]. Professionnaliser les écoles de façon précoce, sous prétexte de répondre aux exigences de la société moderne, n’est nullement démocratique en soi. C’est au contraire vouloir calquer le système scolaire sur le système social et créer autant d’écoles qu’il y a de castes et de classes[10] :
« Les écoles de type professionnel, c’est-à-dire préoccupées de satisfaire des intérêts pratiques immédiats, prennent l’avantage sur l’école formatrice immédiatement désintéressée. L’aspect le plus paradoxal est que cette nouvelle sorte d’école apparaît et est vantée comme démocratique alors qu’elle n’est pas seulement destinée à perpétuer les différences sociales, mais à les cristalliser dans des formes chinoises. »[11]
La solution n’est donc pas dans la diversification des formations, comme beaucoup de ses camarades communistes le souhaitaient, mais au contraire dans la création d’une « école unique initiale de culture générale, humaniste, formatrice, qui articule justement le développement de la capacité de travailler manuellement (techniquement, industriellement) et le développement de la capacité de la réflexion intellectuelle »[12]. Cette perspective est inséparable d’une refonte de l’organisation de la production, du rôle du travail intellectuel et de la participation populaire à la vie politique. L’éducation doit former les futurs collectifs de travailleurs qui prendront en charge la vie économique et sociale. Les citoyens de la future société devront avoir à la fois une solide « culture générale technique » et une connaissance approfondie de la langue, des lettres, de l’histoire, de la société et de l’économie.
La véritable révolution culturelle ne passe pas par le sacrifice du précieux trésor des humanités, mais par sa pleine intégration dans une culture pour tous, par-delà les spécialités. C’est l’union des travailleurs et des intellectuels qui doit se préparer dès l’école en évitant de creuser le fossé entre des catégories qui n’auraient que trop peu en commun sur le plan culturel pour œuvrer ensemble à l’organisation de la société. Tout l’enjeu politique de la culture commune réside donc dans la création des conditions intellectuelles d’une démocratisation réelle de l’économie et de la société. La finalité de l’« école unitaire » n’est pas l’adaptation aux conditions nouvelles de la vie, elle est la maîtrise de ces conditions grâce à l’unité des travailleurs et des intellectuels, du travail et de la pensée.
*
Photo : une imprimerie Freinet dans une classe au Mexique, en 2013. Sergi Bernal.
Notes
[1] Pour une perspective historique sur l’illusion scientiste propre à la « modernisation », on se reportera aux actes du colloque d’Amiens de mars 1968 : AEERS, Pour une école nouvelle, op. cit.
[2] Cf Mark HUNYADI, La Tyrannie des modes de vie. Sur le paradoxe moral de notre temps, Le Bord de l’Eau , Lormont, 2014.
[3] Guillaume LE BLANC , « Culture générale et culture technique», in François JACQUET-FRANCILLON et Denis KAMBOUCHNER (dir.), La Crise de la culture scolaire: origines, interprétations, perspectives, PUF, Paris, 2005, p. 314.
[4] Michel SERRES, Mes profs de gym m’ont appris à penser, Le Cherche Midi, Paris, 2020, p. 30-31.
[5] Philippe DESCOLA, Cultures, Éditions Carnets Nord, Paris, 2017.
[6] Pierre BOURDIEU, Propositions pour l’enseignement de l’avenir, op. cit.
[7] Ibid.
[8] On prend souvent l’exemple de l’Allemagne dont le système éducatif ne connaîtrait pas la même dévalorisation de la culture technique, ce qui expliquerait que les ouvriers et les techniciens y seraient mieux traités que dans les entreprises françaises. La comparaison entre systèmes est très délicate. On oublie ainsi que la séparation entre filières techniques et filières générales est beaucoup plus précoce en Allemagne qu ‘en France.
[9] Antonio GRAMSCI, « L’ organizzazione della scuola e della cultura », Gli Intellettuali, Ed. Riuniti, Rome, 1975, p. 145.
[10] Ce type d’écoles différenciées selon les fonctions professionnelles a été proposé dès le XVIIIe siècle, par les physiocrates français. C’est précisément contre ce type de décalque de l’école sur la division du travail que Condorcet rédigera ses Cinq Mémoires sur l’Instruction publique.
[11] Antonio GRAMSCI, « L’organizzazione della scuola et della cultura », op. cit., p. 145. Par « formes chinoises», Gramsci veut dire divisées selon un régime de castes.
[12] Ibid., p. 128.









