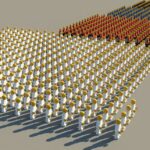Gramsci et le problème du parti
Tout au long du 20e siècle, le problème du parti révolutionnaire a été central pour les mouvements d’émancipation, en particulier pour les différents courants s’inscrivant dans la filiation de Lénine (mais aussi pour les courants qui contestaient la nécessité d’un tel parti).
Si le retour de la critique sociale a remis à l’ordre du jour la nécessité d’une rupture avec le capitalisme, la « forme-parti » a été décrétée en crise, sinon en état de mort clinique, et le débat associant la stratégie révolutionnaire à la construction d’un parti a été clos sans que l’on interroge véritablement le vide ainsi laissé.
Dans ce contexte, la référence omniprésente à Gramsci – qui s’inscrivait lui-même dans la tradition léniniste – s’est payée de l’oubli de son élaboration concernant le parti révolutionnaire, pourtant centrale dans sa pensée, au profit d’une vision réductrice de Gramsci comme penseur de l’hégémonie culturelle (contre un Lénine qui aurait, dit-on, méconnu cet aspect).
C’est cette pensée gramscienne du parti que restitue Yohann Douet dans cet article, tout en discutant les grands problèmes et les impasses possibles qui lui sont associés, et en la situant dans les débats contemporains relatifs à la politique d’émancipation.
Dans le 13ème des Cahiers de prison, Gramsci caractérise le Parti communiste comme un « Prince moderne ». Comme le Prince de Machiavel, il a pour but de fonder un « nouveau type d’État »[1]. Sa tâche ne s’arrête pourtant pas là, et l’analogie est limitée, car l’État prolétarien qu’il s’agit d’établir n’est pas une fin en soi. Au contraire, cet État est censé mettre fin à la société de classe, et s’abolir ainsi lui-même en tant qu’État, puisque tout État est lié au conflit de classe. Cette abolition doit correspondre, en termes gramsciens, au passage d’un pouvoir qui repose en dernière instance sur la « coercition »[2] à une « société réglée » où l’auto-gouvernement devient la règle. On est donc loin de l’exhortation machiavélienne à « mantenere lo Stato »[3]. Autrement dit, la révolution prolétarienne doit aboutir à un État paradoxal : Lénine parle ainsi d’un État « non État »[4] ou d’un « demi-État »[5] .
Le Parti révolutionnaire est nécessairement contaminé par ce caractère paradoxal, puisqu’il est censé représenter le prolétariat, classe dont l’intérêt historique est le dépassement de toute scission des sociétés humaines en classes. S’il remplit parfaitement son rôle, le Parti est donc voué à disparaître. Gramsci l’affirme explicitement dans le 4ème Cahier : « parce que chaque parti n’est qu’une nomenclature[6] de classe, il est évident que pour le parti qui se propose d’annuler la division en classes, la perfection et l’accomplissement consistent dans le fait de ne plus exister parce que n’existeront plus les classes et donc leurs expressions ». La fin du Parti – son objectif ultime – est sa propre fin – sa disparition.
Afin de produire cette fin paradoxale, le parti doit mettre en œuvre des moyens qui semblent la contredire. Pour fonder un nouvel d’État, c’est-à-dire faire une révolution, le Parti doit lutter contre l’État existant. Il est par là conduit à adopter une organisation centralisée, disciplinée, voire militarisée, qui le rapproche dangereusement de ce qu’il combat. Il doit accepter ce que Gramsci considère être le « fait primordial, irréductible » sur lequel sont fondés la science et l’art politique[7], c’est-à-dire la distinction entre dirigeant-e-s et dirigé-e-s, gouvernant-e-s et gouverné-e-s. Mais d’un autre côté, il veut précisément abolir cette distinction. La tension entre la fin à atteindre et les moyens mis en œuvre est encore accentuée dans la mesure où l’organisation centralisée et dirigiste risque toujours d’acquérir le statut, non plus d’un simple moyen, mais de la fin véritable : dans ce cas le Parti n’a pas d’autre horizon que sa propre perpétuation dans l’existence, et reconduit finalement la domination, bien que sous une autre forme.
Examinée plus précisément, cette tension entre l’organisation et la tâche qu’elle est censée accomplir nous permettra d’affirmer que le Parti révolutionnaire peut, pour Gramsci, être conçu comme une contradiction en acte. Cette dernière ne peut être gérée et régulée que si la direction consciente du Parti entre dans une relation dialectique avec la base, ce terme désignant à la fois les militant-e-s de base officiellement membres du Parti et la base sociale de ce dernier, c’est-à-dire la ou les classes qu’il représente. On trouve dans les Cahiers de prison et dans certains écrits politiques pré-carcéraux des indications plus concrètes concernant les conditions de possibilité d’une telle dialectique. Pourtant, il nous faudra examiner les limites de cette solution au problème du Parti : elle est incomplète en ce qu’elle ignore différentes garanties de démocratie interne, et elle repose sur des présupposés menacés d’anachronisme.
Direction et émancipation
1.Le modèle dirigiste
Gramsci s’inscrit sans conteste dans la filiation de Lénine. Il concrétise sa pensée sur certains points et s’en écarte sur d’autres, mais elle reste néanmoins à l’horizon de ses réflexions. Bien que la pensée de Lénine – de même que la lecture qu’en propose Gramsci – soit aux antipodes du « marxisme-léninisme » de Zinoviev et de Staline[8], et soit donc loin de pouvoir être réduit à un pur dirigisme et autoritarisme dogmatique, il est clair que Gramsci tire de la théorie et de la pratique politique de l’auteur de Que faire ? l’idée que le parti doit être centralisé et doté d’une direction ferme. Plusieurs raisons justifient cela.
Tout d’abord il est le principal facteur d’unification des masses ; or, pour triompher dans la lutte des classes, l’unité est requise ; puisqu’elle ne viendra pas d’une logique purement immanente aux masses elles-mêmes, le Parti devra être monolithique. De plus, dans le temps court de l’action politique, il est nécessaire de posséder un ensemble réduit de dirigeant-e-s efficaces, puisque eux seuls peuvent agir et réagir très rapidement et saisir les occasions opportunes, comme le fit la direction du parti bolchevik lors des journées d’Octobre[9]. Enfin, conformément à la conception développée par Lénine, dans Que faire ? en particulier, seul un parti constitué de « révolutionnaires professionnels » et bien formés peut mener une véritable lutte de classes politique, dirigée contre l’État en place et la société de classe dans son ensemble, et non un ensemble de luttes partielles et restreintes à un niveau principalement économique.
Gramsci utilise une métaphore militaire pour exposer sa conception hiérarchisée et dirigiste de l’organisation. On peut penser cette dernière comme constituée de trois éléments : la base militante est comparable à masse de soldats obéissants et disciplinés ; ils n’acquièrent leur efficace que s’ils sont organisés par un élément intermédiaire ; et ces deux premiers niveaux sont subordonnés à un troisième, celui des « capitaines ». Ce dernier niveau
« centralise au niveau national, rend efficace et puissant un ensemble de forces qui, laissées à elles-mêmes, compteraient pour zéro ou à peine plus ; cet élément est doté d’une haute force de cohésion, de centralisation et de discipline, et aussi (…) d’invention (si on entend invention dans un certain sens, selon certaines lignes de force, certaines perspectives, certaines prémisses aussi). (…) A lui seul cet élément (…) formerait plus que le premier élément considéré »[10].
L’une des tâches fondamentales de ces dirigeant-e-s consiste à former d’autres dirigeant-e-s et à préparer ainsi leur succession, au cas où ils viendraient à disparaître (notamment en étant emprisonnés, comme Gramsci lui-même). Les exigences organisationnelles font donc peser le risque d’un renversement des moyens et des fins, dans la mesure où la pérennisation de l’organisation (sous la forme de la succession des dirigeant-e-s) devient l’un des buts principaux de cette même organisation.
2. La dimension culturelle de l’activité partidaire
Pourtant le rôle du Parti ne se réduit pas à une fonction de direction et d’organisation politico-militaire. Il doit également, et peut-être avant tout, remplir un rôle éducateur et intellectuel. Ce qui importe le plus dans un parti « c’est sa fonction, qui est de diriger et d’organiser, c’est-à-dire une fonction éducative, c’est-à-dire intellectuelle »[11].
Son travail politique doit être coextensif à un effort pour élaborer, développer et diffuser auprès des masses une nouvelle « conception du monde ». Celle-ci devra reposer sur philosophie concrète et vivante, qui pourra organiser les masses, et aller jusqu’à changer leur mode de vie. Il s’agit bien entendu de la « philosophie de la praxis », du marxisme comme théorie vivante et agissante. Le Parti, comme « intellectuel collectif »[12], devra donc mettre en œuvre une « réforme intellectuelle et morale » qui renforce l’autonomie et l’auto-activité des masses populaires, et les détache de la domination bourgeoise. En ce sens, l’action éducatrice du Parti a incontestablement des effets directement politiques.
La nécessité de cette dimension culturelle de l’activité du Parti indique clairement les limites du paradigme dirigiste et hiérarchique. La « diffusion, par un centre homogène, d’une façon homogène de penser et d’agir »[13] est incompatible avec une relation unilatérale, de commandement quasi-militaire, qui irait du sommet vers la base. L’éducation des masses dont parle Gramci ne peut pas être une pure inculcation, mais doit prendre en compte l’adhésion et le consentement de ceux à qui elle s’adresse.
Ce qui est vrai pour la diffusion d’une nouvelle conception du monde, l’est d’autant plus dans le cas de son élaboration. Les théories véritablement révolutionnaires naissent de l’éducation réciproque des intellectuels et des masses. Les intellectuels organiques du prolétariat ne peuvent les produire que parce que leur savoir se nourrit d’une compréhension des masses, qui n’est elle-même possible que parce qu’ils sentent leurs émotions et leurs passions les plus profondes[14]. On comprend alors que le rapport entre le parti et les masses, de même que le rapport entre les dirigeant-e-s et les militant-e-s, ne peut être unilatéral et doit laisser place à une dimension de réciprocité, à une certaine dialectique. En outre, l’émancipation intellectuelle des classes subalternes ne peut pas attendre la victoire de la révolution prolétarienne mais est déjà appelée par l’activité quotidienne du Parti.
3. La préfiguration de l’émancipation
Comme le montre la politique culturelle, le Parti doit déjà réaliser, ici et maintenant, l’émancipation qu’il a pour but de produire dans la société dans son ensemble. En un sens, le parti doit être l’image de la société qu’il veut produire. Autrement dit, il doit mener une politique préfigurative. Il n’est pas qu’un outil permettant de produire le communisme, il est censé être un « îlot de communisme »[15] réellement existant. Il n’est pas seulement l’agent permettant d’actualiser un possible dans l’avenir – la révolution prolétarienne – mais également une actualisation partielle de ce possible au présent. C’est ce que Gramsci semble lui-même affirmer, au moment précis où il introduit sa célèbre analogie avec le Prince machiavélien :
« Le Prince moderne (…) ne peut être qu’un organisme, un élément complexe de société dans lequel a commencé à se concrétiser une volonté collective qui s’est reconnue et affirmée en partie dans l’action. Cet organisme est déjà donné par le développement historique, et c’est le parti politique, première cellule dans laquelle se concentrent des germes de volonté collective qui tendent à devenir universels et totaux »[16].
Le Parti révolutionnaire semble donc incarner, préfigurer, son propre objectif, qui consiste à unifier en une volonté collective des volontés partielles des classes subalternes. D’un côté, cet objectif est pour lui un moyen de réaliser sa tâche ultime : il faut unifier le prolétariat, et même les masses populaires en général sous l’hégémonie du prolétariat (le prolétariat et ses alliés potentiels comme la paysannerie, la petite bourgeoisie, etc.), afin de renverser la dictature bourgeoise et d’instaurer le socialisme. En ce sens, le Parti est l’organisateur d’une volonté collective nationale-populaire et, en même temps, « l’expression active et opérante »[17] de celle-ci.
Mais d’un autre côté, on peut également considérer que cet objectif est la fin dernière du Parti, à savoir l’instauration du communisme. En effet, on ne pourra aboutir à une volonté collective totale et universelle que si l’État et l’idéologie bourgeoises ne fragmentent plus les masses populaires, et si les contradictions économiques (comme celles inhérentes au mode de production capitaliste) ne déchirent plus l’humanité. Ce n’est que sur la base d’une organisation économique non conflictuelle, et après avoir éliminé les appareils politiques des classes dominantes, que l’on peut espérer véritablement réconcilier l’humanité avec elle-même. Par conséquent, dire que le Parti constitue la première cellule d’une volonté unifiée, c’est dire qu’en lui se trouve déjà réalisée – partiellement et uniquement en germe, bien entendu – la tâche qui le définit.
La solution du problème initial semble s’éloigner à mesure qu’on le formule plus précisément. Dès le départ le Parti est caractérisé par son objectif paradoxal, en ce qu’il implique sa propre abolition. Sa fin est en elle-même un problème. Mais ce problème se complique lorsqu’on examine les moyens de la réaliser.
Pour produire ce résultat, les moyens les plus efficaces d’un point de vue politico-militaire semblent être liés à un renforcement des aspects hiérarchiques et autoritaires de l’organisation : cette dernière risque alors de n’agir que dans le seul objectif de se reproduire, et donc pérenniser la séparation entre dirigeant-e-s et dirigé-e-s.
D’un point de vue culturel et idéologique, le Parti se doit de prendre des initiatives, de développer une conception du monde cohérente et de la diffuser le plus efficacement possible. Une telle politique a nécessairement des aspects centralisés et hiérarchisés, et reconduit en partie la division entre les intellectuels et les autres militant-e-s. Mais elle doit être beaucoup plus souple que ce que le modèle militaire laissait penser. Il faut donc comprendre comment le Parti peut se caractériser à la fois par une direction extrêmement ferme, sans pour autant sacrifier la relation souple et profonde qu’il entretient les masses.
Le problème peut être formulé à un troisième niveau, si l’on considère que l’un des moyens requis pour produire la fin visée est la préfiguration de celle-ci : le Parti, dans sa forme organisationnelle elle-même, doit être l’anticipation réellement existante de l’émancipation possible. Lorsqu’il défendait cette idée, Gramsci n’évoquait que l’unification des volontés, ce qui limitait en apparence la difficulté de sa thèse. Mais l’objectif ultime du Parti n’est pas une « unification » des volontés comprise en un sens faible, sur le mode d’une alliance tactique ou d’une coïncidence accidentelle d’opinions. Elle est l’unification véritable du genre humain par la résolution des contradictions qui le déchirent. Or, cette unification n’est qu’un autre nom du communisme appréhendé dans toute sa plénitude, qui implique l’abolition de la division du travail et un véritable auto-gouvernement démocratique. Il semble bien difficile de concevoir qu’une organisation puisse réellement préfigurer une telle fin, mais Gramsci nous fournit un certain nombre d’éléments pour le faire.
Dialectique et démocratie
1. La « dialectique entre la spontanéité et la direction consciente »
Après Lénine, Luxemburg et Lukacs, Gramsci utilise l’expression de « dialectique » pour nommer le rapport à établir entre la « conscience » (des intellectuels et de la direction) et la « spontanéité » (celle des masses et celle des militant-e-s du parti au sens strict).
Les partis de masse modernes sont censés se caractériser par une « adhésion organique à la vie plus intime (économico-productive) de la masse elle-même »[18]. La direction consciente ne saurait être extérieure à la classe. Le Parti est lui-même une « partie » de la classe, une couche de la classe, qui doit rester en liaison avec toutes les autres couches. Il en est certes l’avant-garde, et son devoir est de guider la classe à chaque moment, mais en s’efforçant de rester au contact avec elle à travers tous les changements de situation objective. Le parti doit marcher « un pas en avant, mais un pas seulement »[19]. Il s’agit d’orienter le reste de la classe vers ses intérêts historiques fondamentaux, mais toujours en partant des enjeux socio-politiques immédiats.
Le Parti est censé être une véritable expression de la classe qu’il représente. Mais cette relation d’expression est dialectique, dans la mesure où le Parti agit en retour sur la classe dans laquelle il s’ancre :
« s’il est vrai que les partis sont seulement la nomenclature des classes, il est aussi vrai que les partis ne sont pas seulement une expression mécanique et passive de ces classes, mais réagissent énergiquement sur elles pour les développer, les solidifier et les universaliser »[20].
On a donc bien une dialectique entre un contenu socio-économique, et une forme politique, le Parti. Il faut ajouter que le contenu déborde parfois de la forme. L’action du Parti doit certes diriger, encadrer et organiser les masses, mais elle ne doit pas étouffer les initiatives populaires et la spontanéité des masses. Elle doit leur laisser libre cours afin de les élaborer politiquement en un second temps.
2. Centralisme démocratique contre centralisme bureaucratique
Le type de dialectique que nous venons d’évoquer entre direction et spontanéité, entre forme et contenu se retrouve à l’intérieur même du Parti – s’il est bien organisé. C’est précisément ce que désigne la formule de « centralisme démocratique » qui, par opposition au « centralisme bureaucratique », est le critère d’un parti véritablement progressiste, d’une organisation apte à remplir sa tâche historique.
« Le centralisme démocratique est un « centralisme » en mouvement, c’est-à-dire adéquation permanente de l’organisation au mouvement réel, une régulation des poussées d’en-bas par les commandements d’en-haut, l’insertion permanente des éléments naissant des profondeurs de la masse dans le cadre solide de l’appareil de direction qui assure la continuité et l’accumulation régulière des expériences »[21].
Le « cadre de direction » qui assure efficacité et cohérence conserve son importance, mais tout doit être fait pour éviter qu’il « ne se raidisse mécaniquement dans la bureaucratie »[22]. Il soumet la logique bureaucratique de l’organisation à la logique de l’action et du mouvement historique, afin de ne pas s’écarter de la perspective d’émancipation socio-politique.
Le « centralisme bureaucratique »[23], à l’inverse, n’est pas poussé par des impulsions venant d’en bas mais régi par des ordres venant du sommet. Le Parti se coupe des masses et de sa propre base militante, qui sont laissées dans un état de passivité presque totale. On aboutit alors à un véritable « fétichisme d’organisation »[24], puisque celle-ci est devenue à elle-même sa propre fin, vaut en elle-même et pour elle-même, indépendamment de son lien avec les classes subalternes, sans qui elle ne serait pourtant rien. Dans cette situation, même avec des chefs honnêtes et efficaces, la logique bureaucratique finit par prendre le dessus. La conservation et la puissance du parti lui-même deviennent les seuls motifs de son action, et l’horizon de l’abolition de l’organisation disparaît. Pour cette raison, le centralisme bureaucratique doit être considéré comme réactionnaire : parce que le parti fait partie de l’ordre existant.
Pour être véritablement progressiste, être adéquat à sa fin, le Parti doit donc lutter contre le raidissement mécanique et la cristallisation bureaucratique. Pour être en « adéquation » avec le mouvement historique, être adapté à la situation politique actuelle, il ne doit pas compter uniquement sur le discernement de ses chefs. Il doit avant tout compter sur son ouverture à la spontanéité et aux initiatives des masses et de sa base. C’est ce dont l’on se rend compte si l’on examine a contrario les causes du « fétichisme organisationnel » :
« Comment peut-on décrire le fétichisme ? Un organisme collectif est constitué d’individus particuliers qui forment l’organisme dans la mesure où ils se sont donnés et acceptent activement une hiérarchie et une direction déterminée. Si chaque composant individuel pense l’organisme collectif comme une entité étrangère à lui-même, il est évident que cet organisme n’existe plus de fait, mais devient un fantasme de l’esprit, un fétiche »[25].
L’activité des membres du parti et de sa base sociale est donc une nécessité afin d’éviter la sclérose de l’organisation. En ce sens, la démocratie n’est pas uniquement le but final de la lutte révolutionnaire – censée aboutir à une situation d’auto-gouvernement généralisée – mais également l’un de ses moyens les plus efficaces.
Parce qu’il est caractérisé par le mouvement, « le centralisme démocratique offre une formule élastique, qui se prête à de nombreuses incarnations ; elle vit dans la mesure où elle est interprétée et continuellement adaptée aux nécessités »[26]. Il est donc impossible de donner des solutions clés en main garantissant une saine vie démocratique de parti. Gramsci décrit cependant parfois plus concrètement cette démocratie partidaire et ses conditions.
La dialectique démocratique réellement existante
La démocratie que l’on recherche ne peut pas être définie d’une manière purement formelle ou procédurale. Par exemple, le vote des militant-e-s sur les questions importantes, est bien sûr requis. Mais il s’agit d’une garantie insuffisante, pour différentes raisons : il peut être manipulé ou orienté ; les dirigeant-e-s peuvent choisir le contenu et les termes du vote ; enfin, la dialectique démocratique ne doit pas concerner uniquement les militant-e-s du Parti, mais également la base sociale dans son ensemble : or celle-ci ne peut pas s’exprimer par des procédures démocratiques formelles qui ne valent qu’à l’intérieur du Parti.
En premier lieu, Gramsci considère que « pour que le parti vive et soit au contact des masses, il faut que chaque membre du parti soit un élément politique actif, un dirigeant »[27]. Il faut donc favoriser la participation des militant-e-s, presque dans le sens contemporain de « démocratie participative » : la base doit contribuer à l’élaboration des grandes lignes directrices, des questions importantes, et en débattre. Et, même s’il n’est pas toujours possible de l’obtenir, il convient au moins de rechercher le consensus autour des décisions prises. Cet élément peut être favorisé par l’organisation du Parti : Gramsci défendait ainsi l’organisation sur la base des cellules d’entreprises – et non plus de comités définis territorialement – parce qu’il les considérait comme plus aptes à favoriser la participation et l’activité des militant-e-s[28]. Cette conception était bien entendu liée à son expérience des Conseils d’usine dans l’Italie des années 1919 et 1920, où l’activité politique était directement ancrée dans la sphère de la production.
Un objectif essentiel consiste à éviter la bureaucratisation. Lorsque l’on analyse un parti, il faut distinguer « le groupe social ; la masse du parti ; la bureaucratie et l’état-major du parti ». Or, pour Gramsci, « la bureaucratie est la force routinière et conservatrice la plus dangereuse ; si elle finit par constituer un corps solidaire, qui existe pour lui-même et se sent indépendant de la masse, le parti finit par devenir anachronique et, dans les moments de crise aiguë, il se vide de son contenu social et demeure comme perché dans les nuages »[29].
Afin d’éviter cet écueil, comme l’affirme Jean-Marc Piotte, l’un des premiers commentateurs francophone de Gramsci, un élément de solution consiste à « plonger la bureaucratie dans une large couche moyenne de cadres dynamiques »[30]. En outre, il est préférable que ceux-ci soient issus des masses, et en particulier du prolétariat. En effet, c’est lorsque le clivage entre dirigeant-e-s et dirigé-e-s recoupe un clivage de classes que l’organisation hiérarchique du Parti risque le plus de se scléroser et de tomber dans une logique bureaucratique. Telle était précisément la situation du Parti socialiste italien d’après Gramsci : les cadres du PSI étaient presque tous des petits-bourgeois, ce qui renforçait la rupture entre la direction et la base, et entre le Parti et le prolétariat. A ses yeux, cela constitue l’une des raisons de la passivité du PSI lors des luttes des Conseils d’usine.
Cette expérience fondatrice pour le révolutionnaire sarde constitue à ses yeux le cas paradigmatique d’une situation où la direction du Parti n’a pas su entrer en relation avec la spontanéité des luttes populaires parce que la dialectique entre le Parti et le Mouvement avait été rendue impossible. Une autre raison de cette impossibilité – qui indique donc en négatif une nouvelle condition de possibilité d’une vie démocratique de parti adéquate – est à chercher dans les liens « étranges » et trop étroits que le PSI entretenait avec la bureaucratie à la tête de la Confédération du travail (CGL) d’un côté, et avec son propre groupe parlementaire devenu largement indépendant de l’autre. Pour Gramsci, ce double « système de rapports faisait que concrètement le Parti n’existait pas comme organisme indépendant, mais seulement comme élément constitutif d’un organisme plus complexe qui avait tous les caractères d’un parti du travail, décentré, sans volonté unitaire, etc. »[31].
La fragmentation organisationnelle et l’absence de cohérence dans l’action du Parti n’est en rien une garantie de fonctionnement démocratique : elle permet au contraire aux intérêts corporatistes et aux opportunismes de toutes sortes de s’exprimer directement.
Outre les dimensions sociologiques et organisationnelles que nous venons d’évoquer, un autre élément important doit nourrir la vie du Parti : l’éducation. Comme on l’a dit, cette dernière ne doit pas être vue comme unilatérale. Il n’y a pas de doctrine établie à enseigner magistralement ; le marxisme lui-même, clé de voûte de l’éducation politique, est pour Gramsci une « philosophie de la praxis », vivante et ouverte. Il s’agit donc d’établir une dialectique également à ce niveau : le Parti ne peut diriger la réforme culturelle et morale des masses populaires que parce qu’il exprime les sentiments populaires, et que ses dirigeant-e-s les ont faits revivre en eux et les ont faits leurs. C’est en particulier dans la lutte qu’une telle relation peut s’établir : c’est en militant parmi la base qu’un cadre peut s’éduquer et éduquer les autres.
Pour reprendre les termes d’André Tosel, il faut parvenir à mettre en place un « cercle pédagogique »[32] vertueux entre les intellectuels et les masses : ce n’est que par le contact avec les masses que les intellectuels peuvent apprendre, et notamment apprendre à leur enseigner ; cet apprentissage n’a lui-même pour but que d’être diffusé à son tour dans les masses, et d’accroître ainsi le degré de cohérence et de réalisme de leur conception du monde ; ce qui permet un nouvel apprentissage de la part des intellectuels, à un niveau supérieur d’élaboration intellectuelle (un « sens commun » rénové), etc.
Un dernier élément permettant de préciser le sens que Gramsci donne au centralisme démocratique est sa conception de la discipline militante. D’un côté, il rappelle que « tout membre du parti, quelle que soit la position ou la charge qu’il occupe, est toujours un membre du Parti et il est subordonné à la direction de celui-ci »[33]. Mais il affirme également que la discipline ne doit pas être « externe ou coercitive » :
« Comment la discipline doit-elle être entendue, si par ce mot on entend un rapport continu et permanent entre gouvernants et gouvernés qui réalise une unité collective ? Non certes comme une prise d’ordres passive et servile, comme l’exécution mécanique d’une consigne (ce qui peut être pourtant nécessaire dans des circonstances données, comme par exemple au milieu d’une action déjà décidée et commencée), mais comme une assimilation consciente et lucide de la directive à réaliser. La discipline n’annule donc pas la personnalité au sens organique, mais limite seulement l’arbitraire et l’impulsivité irresponsable, sans parler de la vaine fatuité de s’illustrer »[34].
Ainsi, la base peut consentir à ne pas avoir de droit de regard sur la tactique, parce qu’elle comprend les exigences imposées par la stratégie, à l’élaboration de laquelle elle a participé. Plus généralement, une telle discipline repose sur l’intériorisation d’une nouvelle culture, d’objectifs politiques généraux et de grands principes d’action, eux-mêmes forgés en commun. Et elle débouche sur une action résolue dérivant d’une analyse concrète des nécessités de la situation. Autrement dit, elle est un conformisme actif, qui s’oppose à l’arbitraire non pour nier la liberté de l’individu, mais au contraire pour réaliser et déployer une liberté véritable. Gramsci écrit ainsi que « dans les partis, la nécessité est déjà devenue liberté et de là naît la très grande valeur politique (…) de la discipline interne d’un parti et donc la valeur de critère d’une telle discipline pour évaluer la force d’expansion des différents partis »[35].
Lorsqu’il s’engage dans un parti, un individu déterminé par sa situation sociale prend conscience de cette dernière et l’assume volontairement : cela lui permet de transcender ses intérêts immédiats et de défendre consciemment – et donc librement – les intérêts historiques fondamentaux de sa classe. Mais au fond seul le parti des classes subalternes a réellement besoin d’une telle discipline interne, qui est une condition de possibilité de sa force expansive dans les masses, et de la cohérence de ses actions. Et il est également le seul à pouvoir véritablement la posséder. En effet, ce n’est que si les membres du parti sont poussés par un intérêt historique à l’émancipation que la liberté à venir peut réellement être préfigurée dans la nécessité actuelle. Pour tout autre parti, la discipline sera au contraire rapidement rongée par les intérêts immédiats et particuliers, dissolvant toute fermeté d’action dans un opportunisme court-termiste.
Ces quelques spécifications des notions de « dialectique entre spontanéité et direction consciente » et de « centralisme démocratique » donnent quelques indices de la manière dont Gramsci pensait résoudre la tension entre la logique de l’émancipation (qui vise à l’abolition de toute structure de domination, que ce soit la société de classe, l’État ou le Parti) et la logique de l’organisation (qui requiert un parti hiérarchisé, centralisé, dirigiste et assurant sa propre perpétuation). Du point de vue de Gramsci lui-même, ces éléments participent d’une tâche infinie, puisque la construction du Parti révolutionnaire ne sera véritablement achevée que lorsqu’il aura accompli son œuvre, et qu’il aura donc disparu : ils ne sont donc que partiels.
Surtout, en conformité avec l’« historicisme absolu » prôné par les Cahiers, ils peuvent connaître des mises en œuvre différentes au fil du temps. Je voudrais donc, pour conclure, évaluer la pertinence des solutions gramsciennes au problème du Parti, notamment à l’aune de la situation actuelle.
Les problèmes de la solution gramscienne
1. Le Parti dans son sens large et son sens formel
On a dit qu’André Tosel considère qu’une véritable éducation politique établit un cercle pédagogique entre les intellectuels et les masses, entre la pensée critique – et tendant à la cohérence – des premiers et le sens commun passionnel des secondes. Il ajoute, plus généralement, que toute activité politique émancipatrice doit s’inscrire dans un « cercle vertueux qui passe par plusieurs points et unit ces points : ce sont les masses subalternes des simples, leur sens commun (…), la philosophie cohérente et sa critique, le parti[36] et l’État traducteur de cette critique en action[37], et le sens commun rénové »[38].
En définitive, le Prince moderne ne consiste pas tant en une organisation formellement délimitée, mais dans ce cercle vertueux, dans ce processus dynamique qui renforce l’auto-activité et l’auto-gouvernement des classes subalternes. Ce cercle consiste, pour le dire en d’autres termes, dans les dialectiques imbriquées que nous avons analysées : entre la direction et les militant-e-s ; entre l’organisation et la classe ; éventuellement entre la classe subalterne tendant à construire son hégémonie, et les classes alliées, etc. Il est évident que ce processus dynamique est éminemment fragile, et que même si l’on parvient à l’établir il peut se « gripper » à tout instant.
Gramsci affirmait explicitement que la notion de Parti, bien comprise, excédait les limites étroites qu’on lui fixe communément : « le parti politique n’est pas seulement l’organisation technique du parti lui-même, mais tout le bloc social actif dont le parti est le guide, parce qu’il en est l’expression nécessaire »[39]. Le parti est donc moins un type d’organisation déterminé que le moyen le plus efficace de donner une expression homogène et cohérente aux classes auxquelles il est lié. C’est en ce sens que Gramsci peut dire qu’« en Italie, à cause de l’absence de partis organisés et centralisés, on ne peut pas faire abstraction des journaux : ce sont les journaux, regroupés par séries, qui constituent les vrais partis »[40].
Il n’en reste pas moins que dans les moments décisifs, les situations critiques, les intérêts de certaines classes ne peuvent être défendus que par une organisation. Pour les classes dominantes, les partis au sens strict sont presque superflus car l’État lui-même peut remplir cette fonction. Pour les classes dominées il n’en va pas de même, et la confiance en un parti « empirique »[41], parti-classe[42] ou pour reprendre les termes de Gramsci déjà cités en un « parti du travail, décentré, sans volonté unitaire, etc. », si elle conduit à considérer comme superflue une organisation structurée et avec des objectifs clairs, peut mener à la catastrophe. Ce fut le cas durant la séquence de l’après-guerre italien, où en l’espace de deux ans on passa d’une situation quasi-révolutionnaire à un régime fasciste. Il faut garder à l’esprit que « les partis naissent et se constituent en organisations pour diriger la situation dans des moments historiquement vitaux pour leurs classes »[43].
Le terme « parti » peut donc être pris en un sens « large » ou en un sens « formel »[44]. On peut affirmer que le parti au sens « formel », l’organisation strictement délimitée, est la « forme » dont le « contenu » n’est autre que la classe elle-même, forme et contenu qui entretenant une relation dialectique, avec toutes les complexités que nous avons examinées.
La principale limite de la conception que Gramsci élabore du Parti apparaît alors : il a pour idéal une adéquation parfaite du contenu et de la forme. Il désire que le parti « large » se rapproche le plus possible du parti « formel ». Ce qui signifie défendre – du moins le temps de créer une « nouvelle culture » – une version progressive de la « politique totalitaire »[45] dont le fascisme était la version réactionnaire. Une telle politique
« tend justement : 1° à obtenir que les membres d’un parti déterminé trouvent dans ce seul parti toutes les satisfactions qu’avant ils trouvaient dans une multiplicité d’organisations, c’est-à-dire à rompre tous les fils qui liaient ces membres à des organismes culturels étrangers au parti ; 2° à détruire toutes les autres organisations ou à les incorporer dans un système où le parti est le seul régulateur »[46]
2. Les anachronismes de Gramsci
Même si l’on distingue rigoureusement le sens de ce terme de celui qu’il a pour nous, la défense d’une telle « politique totalitaire » est évidemment difficilement recevable. Plus profondément, elle semble contredire la conception dynamique et dialectique du Parti que nous avons esquissé : celle d’un parti dont la vie démocratique interne n’est possible que s’il est ouvert aux masses subalternes et au mouvement historique de leur émancipation. Or, une organisation véritablement « totalitaire », qui demanderait à ses membres de couper leurs liens avec toutes autres organisations, semble bien incapable de mettre en œuvre le « cercle vertueux » requis pour éviter la sclérose bureaucratique.
La défense de cette politique par Gramsci n’est pas une incohérence passagère, uniquement due à la volonté de subvertir l’un des mots-clés du régime fasciste. Elle est appelée par plusieurs présupposés : la tendance à penser que le parti est la seule forme politique adéquate à l’expression du contenu social ; l’idée implicite que le parti-classe ne peut trouver son accomplissement que dans un et un seul parti-organisation ; le postulat que chaque parti représente par essence une et une seule classe. Or, chacun des ces présupposés est contestable, et peut être dans une certaine mesure considéré comme anachronique.
Il n’est pas question de critiquer l’importance accordée par Gramsci à la forme parti. Cependant, il semble incontestable qu’existent d’autres moyens d’expression du contenu socio-économique. Puisque nous traitons de la conception du communiste italien, nous parlerons uniquement de la lutte des classes et nous laisserons de côté les autres revendications progressistes – féministes, anti-racistes, anti-impérialistes, écologistes, etc. – et les différents types de mouvements, collectifs, associations, etc., qui leur sont associés. Même pour la lutte de classe conçue d’une manière traditionnelle, donc, il est indéniable que les syndicats, les conseils d’usine ou les assemblées générales constituent d’autres formes politiques. Il convient donc de penser leurs articulations complexes avec le Parti, qui ne peuvent pas se réduire à une hiérarchie unilatérale, l’initiative et la préséance ne revenant qu’au Parti. C’est d’ailleurs ce que faisait le jeune Gramsci. En 1919 et 1920, l’embryon d’État prolétarien n’était pas à ses yeux le Parti mais les Conseils d’usines. Pour comprendre cela, il faisait une distinction entre l’agent et la forme du processus révolutionnaire :
« les organismes de lutte du prolétariat sont les « agents » de ce colossal mouvement de masse ; le Parti socialiste est indubitablement le principal « agent » de ce processus de désagrégation et de restructuration, mais il n’est pas (…) la forme même de ce processus. La social-démocratie germanique (…) a réalisé le paradoxe de plier par la violence le processus de la révolution prolétarienne allemande aux formes de son organisation, et elle a cru dominer ainsi l’histoire. Elle a créé « ses » conseils, autoritairement, avec une majorité sûre, choisie parmi ses hommes : elle a mis des entraves à la révolution, elle l’a domestiquée »[47].
Il faut donc concevoir que les conseils sont relativement autonomes par rapport au parti, et qu’ils sont une forme bien plus adaptée au développement du mouvement de masse. Ce qui ne signifie bien évidemment pas que le (ou les) parti(s) doivent s’interdire d’intervenir dans ces conseils ou assemblées générales, d’y porter leurs mots d’ordres ou leurs programmes. Ni encore moins qu’ils doivent abandonner la création de tels conseils ou assemblées à la pure spontanéité. Ils doivent au contraire tout faire pour qu’ils apparaissent dès que cela est possible, comme Gramsci lui-même lorsqu’il œuvrait à la transformation des organes techniques qu’étaient les conseils d’usine en instruments d’organisation et de lutte du prolétariat. Mais cet activisme des membres du parti ne se comprend que si l’on fait droit à l’importance des conseils. Or, les Cahiers semblent avoir laissé de côté ce pluralisme des formes politiques d’expression de la classe prolétarienne en lutte.
Le second présupposé implicite chez Gramsci est le refus du pluralisme partidaire. Déjà à son époque, plusieurs parti-organisations revendiquaient la représentation du parti-classe : le PSI et le PCI, ainsi que d’autres regroupements socialistes. Pourtant, son objectif restait que « se forme un lien étroit entre la grande masse, le parti, le groupe dirigeant », et que « tout le complexe, bien articulé, puisse se mouvoir comme un « homme collectif » »[48]. De nos jours, une telle union entre le prolétariat et un seul parti semble inenvisageable à court, ou même à moyen terme.
En outre, il nous est difficile de savoir quels critères utiliser pour distinguer les partis ouvriers des autres, de distinguer les partis « ouvriers » des autres, puisque la composition sociologique de l’électorat et/ou des militant-e-s ne permet plus de trancher[49]. La situation actuelle est en ce sens radicalement différente de celles des années 1970 où, quel que soit le jugement que l’on pouvait porter sur sa ligne politique, le PCF était incontestablement un parti ouvrier par la composition sociologique de son électorat et de sa base militante. C’est la raison pour laquelle le critère du « parti ouvrier » est beaucoup moins susceptible d’éclairer les forces politiques se revendiquant du marxisme dans le choix de leurs alliances politiques. Faut-il accepter tous les partis anti-libéraux et anti-austéritaires ou se restreindre aux partis révolutionnaires anticapitalistes[50] ?
Quoi qu’il en soit, et quelle que soit la réponse que l’on choisit de donner à cette question, aucun de ces partis ne semble pouvoir prétendre représenter seul le parti-classe. Et il est même vraisemblable que si l’on envisage qu’un parti puisse le faire à long terme, il aura connu de telles mutations (scissions, rapprochements, changements de forme, etc.) au cours de son passage d’une organisation de quelques milliers de membres à plusieurs centaines de milliers, voire de plusieurs millions, qu’il sera difficile de le comparer à ce qu’il est actuellement. Dès lors, toute stratégie politique doit accepter le pluralisme des organisations comme seul horizon réaliste.
Cette conclusion complète la précédente, qui concernait le pluralisme des formes politiques. En effet, chaque parti anti-libéral et/ou anti-capitaliste est contraint d’accepter l’existence des autres, et doit accepter d’agir avec eux, dans le cadre de formes d’expression politique différentes des partis et rendant possible un front unique[51] (collectifs anti-austérité, assemblées générales, etc.)[52], d’autant plus si ce sont des organes d’auto-organisations propres à un mouvement social ou à une lutte, et non des cartels d’organisations pré-constituées.
Pour autant, ce n’est pas parce qu’aucun parti ne peut espérer former seul un « homme-collectif » avec les « masses » en « standardisant les sentiments populaires » qu’il faut abandonner l’attitude que Gramsci lie à cet objectif : entretenir des liens de « co-participation active et consciente », de « compassionnalité » avec les classes subalternes. Et il reste nécessaire de mener une politique culturelle et sociale active en lien avec différentes associations, organisations culturelles, médias indépendants, revues et intellectuels engagés, etc.
Mais ce n’est peut-être pas du fait de son double rejet du pluralisme des formes politiques et du pluralisme partidaire que la conception de Gramsci est la plus anachronique. Comme on l’a dit, à ses yeux, un seul parti représente fondamentalement une et une seule classe. En temps « normal », c’est-à-dire où l’hégémonie dominante est stabilisée, il peut y avoir plusieurs partis par classe. Mais en temps de crise, les antagonismes se clarifient : « la vérité qui veut que chaque classe ait un seul parti se démontre, dans les tournants décisifs, du fait que des groupes différents, qui se présentaient chacun comme un parti « indépendant », se réunissent et forment un bloc unitaire »[53]. Ce postulat gramscien est peut-être le plus éloigné de notre réalité présente : malgré les différents tournants décisifs que nous avons connus depuis les années 1980, il semble que la structure de l’espace politique des partis se soit de plus en plus détachée des rapports socio-économiques.
Le caractère anachronique de cette affirmation n’invalide pas les autres : il est même d’autant plus urgent de « travailler sans cesse à élever intellectuellement des couches populaires toujours plus larges, c’est-à-dire travailler à donner une personnalité à l’élément de masse amorphe, ce qui signifie travailler à susciter une élite d’intellectuels d’un type nouveau qui sortent directement de la masse tout en restant en contact avec celle-ci pour devenir les « baleines » du corset. Cette seconde nécessité, si elle est satisfaite, est celle qui modifie réellement le « panorama idéologique » d’une époque »[54]. Autrement dit, il est nécessaire de travailler à donner une unité et une cohérence aux classes subalternes, aujourd’hui autant fragmentées politiquement et désorientées idéologiquement qu’exploitées économiquement. C’est parce que la prétention d’un quelconque parti de représenter une et une seule classe est vaine que cette tâche garde toute son actualité.
A son modèle de construction « totalitaire » d’un « homme-collectif » fondée sur une profonde compréhension des masses, Gramsci opposait une logique différente. Il considérait qu’elle avait caractérisé l’époque précédente, et était dépassée par la sienne (l’époque de la politique et des partis de masse). Cette pratique politique anachronique à ses yeux était qualifiée de « charismatique ». Elle consiste, pour un petit nombre de « chefs » à diagnostiquer les sentiments des masses par intuition ou par « l’identification de lois statistiques », et à les traduire en « idées force, en slogans » afin d’obtenir le soutien des « masses »[55]. La crise actuelle des partis de masse remet en cause, comme nous l’avons dit, un certain nombre d’éléments de la conception gramscienne.
Revenir à une telle politique démagogique et personnaliste qui consiste principalement à louvoyer parmi les courants d’opinion serait cependant, pour des forces politiques progressistes, un anachronisme plus grave encore qu’une application a-critique des conceptions gramsciennes. Adopter une attitude court-termiste et sans perspective d’élaboration collective, en arguant du caractère « amorphe » des classes subalternes, serait une véritable démission, alors que de profondes luttes idéologiques pour contester l’hégémonie dominante sont plus que jamais à l’ordre du jour.
Les œuvres d’Ernesto Laclau et de Chantal Mouffe, qui s’inspirent largement de Gramsci, semblent néanmoins apporter leur caution à une telle tendance. Leur post-marxisme, qu’on pourrait également qualifier de post-gramscisme, part du refus de tout « essentialisme », et s’interdit donc de présupposer des identités pré-constituées – notamment celle de la classe ouvrière – sur lesquelles il serait possible de faire reposer une stratégie et un programme politique[56]. Pour eux, les identités et les acteurs socio-politiques sont définis par les relations d’antagonisme ou d’alliance qu’ils entretiennent avec les différents autres acteurs en présence. La question clé est alors de déterminer la bannière sous laquelle rassembler une multiplicité d’acteurs aux demandes hétérogènes, afin de les mobiliser contre un adversaire commun. Pour Laclau[57] et Mouffe, ce sont les individualités politiques charismatiques qui sont le mieux à même de rassembler de tels sujets collectifs aux identités partielles et en redéfinition perpétuelle. A partir d’un usage de Gramsci qui n’en respecte ni la lettre ni l’esprit, nos auteurs en arrivent donc à défendre une conception populiste, fondée sur le rôle d’individus exceptionnels, auxquels les masses sont censées s’identifier. A leurs yeux, le programme n’est plus fondamental, et peut même s’avérer impossible à établir, dans la mesure où la politique populiste implique d’articuler des demandes divergentes, et dans certains cas inconciliables entre elles. La distinction entre révolution et réforme n’a plus de raison d’être puisqu’une ligne politique ne sera plus considérée comme bonne ou mauvaise en fonction de ses objectifs et de la stratégie qu’elle propose pour les réaliser, mais plutôt en fonction de sa capacité à mobiliser et à unifier subjectivement un « peuple ». Or, cette capacité réside en premier lieu dans la personne et le poids symbolique du leader. Le rôle des organisations sociales et politiques devient donc secondaire, et la forme parti apparaît comme trop rigide et passéiste. La théorie de Laclau et Mouffe laisse entendre que cette forme politique postule l’existence d’un groupe socio-économique pré-constitué que le parti n’aurait qu’à représenter dans la sphère politique ou dont il devrait éclaircir la conscience sociale obscure.
Les critiques qu’ils émettent contre la conception marxiste des classes et du parti sont parfaitement irrecevables lorsqu’elles sont dirigées contre la pensée de Gramsci : ce que nous avons exposé dans cet article lemontre. Pour lui, le parti n’entretient pas une relation d’extériorité avec la classe, que ce soit parce qu’il la représenterait ou parce qu’il lui apporterait la vérité sur elle-même. Le parti doit au contraire être une partie[58] de la classe : il ne peut agir efficacement que s’il entretient avec elle une relation d’immanence. Ce qui signifie en retour que la classe n’est pas pré-constituée puisque le parti agit en elle pour la structurer en tant qu’acteur collectif et donner une plus grande cohérence et pertinence aux conceptions du monde qui sont les siennes. En un mot, le parti constitue la classe dans la mesure même où il parvient à s’en faire l’expression. C’est cette identité dialectique, et non l’identification immédiate et irrationnelle entre un leader et son peuple, qu’une politique émancipatrice doit promouvoir.
Notes
[1] C13, §21, p. 398. Nous citons les Cahiers de prison dans l’édition Gallimard (Paris, 1978-1996). Conformément aux normes de citation en vigueur, nous indiquons le numéro du cahier à la suite de la lettre C, puis nous indiquons le numéro de la note (précédé du signe §).
[2] « Détachement spécial d’hommes armés », comme le dit Lénine dans l’État et la révolution (https://www.marxists.org/francais/lenin/works/1917/08/er1.htm).
[3] « Maintenir l’État », cf Le Prince, Chapitre XVIII.
[4] « Un nouveau livre de Vandervelde sur l’État » (https://www.marxists.org/francais/lenin/works/1918/10/vl19181000.htm).
[5] Cf. L’État et la révolution (https://www.marxists.org/francais/lenin/works/1917/08/er1.htm).
[6] Ce qui signifie que chaque parti correspond, en dernière instance, à une et à une seule classe.
[7] C15, §4, p. 108.
[8] C’est en 1924 que Staline (notamment dans sa conférence publiée ensuite sous le titre Les principes du léninisme) et Zinoviev (qui était président de l’Internationale communiste au moment de son Vème Congrès) ont commencé à résumer le « léninisme » officiel en quelques formules dogmatiques.
[9] Un tel esprit d’initiative et une telle fermeté d’action firent cruellement défaut au prolétariat italien durant le mouvement des Conseils d’usine (1919-1920) que le PSI ne soutint pas, et dirigea encore moins, à l’exception du petit groupe organisé autour de Gramsci et de la rédaction de l’hebdomadaire Ordine Nuovo. Cette démission, voire cette trahison du PSI, furent l’une des raisons qui poussèrent Gramsci à promouvoir la scission avec les socialistes et à participer à la fondation du PCI au Congrès de Livourne en 1921, afin de forger une organisation réellement révolutionnaire.
[10] C14, §70, p. 88.
[11] C12, §1, p. 318.
[12] Cette expression, qui ne se trouve pas littéralement dans les textes de Gramsci, a été forgée par Togliatti. Mais elle respecte incontestablement l’esprit du révolutionnaire sarde.
[13] C24, §3, p. 292.
[14] C11, §67, p. 300.
[15] Nous empruntons cette expression à un texte tardif d’Althusser, mais elle nous semble éclairer la conception gramscienne : « non seulement le communisme est une tendance objective de la lutte des classes, d’ores et déjà inscrite dans l’histoire actuelle, mais il existe déjà dans le monde des îlots de communisme : là où il n’existe plus de rapports marchands, par exemple dans des libres associations (quand elles sont effectivement libres, c’est-à-dire démocratiques, la suppression des rapports marchands n’étant qu’une condition négative, comme les partis communistes ou les syndicats ouvriers, ou même dans d’autres communautés, par exemple religieuses, quand elles participent à la lutte des classes. Sans doute, on pourra objecter que le communisme n’existe que dans l’idéologie, et partiellement dans la politique, et qu’il est isolé dans ces sphères, car il n’a pas encore gagné la sphère de la production ; Mais du communisme existe aussi, quoique sous une forme dominée par le rapport d’exploitation capitaliste, dans certaines coopératives de production îlots isolés certes dans la mer du capitalisme mais qui témoignent du moins d’une autre possibilité que celle du rapport de production capitaliste. Non, le communisme n’est pas une utopie, mais une réalité extrêmement fragile qui existe déjà dans notre société » (Louis Althusser, Lex Vaches noires, Paris, PUF, 2016, pp. 264-5).
[16] C13, §1, p. 356.
[17] C13, §1, p. 358.
[18] C11, §25, p. 228.
[19] G. Lukacs, La Pensée de Lénine, trad. J-M. Brohm, B. Fraenkel et C. Heim, Paris, Denoël, 1972, p. 47.
[20] C3, §119, p. 330.
[21] C13, §36, p. 429.
[22] Idem., p. 430
[23] Ce terme sous la plume de Gramsci semble renvoyer à la conception dirigiste et sectaire de son rival et prédécesseur à la tête du PCI, Amedeo Bordiga. Mais les réflexions de Gramsci ont une portée plus générale, et peuvent être lues comme une critique du stalinisme. Il est même envisageable qu’elles comportent une dimension auto-critique : Gramsci fut en effet l’un des artisans de la « bolchevisation » du PCI, mise en œuvre après le Vème Congrès de l’Internationale Communiste, sous l’impulsion de Zinoviev. Pour Peter Thomas, l’émergence du concept de Prince moderne lui-même « participe d’une autocritique implicite par Gramsci de son rôle dans le processus de « bolchévisation » du parti italien » (Voir http://www.revueperiode.net/lhypothese-communiste-et-la-question-de-lorganisation/).
[24] Les terme de « fétichisme organisationnel », « fétichisme d’organisation » ou « de l’organisation » est un terme utilisé fréquemment dans les polémiques internes au mouvement ouvrier international. Il est souvent utilisé pour dénoncer des phénomènes de bureaucratisation ou d’autoritarisme dans une organisation prolétarienne, qui risque de les couper du mouvement des masses, et de faire oublier qu’elle n’est rien de plus qu’un outil d’émancipation au service de ces masses. Si l’on suit Henri Weber (Marxisme et conscience de classe, Union Générale d’Éditions, 1975, pp. 226 et suivantes), Rosa Luxemburg est à l’origine, sinon de l’expression exacte, du moins du concept. Elle l’utilise notamment dans le cadre de sa critique des dérives opportunistes du SPD. Elle évoque ainsi « la tendance à surestimer l’organisation qui, peu à peu, de moyen en vue d’une fin se change en une fin en elle-même, en un bien suprême auquel doivent être subordonnés tous les intérêts de la lutte » (Grève de masse, partis et syndicats [1906], Maspéro, 1964, p. 91). Quoi qu’il en soit, Trotsky emploie l’expression elle-même dans Nos tâches politiques en 1904, texte polémique écrit en réaction à Que faire ? (Paris, Belfond, 1970, pp. 112, 140, 176 et 204). Elle restera présente tout au long de son œuvre, malgré les modifications de sa ligne politique. Par la suite, l’expression apparaît fréquemment dans des textes venant de courants de gauche – notamment conseillistes – du mouvement communiste international, à la fois contre les socio-démocrates et les bolcheviks. Chez Gramsci, ce n’est pas le léninisme qui est visé, mais le bordiguisme. C’est par exemple dans les Thèses de Lyon (texte officiellement intitulé « La situation italienne et les objectifs du PCI »), adoptées par le IIIème congrès du PCI qui a vu la victoire de la ligne de Gramsci sur celle de Bordiga, que l’on peut trouver l’expression de « fétichisme » à propos du front unique antifasciste que les communistes ont pour tâche de construire : « Il faut considérer la question sans privilégier de façon fétichiste une forme déterminée d’organisation, en se rappelant que notre objectif fondamental est de parvenir à une mobilisation et une unité organique de plus en plus vastes des forces ».
[25] C15, §13, p. 125.
[26] C13, §36, p. 430.
[27] « Pour que le parti vive et soit au contact des masses il faut que chaque membre du parti soit un élément politique actif, un dirigeant. Précisément parce le parti est fortement centralisé, on a besoin d’un large travail de propagande et d’agitation dans ses rangs, et il est nécessaire que le parti, d’un point de vue organisationnel, éduque ses membres et en élève le niveau idéologique. Centraliser veut dire justement rendre possible que, dans n’importe quelle situation, même dans un état de siège aggravé, même quand les comités dirigeants ne peuvent pas fonctionner pour un certain temps ou sont mis en situation de ne pas pouvoir se réunir avec leurs subordonnés, tous les membres du parti, chacun dans son milieu, soient en mesure de s’orienter, de savoir tirer de la réalité les éléments de quoi déterminer une direction, afin que la classe ouvrière ne soit pas abattue, mais ait le sentiment d’être guidée et se sente encore capable de lutter. La préparation idéologique de masse est donc une nécessité de la lutte révolutionnaire ; elle est une des conditions indispensables de la victoire » (« Nécessité d’une préparation idéologique de masse » [mai 1925, publié pour la première fois dans Lo Stato operaio en mars-avril 1931], in Scritti politici, Rome, Editori Riuniti, 1967, p. 603 [ma traduction, Y.D]).
[28] Cet élément est très ambigu. En effet, l’organisation en cellules d’entreprises a été prônée par l’IC dans le cadre de la bolchevisation des partis communistes hors d’URSS. Elle semble donc avoir été très loin de favoriser la démocratie interne. D’après Robert Paris, elle avait ainsi pour principal effet de « quadriller le parti et d’en renforcer l’homogénéité » (Introduction aux Écrits politiques (1923-1926), vol. 3, Paris, Gallimard, p. 21).
[29] C13, §23, p. 401.
[30] Jean-Marc Piotte, La pensée politique de Gramsci, Montréal, Lux, 2010, p. 94.
[31] C3, §42, p. 287.
[32] André Tosel, Étudier Gramsci, Paris, Kimé, 2015, p. 285.
[33] C3, §42, p. 287.
[34] C14, §48, pp. 62-3.
[35] C7, §90, p. 233.
[36] Que l’on pourrait lui-même différencier entre sa direction et sa base militante comme on l’a vu.
[37] Il s’agit évidemment de l’État prolétarien post-révolutionnaire, autrement dit de la dictature du prolétariat, même si Gramsci n’emploie pas ce terme dans les Cahiers de prison.
[38] Tosel, Étudier Gramsci, op.cit., p. 203.
[39] C15, §55, p. 168.
[40] C1, §116, p. 109.
[41] Voir Henri Weber, Marxisme et conscience de classe, op.cit., p. 71.
[42] Dans le sens où Marx et Engels utilisaient le terme « parti » dans le Manifeste du parti communiste : le prolétariat lui-même en tant qu’il est pris dans son mouvement d’émancipation et qu’il lutte pour ses intérêts historiques les plus radicaux.
[43] C13, §23, p. 401.
[44] C6, §136, p. 116.
[45] Terme qui possède évidemment un sens radicalement distinct de celui qu’il aura après la seconde guerre mondiale, lorsqu’il désignera, sous la plume d’Hannah Arendt ou de Raymond Aron, l’écrasement de toute individualité sous la totalité sociale censé caractériser tant le pouvoir nazi que les régimes soviétiques.
[46] C6, §136, p. 117.
[47] « Le parti et la révolution », in Ordine nuovo, 1ère série, n°31, 27 décembre 1919 (Écrits politiques (1914-1919), vol.3, Paris, Gallimard, 1974, pp. 294-5).
[48] C11, §25, p. 228.
[49] Le pourcentage d’ouvriers – ou même de membres des catégories populaires dans leur ensemble – dans l’électorat FN ou LR n’est pas inférieur à celui des différentes composantes de l’ex-front de gauche.
[50] Le fait que le NPA soit le seul parti à présenter un candidat ouvrier à l’élection présidentielle, ou que LO et le POI soient les seuls à faire figurer « ouvrier » dans les noms de leurs organisations, ne sont probablement pas des critères suffisants pour les qualifier de partis ouvriers si cela implique de refuser ce titre à d’autres organisations…
[51] Nous laissons de côté dans cet article la question du « front unique » chez Gramsci. Il est indéniable que la conception du « front unique » défendue par le IVème congrès de l’IC (1922) a fortement influencé la ligne politique de Gramsci, et a constitué l’un des principaux clivages entre la ligne sectaire de Bordiga et la sienne. Mais il faudrait se demander à quel point cette stratégie a influencé les réflexions des Cahiers de prison (alors que le terme lui-même apparaît très rarement), et dans quelle mesure la notion d’hégémonie recoupe l’idée de front unique.
[52] Rappelons que puisque nous discutons ici les thèses de Gramsci, nous laissons de côté les luttes – et les formes qui leurs sont liées – qui ne relèvent pas strictement de la lutte de classe anticapitaliste.
[53] C15, §6, p. 115.
[54] C11, §12, p. 191.
[55] C11, §25, p. 228.
[56] Laclau E. et Mouffe C., Hégémonie et stratégie socialiste [1985], Paris, Les Solitaires intempestifs, 2009.
[57] Laclau E., La Raison populiste, Paris, Le Seuil, 2008.
[58] L’un des multiples aspects du débat entre Gramsci et Bordiga autour de 1924 portait précisément sur cette question. Pour le second, qui était très sceptique quant la capacité des masses populaires à s’auto-organiser, le parti ne devait pas être une partie mais un organe de la classe, qui servait ses intérêts historiques mais dans une relation de séparation organisationnelle avec elle, et en agissant d’une manière autonome. Au fond, dans sa perspective, ce n’est que lors de la situation révolutionnaire que les masses rejoignent le parti, et que celui-ci peut se mettre à leur tête et les guider vers la victoire grâce à son expérience militante et à sa maîtrise théorique. Cette conception, mélange instable de spontanéisme – en ce qui concerne la mise en mouvement des masses à l’heure de crise révolutionnaire – et de sectarisme – pour le rôle et le fonctionnement de l’organisation – s’oppose radicalement à la vision dialectique exposée par Gramsci. Voir notamment la lettre écrite de Vienne par Gramsci le 9 février 1924, et adressée à Togliatti, Terracini et d’autres camarades proches (Écrits politiques II. 1921-1922, Paris, Gallimard, 1975, pp. 257-271).