
Race, racisme, racialisation. Penser ensemble l’antisémitisme et l’islamophobie
On sait depuis longtemps que la « race » n’est pas une donnée biologique mais une construction sociopolitique, historiquement située. Dans son livre récemment paru aux éditions Amsterdam, Reza Zia-Ebrahimi propose une histoire croisée de l’antisémitisme et de l’islamophobie. Il analyse notamment les stratégies de racialisation sur lesquelles reposent ces deux formes de racisme.
Contretemps vous propose un extrait du livre (tiré de l’introduction).
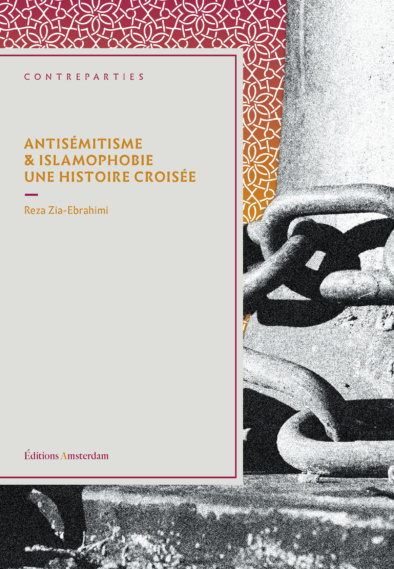
Théorie de la race et de la racialisation
Il est essentiel de définir les concepts de race et de racisme qui seront employés dans cet ouvrage[1]. En guise d’introduction, considérons le syllogisme principal du déni d’islamophobie : 1/ l’islamophobie critique l’islam ; 2/ l’islam n’est pas une race ; donc 3/ l’islamophobie n’est pas un racisme[2]. Cet argument est plus que contestable – et c’est un euphémisme. Tout d’abord, il existe un consensus scientifique quasi universel sur le fait qu’aucune race n’a d’existence externe et objective. Dès 1911, l’anthropologue Franz Boas, de l’université Columbia, a démontré que la supposée appartenance raciale d’un individu ne détermine pas son comportement ou ses capacités intellectuelles. Les conclusions de Boas, confirmées par les travaux du psychologue canadien Otto Klineberg, n’ont pas empêché le racisme de prospérer et d’atteindre son paroxysme au cours du xxe siècle[3]. Mais la recherche a poursuivi son cheminement. Par exemple, dans les années 1960, Michael Banton a soutenu que la race est un phénomène « socialement construit » ou un simple « discours », au sens foucaldien du terme. De leur côté, les anthropologues sont arrivés à la conclusion qu’on ne peut délimiter objectivement des groupes raciaux en se basant sur des différenciations morphologiques ou même génétiques, qui sont toutes progressives et irrégulières : définir les limites géographiques ou culturelles d’une « race » est dès lors un acte arbitraire et subjectif[4]. La réponse au raisonnement islamophobe est donc simple : bien que les races n’existent pas objectivement, elles existent dans l’esprit du raciste. C’est ce dernier phénomène qui constitue aujourd’hui l’objet d’étude des spécialistes des questions raciales.
Les définitions de la race abondent dans la littérature, mais pour le présent travail, nous la définirons de la manière suivante :
La race est un groupe socialement construit, et l’appartenance à ce groupe est perçue à tort comme déterminant les caractéristiques psychologiques, comportementales et morales de tous les individus qui en sont membres.
Le racisme ne constitue pas le simple fait d’épouser une vision raciale des groupes humains ; en d’autres termes, il ne s’agit pas uniquement d’un ensemble de préjugés. Ces préjugés ne deviennent structurellement opérants que dans le cas où il existe un rapport de domination entre une majorité et une ou plusieurs minorités. Nous définirons donc le racisme de la manière suivante :
Le racisme est une structure sociale dans laquelle des idées raciales sont employées afin de perpétuer la domination économique, sociale et culturelle exercée par une majorité sur un ou plusieurs groupes minoritaires.
Par conséquent, l’antisémitisme et l’islamophobie peuvent se définir simplement comme des racismes ciblant les juifs et les musulmans, les deux groupes étant socialement construits à l’intérieur d’une structure sociale qui domine économiquement, socialement et culturellement les individus présumés membres.
On nomme « racialisation » (ou racisation) le processus de « construction sociale » par lequel une population vient à être vue comme une race à part. Ce concept, qui sera au cœur du présent travail, peut être défini ainsi :
La racialisation est une stratégie discursive qui postule l’existence d’une race sur la base de certaines caractéristiques perçues comme essentielles.
Il n’est pas inhabituel de présumer que ces caractéristiques sont des différences supposées biologiques ou afférentes au corps, comme la couleur de la peau, la texture des cheveux, la stature, etc. Autrement dit, on racialise uniquement les groupes dont l’apparence est différente ou parce que l’on croit que la différence raciale se situe au niveau génétique. Notre apriori biologique s’explique par le poids du racisme de couleur dans l’histoire des structures racistes, allant de l’esclavage transatlantique aux sociétés coloniales et postcoloniales. En tant que pratique de la suprématie blanche, le racisme de couleur a engendré des structures socio-étatiques qui soumettent les Noirs à une domination sociale, politique et économique et – dans les cas extrêmes – les relèguent au rang d’objets[5]. Les colonies européennes en Afrique et aux Caraïbes, l’Amérique esclavagiste et plus tard ségrégationniste, le régime de l’apartheid en Afrique du Sud sont les exemples les plus flagrants de ce racisme de couleur. L’héritage du racisme ainsi conçu continue également à affecter l’égalité des chances et de traitement de certains groupes racialisés dans des sociétés post-esclavagistes comme les États–Unis (où il existe une littérature scientifique considérable sur le sujet, la Critical Race Theory) et postcoloniales comme la France.
L’apriori biologique a de bonnes raisons d’exister, notamment parce qu’une partie considérable des textes à caractère racial abordent la question de la diversité humaine dans une perspective biologique et naturaliste. Et, bien que l’on s’imagine que la racialisation biologique constitue un phénomène assez récent, on la trouve dans des textes très anciens, écrits entre le Moyen Âge et le xviiie siècle. Les travaux de Geraldine Heng ont par exemple démontré que le corps était au centre des préoccupations médiévales : la couleur de la peau, les qualités du sang, la physiologie, les humeurs et surtout les modalités selon lesquelles les corps héritent de ces caractéristiques ont joué un rôle primordial dans la naissance des idées raciales. Dans la chrétienté médiévale, on pense que le corps des juifs émet une odeur fétide (foetor judaicus), que les parties génitales des hommes juifs saignent – une forme de menstruation masculine – et que ces qualités sont transmises à leurs descendants[6]. Aux XVIIe et XVIIIe siècles, certains naturalistes sont convaincus que le sang des Africains est noir[7].
Cependant, la conceptualisation des races n’est pas uniquement biologique. On peut également racialiser sur la base de différences culturelles, y compris religieuses, réelles ou perçues. L’exemple classique de racialisation religio–culturelle est celui des juifs d’Europe, qui ne présentaient globalement pas de traits biologiques discernables de la population majoritaire. Pourtant, ils furent racialisés au point de subir des régimes de domination raciale stricts, comme dans la Russie du xixe siècle, sans parler de la période nazie, qui constitua la tentative de génocide la plus élaborée et la plus industrialisée de l’histoire humaine. Des théories biologiques furent énoncées à leur égard, en particulier pendant l’ère nazie, mais même les nazis, malgré leur foi inébranlable en la phrénologie et la raciologie biologique, ne réussirent jamais à mettre au point une méthode fiable pour identifier les juifs sans recourir à des indices religio–culturels et à des techniques héritées du Moyen Âge et de l’Inquisition, comme la généalogie, l’ouï–dire et le port de signes distinctifs[8]. En outre, la définition nazie du juif, malgré sa dimension biologique, ne s’est jamais affranchie de la figure du juif définie culturellement (comme parasitique, dominateur, usurier, cosmopolite, etc.) : il s’agit de fait d’une racialisation hybride.
Dans la majorité des cas, ces deux éléments, biologique et religio-culturel, se combinent et fonctionnent conjointement. La race est une relation structurée toujours composée de plusieurs facettes, non mutuellement exclusives. La discrimination que peuvent subir un juif ou une musulmane dans une situation spécifique, par exemple lors d’un entretien d’embauche, peut être due à un patronyme typique (Moshé, Fatima), à une identité religieuse visible (une étoile de David, un hijab), à une origine nationale ou régionale trahie par un accent (Russie, Maghreb) ou à des caractéristiques biologiques (nez prétendument proéminent, peau basanée). C’est, dès lors, un mélange de préjugés et d’indices d’identification à la fois religio-culturels et biologiques qui constitue le support de la discrimination. Nasar Meer et Tariq Modood ajoutent que, dans le cas plus spécifique de l’islamophobie, même en l’absence d’un profil ethnique musulman, une personne racialisée peut être physiquement identifiée grâce à des indices biologiques et culturels[9]. En voici un exemple : en 2016, à bord d’un train arrivant à la gare de mon quartier londonien, un forcené armé d’un couteau se mit soudain à crier : « Je vais me [sic] tuer un musulman[10] ! » Selon les témoins, il traversa le train en scrutant les passagers avant d’en sélectionner un et, sans échanger un mot, de lui planter son couteau dans le corps. La victime, un père de trois enfants dont le poumon fut perforé à plusieurs reprises, était effectivement un musulman d’origine bangladaise. L’agresseur l’avait identifié grâce à l’indice biologique que représentait la couleur brune de sa peau et à des indices culturels (ses vêtements et le fait que sa compagne était voilée). Le racisme religio-culturel de l’agresseur s’est donc manifesté sur la base d’une appréciation visuelle de l’appartenance de la victime au groupe racialisé.
Les négateurs des racismes religieux prétendront que la profession d’une religion est un choix et qu’un individu peut se soustraire aux préjugés religieux par un simple acte d’apostasie. Le postulat est douteux à plusieurs égards. D’abord, il exagère l’élément volontaire d’appartenance à un groupe religieux, car un individu est socialisé dans un contexte culturel spécifique : on ne choisit pas la famille ou l’environnement socio-culturel dans lesquels on naît, et il n’est pas toujours aisé, possible ou désirable de les quitter[11]. Deuxièmement, il présume que le changement sera accepté par le groupe majoritaire, ce qui n’est pas toujours le cas. Pendant l’Inquisition espagnole, le fait d’avoir des ancêtres juifs, pour les marranes, ou musulmans, pour les morisques, créait à leur encontre une présomption d’hérésie, même s’ils étaient convertis au christianisme depuis plusieurs générations. La -présomption d’hérésie étant absolument déterministe, ni la profession sincère du christianisme, ni aucun autre comportement individuel n’aurait pu effacer le préjugé raciste dont ils faisaient l’objet. De la même façon, lorsque les États allemands émancipèrent les juifs au XIXe siècle, ni l’assimilation, ni la conversion ne réduisit l’intensité de l’antisémitisme dont ils étaient victimes, bien au contraire. Dans un cas encore plus tranché, le baptême n’aurait pas pu sauver Anne Frank de la déportation, car l’identité raciale qui lui était assignée par l’ordre nazi était fixe et sans appel. Troisièmement, si l’argument de l’identité religieuse volontaire implique qu’exercer une pression sur ces minorités est bénéfique car cela permet de les « déjudaïser » ou de les « désislamiser », il faut reconnaître qu’il n’y a pas beaucoup de précédents historiques où ce type d’assimilation forcée a réussi. Spinoza nous apprend qu’au XVIIe siècle, la haine universelle des juifs n’a pas du tout conduits ces derniersà renoncer à leur foi ; au contraire, elle les a incités à préserver une identité distincte. Au vu de tout cela, il est probable que, pour revenir à notre exemple, Moshé et Fatima seraient dans la plupart des cas discriminés en tant que juif et musulmane, même en l’absence de signes religieux, voire de toute croyance religieuse.
Il est néanmoins possible de soutenir, dans le cas de l’islamophobie actuelle, qu’une personne peut, en reniant l’islam, se soustraire en partie aux régimes de domination et même rejoindre ou être adulée par des mouvements explicitement islamophobes, comme le montrent les exemples d’Ayaan Hisi Ali et de Salman Rushdie[12]. Mais la barre est particulièrement haute : cela requiert un rejet explicite et militant de l’islam. Bien que cette possibilité indique peut–être que les formes actuelles du racisme sont moins rigides et déterministes que les exemples précités et qu’elles peuvent se passer d’un discours de différenciation radicale entre les races, cela reste un mince soulagement pour l’écrasante majorité des sujets musulmans racialisés. La victime du train londonien aurait été attaquée, qu’elle ait été un musulman pratiquant ou un membre de la très islamophobe English Defence League. Plus largement, le fait de « sortir de l’islam » n’aura que peu d’impact sur les structures de domination mises en place par l’islamophobie. Même un musulman « repenti » pourra être discriminé lors d’entretiens d’embauche, de contrôles de police, de passages de frontière, etc. Cette structure est suffisamment rigide pour qu’on la qualifie de raciste.
À ces deux formes, biologique et religio-culturelle, de racialisation, je voudrais ajouter une troisième, qui constitue une partie importante de ma réflexion sur l’histoire croisée de l’antisémitisme et l’islamophobie[13] : la racialisation conspiratoire, dont les théories du complot forment l’articulation conceptuelle. Depuis le début du XIXe siècle, de nombreuses théories attribuent des développements historiques fâcheux (du point de vue de l’énonciateur), comme la Révolution française, l’avènement du capitalisme ou encore le bolchévisme, à l’action souterraine des juifs. Ces théories tournent autour du thème de la « domination juive ». Les Protocoles des sages de Sion en sont l’expression la plus aboutie et la plus influente. En ce qui concerne l’islamophobie, un genre similaire est apparu vers la fin du XXe siècle, mais surtout à partir du début du XXIe : il prétend révéler que les musulmans nourrissent le projet secret d’« islamiser » l’Europe et d’y imposer la charia (loi islamique). Ces théories du complot, loin d’être des manifestations accessoires du racisme, sont partie intégrante de ses stratégies de racialisation, puisqu’elles assignent des caractéristiques comportementales aux juifs et aux musulmans, notamment un instinct inné et congénital de conspiration collective, instinct considéré – dans certains cas que nous passerons en revue – si fondamental à la nature de l’individu qu’il le conduit à conspirer même malgré lui. Ces complotismes représentent le stade ultime de la racialisation, puisqu’ils ne se contentent plus d’altériser la population juive ou musulmane : ils l’élèvent au statut de menace existentielle pour la « civilisation occidentale ». Ce stade de racialisation est essentiel pour justifier des violences physiques à leur encontre, des violences qui se présentent dès lors comme une défense légitime contre un génocide civilisationnel. Ce phénomène étant aussi important que peu analysé, je lui consacrerai deux chapitres de cet ouvrage (chap. 3 et 4).
Il est évident que, dans beaucoup de situations historiques, les trois formes de racialisation – biologique, religio-culturelle et conspiratoire – se sont combinées de manière complexe. Le génocide des musulmans de Bosnie dans les années 1990 constitue un bon cas d’école. Rappelons que les musulmans de Bosnie – descendants des Serbes convertis à l’islam à l’époque ottomane – sont indiscernables physiquement de leurs compatriotes serbes orthodoxes. Les deux groupes ont donc des ancêtres communs, parlent la même langue, vivent dans les mêmes localités, fréquentent les mêmes écoles et cuisinent – à quelques ingrédients près – les mêmes plats. Seule la religion les distingue, mais, à la suite de décennies de sécularisation sous le régime socialiste, cet aspect doit lui–même être relativisé. Dans les années 1990, chez la majorité des islamophobes serbes de Bosnie le rejet de leurs compatriotes musulmans reposait sur la croyance en l’imminence d’un génocide serbe par les musulmans, théorie du complot avancée notamment par les écrivains Dobrica Ćosić et Vuk Drašković et promue par l’Église orthodoxe de Serbie[14]. En d’autres termes, le projet d’extermination des musulmans fut élaboré en partie dans le but d’éviter un génocide imaginaire, celui des Serbes. Cela étant, l’islamophobie génocidaire serbe comporte également un aspect biologique, défini dans les théories de Biljana Plavšić, une biologiste de formation qui dirigea la Republika Srpska de 1996 à 1998 et fut plus tard condamnée pour génocide et crimes contre l’humanité. Dans ses travaux, Plavšić soutient que l’islam produit des déformations génétiques chez ses fidèles, déformations qui dictent ensuite la « manière de penser et de se comporter » des Bosniaques musulmans[15]. Chose intéressante, ce déterminisme biologico-génétique, pour populaire qu’il fût dans certains cercles, n’était d’aucune utilité sur le « terrain » génocidaire : les soldats de la Republika Srpska n’administraient pas de tests génétiques avant de lancer leurs raids meurtriers contre les villages bosniaques. Ce qui leur permettait d’identifier les musulmans à abattre, c’étaient leurs patronymes (parfois, cette méthode d’identification n’était pas suffisante et devait être corroborée par des dénonciations de voisins extorquées sous la menace – ce qui souligne, si besoin était, l’ambivalence de cette
appartenance raciale).
L’islamophobie génocidaire serbe racialise donc ses victimes musulmanes de manière biologique – les théories de Plavšić – et de manière conspiratoire – les croyances populaires en une conspiration musulmane contre les Serbes. Mais la pratique génocidaire, elle, a recours à un marqueur culturel, à savoir le patronyme. Dans cet exemple historique, les trois formes de racialisation sont profondément imbriquées à l’intérieur d’un système complexe de vases communicants. Cet exemple, qui montre que les différentes formes de racialisation peuvent parfaitement cohabiter, permet de réfuter le récit classique de la naissance de l’antisémitisme moderne, proposé notamment par Hannah Arendt et Léon Poliakov. Selon ces auteurs, les différentes formes d’antisémitisme se sont historiquement succédé : la haine religieuse du juif, le Judenhass fondé sur le mythe du peuple déicide, élaboré au Moyen Âge, cède la place, dans la seconde moitié du XIXe siècle, à l’antisémitisme moderne et racial (biologique)[16]. Du reste, les deux tomes de l’Histoire de l’antisémitisme de Poliakov s’intitulent, respectivement, L’âge de la foi et L’âge de la science : selon lui, la race est un concept issu de la science moderne. Le présent ouvrage soutient au contraire que les trois formes de racialisation décrites ci–dessus se côtoient en permanence, s’entremêlent et s’imbriquent. Une histoire croisée de l’antisémitisme et de l’islamophobie doit en tenir compte.
Enfin, je voudrais dire un mot de la méthode adoptée dans cet ouvrage. Les phénomènes que j’y aborde sont diffus : ils s’insèrent dans des réseaux idéels et idéologiques qui ne connaissent ni frontières ni cadre chronologique précis et peuvent être exprimés par des personnages influents ou inconnus. Mon aire géographique et culturelle, « l’Europe occidentale », est définie de manière souple, pour me donner la liberté de traiter également de constructions idéologiques développées dans les Balkans et en Amérique du Nord. Il en va de même pour la chronologie : bien que la partie la plus conséquente du livre se concentre sur la période contemporaine, du XIXe siècle à nos jours, je me permets de remonter au Moyen Âge pour examiner les racines historiques profondes de l’antisémitisme et de l’islamophobie. Il me semble par ailleurs tout à fait approprié de parler d’antisémitisme et d’islamophobie à propos d’une époque aussi reculée, car, comme d’autres historiens, je ne considère pas que ces constructions discursives sont exclusivement modernes[17]. Une certaine souplesse s’impose également dans la sélection des auteurs : puisque mon travail vise à mettre en évidence les réseaux de circulation, de sélection et de brassage d’idées raciales dans un cadre global, il est inévitablement amené à étudier des hommes d’Église comme des savants, des dirigeants politiques comme des pamphlétaires, des journalistes comme des romanciers et des intellectuels, certains très célèbres, d’autres totalement obscurs. Les idées raciales ne connaissent pas ce genre de distinctions mais circulent librement des livres aux projets politiques, et les intermédiaires les plus influents ne sont pas toujours les plus connus.
Notes
[1]. Sur les débats autour du terme en France, voir Sarah Mazouz, Race, Paris, Anamosa, 2020.
[2]. Voir, pour un exemple–type, Pascal Bruckner, Un racisme imaginaire. Islamophobie et culpabilité, Paris, Grasset, 2017.
[3]. George M. Fredrickson, Racisme, une histoire, Paris, Liana Levi, 2007.
[4]. « American Anthropological Association (AAA) Statement on “Race”, May 17, 1998 », americananthro.org.
[5]. Pour une excellente étude générale, voir George M. Fredrickson, Racisme, une histoire, op. cit.
[6]. Geraldine Heng, The Invention of Race in the European Middle Ages, Cambridge, Cambridge University Press, 2018, p. 15-16.
[7]. Cf. par exemple le Nouveau dictionnaire d’histoire naturelle de Jean-Joseph Virey (cité dans Léon Poliakov, Le Mythe aryen. Essai sur les sources du racisme et des nationalismes, Bruxelles, Complexe, 1987, p. 206).
[8]. Francisco Bethencourt, Racisms: From the Crusades to the Twentieth Century, Princeton, Princeton University Press, 2013, p. 444.
[9]. Nasar Meer et Tariq Modood, « The Racialisation of Muslims », in S. Sayyid et A. Vakil (dir.), Thinking through Islamophobia, op. cit.
[10]. « Forest Hill Station Stabbing: Knifeman Shouted “I Want to Kill Me a Muslim” », Sky News, 13 décembre 2016.
[11]. Pour un point de vue similaire, voir Salman Sayyid, « Out of the Devil’s Dictionary », in S. Sayyid et A. Vakil (dir.), Thinking through Islamophobia, op. cit., p. 13.
[12]. Nesrine Malik, « Islam’s New Native Informants », New York Review of Books, 7 juin 2018.
[13]. Reza Zia–Ebrahimi, « When the Elders of Zion Relocated to Eurabia », art. cité.
[14]. Michael A. Sells, « The Construction of Islam in Serbian Religious Mythology and its Consequences », in M. Schatzmiller (dir.), Islam and Bosnia: Conflict Resolution and Foreign Policy in Multi–Ethnic States, Montréal, McGill–Queen’s University Press, 2002, p. 65-66.Voir aussi Jacques Sémelin, Purifier et détruire. Usages politiques des massacres et génocides, Paris, Le Seuil, 2009.
[15]. Cité dans Michael A. Sells, The Bridge Betrayed: Religion and Genocide in Bosnia, University of California Press, Berkeley, 1996, p. xv.
[16]. Hannah Arendt, Les Origines du totalitarisme, Paris, Gallimard, 2002 [1951] ; Léon Poliakov, Histoire de l’antisémitisme, Paris, Le Seuil, 1991 [1956-77].
[17]. Cf. Geraldine Heng, The Invention of Race in the European Middle Ages, op. cit.








![Pour une sociologie de la race (2e partie) [Podcast]](https://www.contretemps.eu/wp-content/uploads/t6-ico-038-00164191_0-150x150.jpg)
