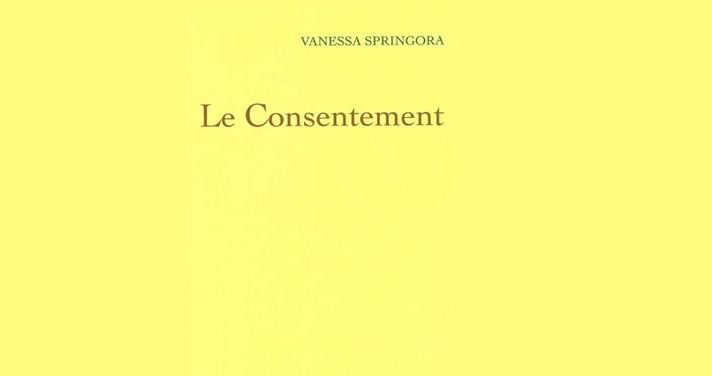
« Il y a tant de façons de ravir une personne à elle-même » (Vanessa Springora, Le Consentement)
À propos de : Vanessa Springora, Le Consentement, Paris, Grasset, 2020.

La littérature contemporaine est souvent taxée de nombrilisme. Tournée vers son auteur, son autrice ou sur elle-même plutôt que vers son lectorat, elle aurait remplacé les évènements du monde par les micro-évènements d’un « je » de plus en plus restreint à un petit milieu. Cette critique n’est pas dénuée de toute pertinence. Cependant, les écrits contemporains sont pluriels. Loin des récits autocentrés ou cyniques qui se complaisent dans une lucidité sans débouchés nous voudrions, dans cette chronique, mettre en valeur d’autres littératures : celles qui ne renoncent pas à dire le monde, ses luttes, ses échecs et ses espoirs.
***
Le témoignage, lorsqu’il prend la forme d’un livre, peut rapidement révéler ses limites. Ce qui fait sa force — la vérité brutale de l’expérience vécue, la sincérité de l’implication du narrateur ou de la narratrice dans son récit, le sentiment d’empathie qu’il provoque — risque de le restreindre à une émotion puissance mais ponctuelle.
Or Le Consentement de Vanessa Springora n’a rien d’un ouvrage éphémère. Il a certes eu un effet immédiat puisqu’il a déclenché « le scandale Matzneff » (comment un écrivain dont la pédocriminalité était non seulement connue mais affichée dans ses livres, sans même se réclamer du voile de la fiction, a-t-il pu bénéficier d’une telle impunité et être soutenu par tout un milieu littéraire et politique au point de recevoir le prix Renaudot en 2013 ?) qui est loin d’être clos aujourd’hui[1]. Mais la grande force du livre de Springora est d’avoir pris comme sujet de son livre non pas « G.M. » comme elle le désigne (retournant la pratique de Matzneff qui la désignait dans ses œuvres par son prénom ou comme « Vanessa S. ») mais bien les violences sexuelles, leur mécanisme et les conditions de leur impunité, parmi lesquelles le consentement.
Tous les consentements qui gravitent autour de la relation entre la narratrice et « G.M. » sont décrits, analysés, questionnés : celui de l’adolescente de 14 ans, celui par omission du père, par lâcheté de la mère, celui d’un petit milieu littéraire complaisant, mais aussi celui des institutions, incarnées par les figures de policiers fort peu soupçonneux, de professeurs qui ne disent rien quand ils voient un homme de 49 ans venir chercher une enfant tous les jours à la porte de l’école, ou encore du médecin qui au lieu de s’interroger sur les causes des maladies et blocages de sa patiente va d’un coup de « bistouri en inox » « aider l’homme qui se rend quotidiennement à [s]on chevet à jouir sans entrave de tous les orifices de [s]on corps ».
Springora se peint en enfant perdue dans un monde grimaçant où chacun contribue à la livrer en pâture à « l’ogre[2] » qui l’attire dans sa chambre grâce à ses sourires paternels, sa haute réputation, ses lettres enflammées, mais aussi, derrière ce vernis de séduction distinguée, les vieilles ficelles du pédocriminel : la promesse de savoureuses pâtisseries. La dévoration ne cesse pas lorsque la proie s’échappe. Elle se perpétue, dans son corps qui ne sait plus qu’être « un instrument pour des jeux qui lui sont étrangers », dans les livres qu’elle vénérait et qui la narguent en faisant d’elle une fiction falsifiée.
Le Consentement est un livre qui sait dépasser l’exposition d’une souffrance ou le désir d’un règlement de comptes. Springora l’a écrit des années après les faits, après avoir porté en elle, au péril de sa santé physique et mentale, ces questionnements. La main qui tient la plume est celle d’une femme qui a vécu et qui a réfléchi : narration et description alternent toujours avec analyse et argumentation. Springora dissèque ainsi la notion de vulnérabilité :
« C’est l’élément qui rend la notion de consentement si tangente. Très souvent, dans les cas d’abus sexuel ou d’abus de faiblesse, on retrouve un même déni de réalité : le refus de se considérer comme victime. Et, en effet, comment admettre qu’on a été abusé, quand on ne peut nier avoir été consentant ? ».
Elle argumente. Sa parole s’inscrit dans un débat de société, en répondant explicitement aux arguments de Matzneff sur la pédocriminalité, mais aussi à tous les poncifs habituels que subissent celles et ceux qui dénoncent la complaisance vis-à-vis de ce type de comportement quand ils sont ceux d’un artiste bien implanté dans un milieu social et/ou culturel dominant. Elle nous donne des armes.
Parmi ces armes, il y a les mots. Springora a été confrontée à une langue qui l’a piégée, qui l’a dépossédée d’elle-même jusqu’à l’aliénation. Dans Le Consentement, elle retourne ce pouvoir pour faire entendre enfin le point de vue de l’enfant face à l’ogre[3]. Comment ne pas opposer son style à celui de Matzneff ? Le style de Matzneff, souvent vanté comme classique, est en réalité ampoulé et onctueux, surchargé de références qui cherchent moins à dire qu’à maquiller des propos clichés ou des descriptions pornographiques répétitives[4]. Springora, elle, opte pour un style cru qui dévoile, qui nous ramène brutalement au caractère concret des faits :
« à quatorze ans, on n’est pas censée être attendue par un homme de cinquante ans à la sortie de son collège, on n’est pas supposée vivre à l’hôtel avec lui, ni se retrouver dans son lit, sa verge dans la bouche, à l’heure du goûter ».
Les clausules de chapitre particulièrement denses, comme lorsque la narratrice raconte ses tentatives pour expliquer à ses partenaires ses traumas sexuels :
« Chaque fois, la révélation se soldera par une rupture. Personne n’aime les jouets cassés ».
C’est un style satirique aussi – on pense ainsi à la savoureuse description des « petits doigts potelés de la femme de Cioran sur l’anse de la théière », contrepoint parfait des envolées du philosophe sur le prétendu rôle de la femme de l’artiste… Springora refuse l’abstraction. Elle revendique une écriture de la responsabilité, celle de l’écrivaine, mais aussi de l’éditrice. Le post-scriptum final du Consentement est celui qui aurait dû être ajouté par des éditeurs responsables aux ouvrages de Matzneff : « Voilà, ce n’est pas difficile », nous dit Springora avec un soupçon de malice « même moi, j’aurais pu écrire ces mots ». Elle les a écrits. Et nous les lirons, nous les relirons.
Notes
[1] Matzneff est cité à comparaître devant le tribunal pour apologie de la pédophilie, déchu de ses décorations et abandonné par plusieurs de ses éditeurs. Le débat sur la bienveillance complice dont il a bénéficié parmi les élites politiques et culturelles a été relancé avec la démission de Christophe Girard, adjoint à la culture d’Anne Hidalgo à la mairie de Paris, qui lui aurait permis, entre autres, d’obtenir une allocation à vie du CNL (Centre National du Livre). Christophe Girard a également été accusé d’abus sexuels.
[2] Le 27 juillet sur Cnews, Elisabeth Lévy, défendait son « ami » Gabriel Matzneff, refusant qu’on le traite comme « si c’était l’ogre de je ne sais pas où ». A-t-elle lu Vanessa Springora ?
[3] Rappelons que Francesca Gee (dont les lettres et les photos ont été utilisées, sans son autorisation, par Matzneff), avait écrit un livre sur sa relation avec l’écrivain en 2004. Aucune maison d’édition ne l’a accepté. Voir : https://www.nytimes.com/fr/2020/03/31/world/europe/matzneff-francesca-gee.html et https://www.marianne.net/societe/j-ai-ete-trahie-affaire-matzneff-une-victime-face-l-omerta-du-milieu-editorial
[4] Pour une étude du style romanesque de Matzneff, voir Nelly Wolf, « Le roman pédophile. Sur un roman de Gabriel Matzneff » (Isaïe, réjouis-toi) Proses du monde. Les enjeux sociaux des styles littéraires, P.U. du Septentrion, 2014.









